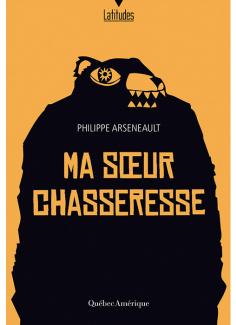Après Zora, un conte cruel (Robert-Cliche 2013), Philippe Arseneault revient nous livrer
un roman qui a la violence des diatribes échangées en famille.
Après Zora, un conte cruel (Robert-Cliche 2013), Philippe Arseneault revient nous livrer
un roman qui a la violence des diatribes échangées en famille.
Délaissant la fantasy littéraire, que peu de lecteurs osent considérer, Arseneault change son fusil d’épaule et, avec Ma sœur chasseresse, propose un roman dans une veine davantage réaliste sans pour autant renoncer à son joyeux goût pour le grotesque, la verve des méchants et une langue sublime, très écrite lorsqu’elle ne choisit pas d’imiter la médiocrité du sabir que certains de ses personnages crachotent. Finis les mondes imaginaires, le peuple a parlé, et le juge, pour une fois, s’est déclaré en accord avec lui. En grand démocrate, Arseneault l’a entendu et lui a donné des sujets au travers desquels on peut entrevoir son joli nombril, auxquels on peut facilement s’identifier et qui nous renseignent sur notre propre nature.
Un roman pour les séduire tous
Pour contenter ces hypothétiques lecteurs, Arseneault a fabriqué un roman dans son roman, un nouveau roman dont tout le monde parle, fait de phrases claires et concises, rédigé à base de mots que l’on emploie tous les jours et qui relate la quête de sens d’un trentenaire du Mile-End en perte de repères. Ce roman se nomme Putrescence Street et il est signé du nom de Roé Léry, narrateur de Ma sœur chasseresse. Contrairement à Arseneault, Léry a eu un succès fou avec son premier roman. Il l’avait d’ailleurs écrit dans ce but, but intermédiaire qui découlait de son ambition ultime: «[…] acheter des choses à Meng Wu, [sa] petite amie chinoise.» C’est que Léry ne croit plus en grand-chose et encore moins à ce qui touche de près ou de loin sa terre natale. Aux jacassements incessants des siens, à leur «fraternité de façade», il a préféré la politesse réservée des Chinois et s’est installé dans leur pays. À ceux qu’il a laissés derrière lui, il ne réserve que le mépris le plus véhément. Il juge les Québécois si simples d’esprit, si soumis aux tendances et si prévisibles qu’il n’hésite pas à «cochonn[er] la rédaction» de ce roman «rempli de tout ce qu’aiment les Montréalais (des niaiseries)». Présomptueux? L’accueil de Putrescence Street lui donnera cependant raison.
Ainsi donc, par quatre fois convoqué sur la terre de ses ancêtres, l’exilé désabusé se laisse finalement convaincre par ses proches et entame un voyage qui comportera un baptême, une commémoration d’un disparu, un soixante-dixième anniversaire et une tournée de promotion de son torchon encensé. C’est là que débute une démolition en règle de la Belle Province que le narrateur porte aux frontières de l’insoutenable. Tout au long du roman, par le biais de dialogues et de flux de pensées, Léry nous livrera l’étendue de la haine qu’il voue à son propre peuple. D’abord dans une entrevue qui tournera au vinaigre, ensuite à travers ses pérégrinations dans différents quartiers de Montréal.
C’est comme au secondaire: il faut bien qu’il y ait des cerveaux ramollis pour que les talentueux brillent. […] Tous les peuples de la terre n’ont pas vocation à construire des palais, explorer Pluton ou créer du beau. Il en faut aussi de plus humbles pour fabriquer des petits gâteaux, brasser de la bière, chanter bien, danser aux tables et faire des pipes.
Révéler l’hypocrisie
Certaines de ces critiques sur le Québec sont monnaie courante, nous les entendons depuis longtemps. Sempiternelle détérioration de la langue française au profit d’une fascination quelque peu malsaine pour les assaisonnements linguistiques à l’anglaise, déficience sur le plan de la mémoire historique et scène politique sur laquelle les boutiquiers détiennent tous les premiers rôles: rien de nouveau ici sinon la verve avec laquelle ces récriminations déboulent. Puis le martèlement, la virulence du démolisseur à l’ouvrage finissent par pousser au débordement le réservoir de l’autocritique. On pense refermer le livre pour échapper à sa bile noire et puis on se surprend à le reprendre, comme s’il devenait impossible d’ignorer plus longtemps l’irrésolution de ces conflits, de les faire taire avec quelques banalités bien tournées et servant à cacher le caractère socialement inacceptable de certaines de nos opinions.
Mais heureusement pour l’humeur générale, Ma sœur chasseresse ne se résume pas à son penchant prononcé pour la diatribe. Plus l’action avance et plus on comprend les raisons profondes qui ont fait de Léry un personnage si amer. Son passé l’humanise, sa rencontre avec une masseuse érotique passionnée par Jeanne Mance rétablit en lui le niveau d’empathie nécessaire à l’existence et rend sa véhémence plus compréhensible (sans que l’on doive lui donner raison en tout). C’est pourquoi on aurait tort de classer ce livre du côté des pamphlets déguisés en romans. Il faut, pour lui rendre justice, considérer la richesse encyclopédique de sa langue, la tendresse qui réussit à sourdre de ce texte depuis des profondeurs de désillusion et de fiel, de même que l’acuité du regard qu’il pose sur l’indulgence avec laquelle on juge nos lâchetés. Si Arseneault n’est pas le premier à mettre en scène un narrateur qui déteste les siens (on pense évidemment au Barney de Richler), il n’est sûrement pas non plus le dernier puisque paraît presque simultanément Le Québec n’existe pas (Varia, 2017), autre charge acerbe signée par Maxime Blanchard. Ces électrochocs produiront-ils quelque effet sur le cœur malade du patient alité? Difficile à dire, mais cela fait changement des habituelles petites tapes dans le dos. ♦