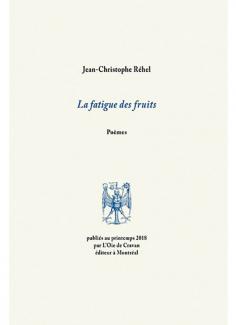Mon très cher Jean-Christophe,
«[Ç]a doit être ça», c’est ainsi que tu commences ton livre. Je ne m’explique pas cette phrase creuse. Ce n’est pas ça,
tu dois savoir que ce n’est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C’est beaucoup plus que ça, et tu nous le dis si merveilleusement. Tu nous ouvres la fenêtre sur ton appartement, tes marches vers le travail, ton tracteur à pelouse, la peau douce de ta blonde qui dort, ta santé mal en point et tes quintes de toux terribles, ton sandwich aux tomates, tes cheveux, les fleurs et les fruits. Ton petit monde immobile m’émeut au-delà du dicible: «je fais le tour de l’appartement/ je fais le tour de mes vertiges/je fais le tour de mon lit/je fais le tour du cri des klaxons/je fais le tour de tes cheveux attachés/je fais le tour de tes lèvres/qui regardent le menu au restaurant/je fais le tour de mes poumons/mes poumons sont tellement petits/mes poumons c’est le tour du bloc». Je t’écris de l’immense Pékin, où l’air est si étouffant que je crois parfois que nous nous évanouirons tous. Vingt-et-un millions d’évanouis. Et puis j’enfourche un vélo jaune et la vitesse se mue en fraîcheur sur ma peau, mes poumons se détendent. Partout autour, des libellules jaunes, des étals de fruits, des odeurs sucrées de nouilles. Le thé est délicat et on le boit très chaud. Le vin de riz qu’on appelle baiju est très fort et on le boit tiède, à larges lampées. Je ne parviens pas à dominer ma soif. Je suis minuscule et anonyme dans une mer sèche. «[J]e me perds dans la grande étendue», oui. Je ne suis pas hospitalisé, ni ne crache du sang, ni ne m’injecte des antibiotiques intraveineux. Je n’ai pas acheté d’assurance voyage. J’ai le don de la santé et je dis parfois que rien ne me tue. Je manque d’humilité. Nous recherchons tous les deux l’éternité. Différemment, peut-être. Peut-être pas. Je suis plus vieux que toi, de quelque treize ans. Je vivrai peut-être plus longtemps, peut-être moins longtemps que toi. Peut-être. C’est une injustice, tu le sais mieux que moi. Il faut accepter et lâcher prise, nous disent les moines chinois. Ça doit être ça. Je veux t’offrir un fruit d’ici. Une nectarine ou une pêche. Je veux te faire une eau citronnée. Je veux que tu saches que les feuilles ici sont si lourdes de leur vert qu’elles ne bruissent jamais. Les arbres gardent le silence. Les autos polluent, il faut circuler dans la fumée, à laquelle les humains ajoutent leurs exhalaisons. Il faut renoncer à voir le ciel, la lune rouge du 27juillet, les montagnes au loin. Il faut regarder vers l’intérieur, il faut purifier son cœur. Il faut trouver le Tibet. Moi aussi je suis Tintin. Dans mon cœur, il y a Tchang. Un petit enfant. Un koala. Comme toi, je me tourne vers les petites choses, m’y insère et y découvre une plage ou une rivière. «[L]a cicatrice/près de ta lèvre/c’est/l’univers entier/la dernière éclaircie». Ma blonde a un pli curieux au lobe de son oreille. C’est la plus belle chose, c’est une vallée, je m’y dirige à cheval, en tracteur à pelouse, assis, c’est pareil. Ça doit être ça. J’ai trouvé «une place dans ta voix», je m’y suis reposé. Il faut écrire et ne pas mourir, comme tu le fais, oui. Il faut chercher de l’ombre. Tu fais des montagnes, tu nous amènes sous les coquillages, sous la neige, sous les feuilles, dans la fraîcheur: «je souffle des feuilles/je fais des montagnes/il y en a tellement il y en a trop/je ne vois plus ma joie de vivre/ma joie de vivre est dans un tas de feuilles». Ton poème est un éventail chinois. Beaucoup de choses justes ont déjà été dites sur ton livre, sur sa forme brève et longue à la fois, sur ses boucles et ses répétitions que tu modules, sur ses images fraîches et ses journées longues de rien, sur sa grande tristesse qu’on veut consoler. J’ai peu à ajouter. Tu sais que nous discutons de ton livre partout autour de moi, on parle de la chance que nous avons de te lire, de nos espoirs que tu gagnes le Nelligan, de tes deux prochains livres qui déjà s’en viennent. J’ai apporté ton livre en Chine, j’aimerais le laisser sur un banc de parc, mais il y a peu de bancs de parc. Je pourrais le laisser dans un dépanneur. Si personne ne le réclame, ce sera une plante de plus qui mourra, et on pourra s’en émouvoir, ou pas. On ne décide de rien. On peut seulement acheter une bouteille d’eau à trois yuans. Elle ne sera pas très froide. Il faut se reposer. «[M]erci fantôme/je me range du côté de la fatigue/merci montagne/tes pieds me réchauffent/merci jour», merci Jean-Christophe, merci poème, repose-toi. Une respiration à la fois. Ça ira. Il faut se dire ça, ça ira.
Ça doit être ça, oui, tu as raison, j’avais tort. Ça doit être ça. Tu as raison. C’est ça, et ça suffit, et ce n’est pas fini, ça doit être ça. Ça doit être ça. Merci. ♦