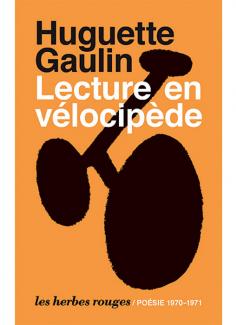Deux rééditions récentes posent la question suivante: jusqu’à quelles limites de l’expérience de la vie il faut se rendre pour alimenter de bons poèmes?
Deux rééditions récentes posent la question suivante: jusqu’à quelles limites de l’expérience de la vie il faut se rendre pour alimenter de bons poèmes?
Voici une histoire trop oubliée. Un jour, la blonde d’un poète mourut, piquée par un serpent. Elle se retrouva en enfer (on ne sait pas pourquoi, mais c’est ça qui arrive quand tu te tiens avec des serpents). Son chum, dans tous ses états, se dirigea vers l’enfer pour la ramener parmi les vivants.
Rendu au Bar des flammes, le poète discuta avec le boss. «Écoute, faut que tu me laisses ramener ma blonde, plaida-t-il, c’est trop dur quand ’est pas là.» Le tenancier lui répondit: «OK, ramène-la, mais toi, je ne veux plus te voir ici. Va-t’en et ne te retourne pas. Tu m’as assez volé de verres.»
Il faut dire qu’il en avait passé des soirées au Bar des flammes, le poète. Il y avait son tabouret attitré, sur lequel il s’assoyait des nuits durant pour ingurgiter toute la connaissance du monde et la coucher sur papier. Mais, se demanda-t-il, avait-il jamais pu ramener de l’empire des morts ne serait-ce qu’un tison des braises du feu de l’extase? Des cendres, que des cendres en poches lorsqu’il retournait à la lumière. Des cendres et des poèmes. Et une sacrée envie de dormir.
On connaît la suite: le poète partit avec sa blonde mais, pas-sant le seuil du chaleureux estaminet, il ne put s’empêcher de se retourner pour demander un dernier shooter de téquila. Le patron, qui n’entendait pas à rire, révoqua le pacte sur-le-champ. Le poète perdit et sa blonde et son tabouret.
J’ai laissé au Diable tes yeux en pourboire1
S’il est un poète qui symbolise la quête orphique, le been to hell and back; s’il est un poète dont le nom circule dans les milieux gouvernés par le 666, c’est Fernand Durepos. Dès ses premières œuvres des années 1990 (notamment une triade de recueils parus aux Écrits des Forges), il a incarné une figure de poète-rockeur sombre, démesuré ou piteux, toujours très délicat, amoureux ou peiné. Difficile de ne pas s’amouracher d’un pareil bad boy.
C’est toutefois après une pause de publication de six ans, en 2004, que la parution de Mourir m’arrive a pleinement mis en lumière l’écriture de Durepos, parvenue à maturité et à une netteté inédite. Premier pan d’une trilogie qui s’est complétée en 2006 et en 2008 sous la direction du regretté Robbert Fortin, Mourir m’arrive apparaît aujourd’hui comme un texte sans faille, une œuvre ni jeune ni vieille, d’une beauté à jamais désarmante. Sur le plan formel, la trilogie se reconnaît par la présence de titres si longs qu’ils sont parfois disposés en vers au-dessus des poèmes, sorte de conscience qui surplombe une chambre intime où ressuscite l’amour.
Durepos y explore le retour au calme d’un homme auprès de la femme aimée, après qu’il a vécu ce que l’on soupçonne être des excès d’une intensité vertigineuse. Nul doute, en effet, que «[l]e don de magasiner dans l’univers/et d’y emplir de pleins paniers d’astéroïdes/n’est pas à la portée de n’importe qui».
Le poète revient à l’amour d’on ne sait trop où et pour le moins battu, ce qui n’est pas sans me rappeler Marina Vlady, qui raconte, dans la biographie de son mari, l’état dans lequel était un jour rentré Vladimir Vyssotski après l’un de ses innombrables zapoï, une dérape alcoolique à la russe: «elle m’ouvre/reste derrière la porte entrebâillée/de tout ce qu’elle tait/et attend//tête basse/je lui offre/mes yeux rouges//un myocarde y éclate/en guise de fleurs».
L’arrivée presque mironienne de Durepos à ce qui peut recommencer donne lieu à une fusion immédiate, pathétique (au sens fort du terme):
toi
tu pleurais des cordesmoi
je m’allongeais sous toi
et restais nu dehors à te porter
comme un chandail de jeunesse
encore capable de tenir
chaud
Il retrouvera auprès de la femme aimée et aimante des bribes d’extase, fugaces moments d’abandon complet qui semblent rivaliser d’intensité avec toutes les transgressions imaginables. Ce faisant, le poète adresse autant de clins d’œil furtifs — et interdits, rappelons-le — en direction de l’enfer, dont il mesure le souvenir encore brûlant à l’aune de l’abandon amoureux. Pris de «la fièvre de presque tuer», Orphée y est ici triomphant, maître des deux rives du Styx, mais sa victoire ne se savoure qu’en silence, car c’est dans ce dernier seulement qu’il entrevoit l’amplitude des mondes qu’il a parcourus, la profondeur des limites enfoncées. Ultimement, la fusion charnelle apaise au point où les amoureux disparaissent l’un dans l’autre, en un Éden confidentiel d’où fleurissent les plus magnifiques passages du recueil: «disparaître/ne laissant pour souvenirs/que tiges de blé à la renverse/là où il y avait nos jambes/fraîchement coupées».
Quinze ans après sa publication originale, la réédition de Mourir m’arrive à l’Écrou fait honneur au style dépouillé, incisif de Durepos, et à son refus de l’artifice, du clinquant, de la facilité. Le murmure de ses textes s’y entend admirablement.
Celles qu’on laisse derrière
Tous·tes les poètes ne reviennent pas vivant·es de leurs poèmes. «Vous avez détruit la beauté du monde», a proféré Huguette Gaulin avant de s’immoler par le feu à vingt-sept ans et de marquer l’actualité de juin1972 d’un fait divers extrêmement inusité.
Une telle fin de vie aura également marqué de manière indélébile l’œuvre de l’éternellement jeune poète, car on sait combien toute œuvre littéraire interrompue par un décès prématuré est susceptible de se voir mythifier — et que cette construction a posteriori confère au texte un tragique lui-même susceptible de créer une distorsion quasi inaltérable dans la réception de l’œuvre.
D’abord paru aux éditions du Jour en 1972, puis en 1983 aux Herbes rouges, Lecture en vélocipède a été réédité en 2006 dans la collection «Enthousiasme», dédiée aux rétrospectives. Épuisé depuis, le recueil prend cette année sa forme définitive sous une chatoyante couverture orange (une création du bédéiste Vincent Giard) et jouit d’une disponibilité nouvelle, qui se conjugue notamment aux rééditions récentes des œuvres de Josée Yvon et d’Hélène Monette, décédées elles aussi prématurément. Mais sur la liste des écrivaines tragiquement disparues dans les dernières décennies, comptons également Marie Uguay, Geneviève Desrosiers, Nelly Arcan et Vickie Gendreau, entre autres, dont les livres sont presque invariablement discutés en regard de la mort de leur autrice — une perspective d’analyse regrettablement réduite.
Par conséquent, la question se pose: lirait-on aujourd’hui Lecture en vélocipède avec la même soif de sens si son autrice était toujours vivante? Pour y répondre, on doit non seulement disjoindre l’œuvre de Gaulin du spectaculaire suicide de la poète, mais aussi du décès des autrices mentionnées ci-dessus, puisqu’une mort hâtive n’est certainement pas un dénominateur commun pertinent pour les regrouper.
Démystifier Eurydice
S’il faut faire dialoguer Lecture en vélocipède avec d’autres œuvres, c’est d’abord auprès de celles des formalistes de la même époque. Et à ce titre, un triste constat s’impose: tandis que l’on s’intéresse encore au travail de Roger Des Roches, André Roy, François Charron, Claude Beausoleil et d’autres poètes toujours actifs de cette génération, on ne parle que très peu du travail des femmes de la première moitié des années 1970, à l’exception de Nicole Brossard (que Gaulin cite). Pour exhumer convenablement l’ensemble des œuvres qui ont nourri le courant formaliste de cette époque, il resterait à redécouvrir le travail d’autrices telles Carole Massé, Marie-Francine Hébert, Madeleine Gagnon et Yolande Villemaire.
Plus encore, il faudrait, pour circonstancier pleinement Gaulin, replonger dans les œuvres de Thérèse Renaud, Michèle Drouin, Micheline Sainte-Marie et Suzanne Meloche, pionnières du surréalisme québécois, dont les recueils ont été réédités non pas une, mais deux fois aux Herbes rouges. Or, qui connaît seulement le nom de ces autrices aujourd’hui? (Oui, Renaud a signé Refus global.)
Dans son intelligente préface de 2006, reproduite dans l’édition de 2020, Normand de Bellefeuille situe Lecture en vélocipède entre une influence surréaliste et le formalisme textuel du «signifiant vorace»: «tirez au hasard de la masse/mais tout vous va MESDAMES tout». Il invite également les lecteurs·rices à explorer l’isotopie de la maternité, la dimension autoréflexive du texte, la politisation du corps et autres pistes heureuses.
Quant à moi, j’ajouterais, tentant de me délester des cendres de l’immolation d’Huguette Gaulin comme j’aurais tenté de méditer, que ma relecture de Lecture, en 2020, m’a fait entendre plus précisément la voix de la poète. (Cette attente de son texte, dont parlait de Bellefeuille.) À travers la verve, l’emportement et le vocabulaire de Gaulin, j’entends des similitudes avec des voix contemporaines, comme celles d’Annie Lafleur, de Marie-Ève Comtois, de Clémence Dumas-Côté ou de Keith Kouna (pourquoi pas), dans ces vers:
monte l’étrange écueil
je crains d’or mais buccal
ces poissons circulent
retourneront quatre cycles en herbe vitale
La petite musique de Gaulin est tout en voyelles, en petits sons délicatement calibrés, et c’est beaucoup moins lourd qu’on ne le penserait. Je me suis dit que j’aurais aimé la voir sur scène, en 1972 ou maintenant.
C’est une lecture essentielle à maints égards, mais ce n’est pas la seule. Sa (re)découverte devrait permettre aux lecteurs·rices de revisiter le travail d’autres autrices laissées derrière, Eurydice consumées, tandis qu’Orphée rentre à la maison avec ses poèmes, sauf.
- 1. Titre d’un recueil de Fernand Durepos paru en 1998 dans la collection «Poètes de brousse» des Intouchables.