Je suis arrivée en 2016 à Montréal pour poursuivre mes études. À l’étroit dans les couloirs de la faculté, je me défaisais peu à peu de la littérature. À cause de la théorisation, de l’aseptisation. Mes recherches sur le processus de création littéraire étaient dépourvues de sens.
Comment et pourquoi intellectualiser l’urgence? La littérature est là parce qu’elle n’a pas le choix. Elle ne peut pas ne pas être.
Après avoir abandonné le doctorat pour sauver le peu de poésie qui restait en moi, j’ai longtemps tourné en rond sans savoir vers qui me tourner. J’habitais un vide immense, je le déshabitais. Encore et toujours, j’étais un vent qui passe. S’ensuivirent deux autres années de profonde amertume où je griffonnais des poèmes dans le métro de Montréal. Avec la pandémie, je me suis retrouvée sans travail du jour au lendemain. Les jours se suivaient, perdaient leur singularité. Je végétais au fond de mon lit. Mon père s’inquiétait, aurait aimé que je rentre au pays. Après tout, plus rien ne me retenait ici. Mais mon corps refusait le mouvement. Quelque chose adviendra, me soufflait-on de l’intérieur.
J’attendais le signe.
Le renversement.
Le 13 juillet 2020, j’ai reçu un courriel inespéré. J’ai relu chaque ligne une multitude de fois pour être sûre de saisir ce qui était en train de se produire. Intérêt pour ce manuscrit… Assuré de la collaboration… Poétiquement… Rodney Saint-Éloi.
Je venais de terminer la lecture d’un livre publié chez Mémoire d’encrier dont le titre me dérangeait. J’avais de nouveau sept ans et on ne prononçait pas son nom. Téta se mettait dans tous ses états quand son visage apparaissait à la télévision. Nous détournions le regard. Toi, Yara, tu as recentré l’œil. Crevé l’abcès. Bravant l’attendu, tu as écrit: Je suis Ariel Sharon. Tu t’es glissée dans l’esprit de la machine à tuer. Tu voulais comprendre pourquoi la mort, pourquoi la haine. Les guerres. L’invasion. Les failles. La douceur. L’amour. Yara, tu as rédimé l’innommable. Sans céder à la colère. En sublimant la femme dans l’homme. Une frontière est tombée. À travers son histoire à lui, c’est le colonial que tu as culbuté.
 Photo | Sandra Lachance
Photo | Sandra Lachance
T’avoir comme éditrice a été une évidence. Dans L’ombre de l’olivier, je savourais ta célébration de la mer infinie. Tout au long de ma lecture, une familiarité saisissante m’empoignait. L’odeur du bonheur se répandait dans mon appartement à Montréal. Kinno, mama nous a fait du mloukhiyyeh. Mon cœur souriait. Je ne savais plus si c’était toi ou moi qui dévalions les escaliers de l’enfance. Dans Le parfum de Nour, je me réjouissais de voir le corps jouissant de la femme arabe hors des sentiers battus de la fétichisation. J’aimerais y parvenir. Le poids des mœurs et de la réputation m’a suivie jusqu’ici, mais je chemine. Tu m’as dit un jour, face à mes craintes d’aborder la sensualité: Il ne faut pas avoir peur. C’est ainsi qu’on souhaiterait nous voir. Faire de nous des femmes-silence.
Après mon adoption à Mémoire d’encrier, tu m’as proposé de travailler à l’Espace de la diversité. J’attendais les réunions du vendredi avec impatience (qui aurait cru qu’un jour, le travail m’exciterait!). Nous commencions en parlant de nous, de notre santé, de notre famille, des livres que nous avions lus, des embûches de la vie. Le chat de Dimani venait saluer notre complicité. Très vite, mon père t’a incluse dans nos conversations téléphoniques.

Et ainsi, le père s’est apaisé. Il voyait en toi un terrain connu. Sans doute se reconnaissait-il dans ta frénésie de vouloir changer la donne. Dans ton dévouement à la littérature. Il a cessé de demander mon retour. Il m’a simplement dit d’être à la hauteur. Et d’écrire la beauté. Voilà comment tu as bouleversé l’intimité.
Mille choses se sont brisées dans cette traversée de l’océan. Mais pas le mot. Ni la dignité. Nous avons dicté la tendresse alors que nos pays s’abîmaient. Pour ne pas mourir de honte aux frontières, nous avons multiplié les tentatives de l’amour. Me vient à l’esprit ce poème de Mahmoud Darwich :
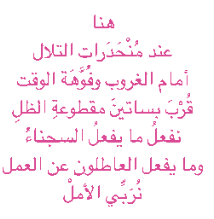
Yara, je te vois cultiver l’espoir. Un combat de lumière.
J’aimerais conjuguer mes mots aux tiens.
Alors j’écris la cardamome dans le fond de nos gorges.
Le thym sauvage.
Le jasmin. La sauge.
L’anthémis de Palestine.
Je me tamponne à tes imaginaires du monde.
Je vois les arbres pousser.
Le grenadier de ton grand-père.
Le figuier de ma grand-mère.
Malgré le mur. Malgré la coupure.
Nous résistons. Nous semons.
Nous dansons sous les arbres fruitiers se déployant à perte
de vue.
Nous dansons si fort que nos cœurs se mettent à voler.
Nous sommes les femmes-oiseaux,
Nous, voguant parmi les nuages,
Si loin, si haut,
Nous jonglons avec les étoiles, habitons le vent,
Nous chuchotons nos secrets au ciel
Et toujours
Nous écrirons la terre.
Emné
Née en France en 1990, Emné Nasereddine a grandi au Liban, où elle a étudié la littérature française à l’Université Saint-Joseph à Beyrouth. Sa poésie s’inspire de son expérience de l’immigration, des frontières, du deuil, de la vie des femmes libanaises, et des traditions et rites qu’elle a découverts au Liban du Sud. La danse du figuier (Mémoire d’encrier, 2021) est son premier livre. Elle vit à Montréal.

