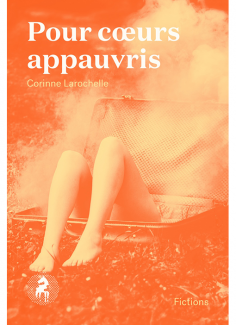Construit de courtes fictions, Pour cœurs appauvris entreprend d’insuffler le charnel au récit. Les mots deviennent palpables et on les effleure avec un plaisir évident.
Construit de courtes fictions, Pour cœurs appauvris entreprend d’insuffler le charnel au récit. Les mots deviennent palpables et on les effleure avec un plaisir évident.
En cinquante-huit tableaux, Corinne Larochelle fait l’inventaire des amours. Qu’ils soient dévorants, timides, arrogants, impossibles, ils sont toujours mus par le désir. Autant d’amants, autant de corps-à-corps que l’autrice présente en instantanés sensuels, où une cérémonie des gestes et des regards conduit l’histoire qui doit être menée jusqu’à son terme, malgré risques et périls. Esquissé avec doigté, chaque morceau, en dépit de sa brièveté, contient tout ce qu’il faut pour être entier et porter sa charge au lecteur. Larochelle sait ordonner les phrases pour installer une atmosphère des instants où les mots se matérialisent et deviennent aussi physiques que les peaux qui se percutent. « Ensemble, nous avons basculé dans une temporalité parallèle, celle où l’on se nourrit de la respiration de l’autre. » L’interdépendance des corps fait chuter le lecteur vers les mêmes abysses, et lui rejoue la sarabande de ses amours vécues ou imaginées.
Au Jardin botanique, Olivia parle de sa rencontre avec son amant. Pendant la grève — période propice à l’intensité et à la permission des espoirs —, quelque chose entre eux a éclos. Puis, naturellement, les choses se sont poursuivies, les questions ne se posaient pas, malgré l’existence d’une fiancée qui la situait deuxième sur l’échiquier. Jusqu’au jour de la dissolution, qui se fait sans trop d’éclat, comme un état de fait qu’on ne comprend pas, mais dont la réalité prévaut. Ailleurs, une autre femme se fond dans les yeux bleus d’un professeur. Ils passeront sept ans pendant lesquels elle le verra partir et revenir, avant qu’elle décide de laisser la distance gagner du terrain. « [J]’ai cherché à comprendre cette persistance à ne pas choisir. Ne pas me choisir. C’est la question qui demeure dans ton sillage. » Les attentes sont rarement satisfaites dans ce cahier des séductions, de là son titre, Pour cœurs appauvris : pour qui la chevauchée a fait mal par ses rendez-vous ratés, ses fausses projections, ses labels mensongers, sa déroute imprévue, son non-lieu ostentatoire.
L’art du geste
Plus loin, les amours prennent les contours d’un souvenir indistinct, d’un furtif moment où l’émotion resurgit d’une ombre qui se détache dans le paysage, du vent qui soulève le rideau. Même quand le fil du récit s’est évaporé, des traces persistent et creusent leurs sillons qui reviennent par intervalles. « C’est peut-être la forme insaisissable d’une absence », dira la narratrice. Un creux si prégnant que sa vacuité ressemble à une plénitude. Dans d’autres pages, les amants sont réunis dans la fusion, « aiguillonnés par la chaleur que dégageaient [leurs] torses », là un homme jouit en émettant le chant du lagopède des saules, une femme estime le temps qu’il faut pour répondre au message reçu et ainsi attiser le plaisir de l’attente. Dans toutes les histoires, le geste prédomine — qu’il soit question de sa beauté, de son apprentissage, de sa précision ou de sa symbolique — et entraîne la suite, un geste souvent incapable de prédire où cela va mener, parfois, au contraire, il agit avec la netteté de la conscience.
Puis au détour d’une page, comme un point d’orgue, on se demande si les abandons répétés, les plaies vives, les traversées du désert n’auront pas raison de ces âmes éperdues. À la clinique : « Cela fait plusieurs histoires où vous donnez le meilleur de vous-même et que cette beauté n’est pas reçue. Tout de même, il ne faudrait pas y laisser votre peau. » Que faire ? On passe au suivant, en tentant de préserver les parts essentielles de soi. Ou on renonce à chercher son salut à travers l’autre, comme cette femme qui marque au crayon sa nouvelle résolution.
En me relisant, insatisfaite de l’étendue sans cesse renouvelée d’un désir à combler, j’ajoute en dessous de la dernière ligne, en capitales ratatinées : NE PAS PERDRE MA SOLITUDE.
L’espace s’ouvre à nouveau, l’amour affirme sa souveraineté : on le porte d’abord en soi.
Thèmes et style
Sous les airs anecdotiques des tableaux de Pour cœurs appauvris, on recense la peur, la candeur, la passion, la sensualité — « je pouvais jouir du frôlement de son cil sur ma joue » —, l’œil goguenard, l’envie — « est-ce que certains fantasmes méritent qu’on se donne du mal pour les concrétiser ? » —, l’inassouvissement, le silence, la foudre, l’étreinte, le sexe — « nous entendons les gémissements avant de voir les corps » —, la perdition. Des morceaux nous laissent parfois sur notre faim, on aurait voulu que soient plus développés certains passages, les relations plus approfondies, les portraits plus nuancés. Mais Larochelle réussit à donner de la texture et de la densité à cette suite de pertes mélancoliques dont le début et la fin s’érigent en quelques lignes. Le style ne revêt en aucun cas une allure sensationnaliste ou voyeuriste, où pourraient facilement dériver les confessions érotiques. Ce qui aurait pu être une série de déceptions plaintives est plutôt d’une nature ciselée, écrite avec franchise. ♦