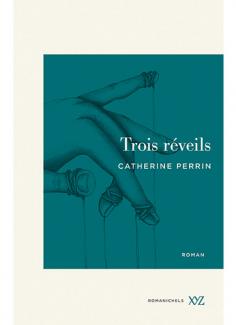Antoine, jeune joueur de hautbois atteint de troubles psychotiques, talent prometteur qui a préféré le métro aux salles de concert, se réveille un matin avec une certitude: sauver le monde par la musique.
Antoine, jeune joueur de hautbois atteint de troubles psychotiques, talent prometteur qui a préféré le métro aux salles de concert, se réveille un matin avec une certitude: sauver le monde par la musique.
Trois réveils: la triade du titre du roman de Catherine Perrin m’a tout de suite évoqué l’œuvre de Renée Dunan, La triple caresse (1922), roman de formation dans lequel un jeune homme doit résister aux trois «caresses» que sont la forfaiture, le pouvoir et la volupté pour maîtriser une destinée aux accents révolutionnaires. Les trois réveils d’Antoine, qui organisent les trois parties du livre, sont-ils autant de moments significatifs dans un temps décisif de sa vie? Il semblerait que oui. Au premier lui vient l’idée de sauver le monde par la musique; au deuxième, il revoit son amour de jeunesse; au troisième, il se trouve au chevet de son père mourant. Et pourtant, il est difficile de véritablement saisir le devenir du personnage tant l’ouvrage demeure sage et poli. Perrin propose un roman psychologique tout empreint de réflexions sur la pratique musicale classique, un texte bienveillant, respectueux des conventions du genre, mais qui peine à approfondir sa forme et ses thèmes.
Romantisme
Un jeune musicien, rêveur, maigre, aux cheveux noirs — comme tout bon héros romantique —, porte sur ses épaules le poids de sa maladie mentale et celui de son mélomane de père («un père mélomane, c’est encombrant»), qu’un cancer du poumon s’apprête à emporter. Cette dernière épreuve sera pour le fils l’occasion de faire la paix avec certains de ses démons et d’accéder au palliatif suprême du spleen romantique: une rente et une femme. Il faut ici sentir l’ironie du critique, quelque peu déçu par une telle fin bourgeoise.
Le protagoniste de Trois réveils ne révèle qu’un peu de son inté-riorité lors de ses moments de crises psychotiques — et encore, celles-ci ne représententque quelques pages dans le livre, le reste relevant d’une psychologie plus que classique, lui attribuant (à lui ou aux autres personnages) quelques ressentis communs et des étiquettes arrêtées d’une doxa réaliste étayant une réalité aux structures stables, cohérentes et signifiantes1.
Le Montréal romantique d’Antoine fonctionne comme une machine bien huilée, où chacun est à sa place: les belles gens dans les salles de concert; les itinérants dans la rue; «les vrais occupants du territoire, ceux qui déambulent avec leurs drames et leurs échecs inscrits dans le corps, mais libérés de bien des conventions». Antoine recherche la «liberté» des marginaux: il habite un trois-pièces. Romantisme tiède. Quand sa sœur lui demande pourquoi il ne «s’installe pas», il rétorque, héroïque: «Ton mode de vie ne garantit pas le bonheur.» Le monde ne tremblera pas. Or, quels sont les enjeux d’un héros romantique et malade s’il ne fait pas trembler le monde?
À noter, toutefois, quelques éclaircies, quelques moments vibrants où les personnages acquièrent un corps pulsionnel, mystérieux et désirant qui rehausse d’éclats trop fugaces leurs sages existences romanesques.
Le cri de l’oiseau dans la nuit
Nul doute que Perrin est une musicienne accomplie, et que les réflexions et expériences qu’elle transmet dans ce livre au sujet de la pratique de la musique classique sont d’un intérêt certain. La musique demeure le sujet le plus intéressant du livre, et l’ignorant en la matière qui écrit ces lignes a apprécié pareille incursion dans ce monde sensible et grand. Certaines des réflexions d’Antoine sur l’origine de la musique m’ont rappelé l’essai de Pascal Quignard, La haine de la musique (1996). Il aurait été néanmoins plaisant que les rêveries du joueur de hautbois conduisent le lecteur vers des zones plus antérieures et sombres que l’étonnement devant le cri d’un oiseau dans la nuit: «De tout temps, l’humain a entendu le cri des oiseaux dans la nuit, comme Antoine entend parfois le huard sur le lac.» Le texte, ici, s’arrête au seuil du sensible. Si la connaisseuse de la musique nous prend par la main tout au long du roman, la claveciniste de talent ne nous dit rien du cri de l’oiseau pas plus que du frisson de silence enveloppant ce cri. Dommage. Certes, il y a la figure du père d’Antoine, qui réécoute l’intégralité des quatuors de Beethoven à mesure qu’il s’approche de la mort, «mais le père ne livre pas ses secrets intérieurs», et l’on ne saura pas grand-chose de la nuit. Pourquoi se rendre jusqu’ici pour dire si peu, pour ne pas faire vibrer le monde? Pourquoi cette retenue?
- 1. Je renvoie à ce sujet à l’article de Leo Bersani, «Le réalisme et la peur du désir», publié dans le recueil collectif Littérature et réalité, Seuil, 1982.