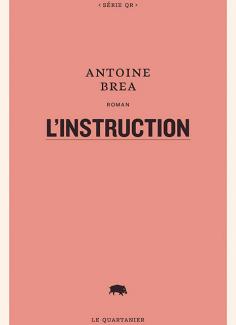Patrice Favre, jeune juge d’instruction, remplace temporairement un juge suicidé en banlieue parisienne. Avec L’instruction, Antoine Brea plonge dans les froideurs kafkaïennes du monde judiciaire français.
Patrice Favre, jeune juge d’instruction, remplace temporairement un juge suicidé en banlieue parisienne. Avec L’instruction, Antoine Brea plonge dans les froideurs kafkaïennes du monde judiciaire français.
Avocat et romancier, Antoine Brea maîtrise l’univers technico-sémantique de la justice et le met au service de la fiction. Il s’agit d’un monde pour lequel des notes de bas de page sont parfois nécessaires: elles illustrent le fossé entre le vocabulaire courant et celui du pouvoir. Après l’excellent Récit d’un avocat (Le Quartanier, 2016), l’auteur développe, dans ce nouveau roman, les lieux et personnages de ce théâtre d’État. L’intrigue, aux allures de polar, est simple. Un juge trouve dans les papiers de son prédécesseur des éléments inédits concernant l’instruction du meurtre, survenu en prison, d’un détenu du nom de Jean-Marie Coutteau. De fil en aiguille, il en vient à soupçonner un assassinat orchestré par un prétendant au poste de ministre de l’Intérieur. Si l’intrigue, soutenue par une narration alternant récits et documents, maintient en haleine, l’essentiel de l’œuvre réside dans le portrait politique et existentiel des différents cercles des pouvoirs exécutif et judiciaire français.
Antihéros
Patrice Favre, rond-de-cuir de palais de justice, antihéros bovien, médiocre élément de la médiocrité supérieure française, fils de juge sous l’éternelle autorité du père, est un mal-être ambulant porté par des mots, «la soumission patiente d’un garçon éduqué pour atteindre une vie conforme, une personnalité conforme, un avenir conforme à ceux du père». Physiquement affaibli, insomniaque, habité par une angoisse sourde, il ne trouve de sens dans l’existence que malgré lui, dans l’épluchage de dossiers, le train de banlieue et les souvenirs d’échecs et de fadeurs.
Ce personnage, à l’hypersensibilité enfouie sous une épaisse couche de refoulements, de tabous érotiques et de neurasthénie, est la focale par laquelle le roman présente le monde gris d’une société française qui s’effondre au ralenti, sous le poids d’une histoire coloniale refusée, d’un racisme violent et d’un ultralibéralisme autoritaire infiltrant patiemment l’État, tant dans sa structure – par le biais de la privatisation – que dans ses idéologies et son instinct de domination. Dans une entreprise littéraire qui relève pleinement du réalisme social français, oscillant entre d’une part l’engagement à gauche d’un Joseph Ponthus ou d’une Sophie Divry, et d’autre part le nihilisme d’un Michel Houellebecq, L’instruction fait le tour de l’appareil étatique de répression, des commissariats aux prisons, en passant par les salles d’audience. Le petit peuple y est séparé du grand, de celui qui décide, qu’il ne rencontre que par l’intermédiaire de ses agents, policiers et magistrats dans des exercices de domination plus ou moins implicites. La scène d’audience du début du livre, dans laquelle un jeune racisé est condamné sans preuve ni délai, rappelle le film de Raymond Depardon, 10e chambre, instants d’audience (2004), et toute la violence qui enrobe le langage simili-soutenu des juges.
Humanité
Outre la justesse avec laquelle Brea choisit et enchaîne les situations, c’est la dimension existentielle portée par la narration détachée – dans la lignée de L’étranger (1942), d’Albert Camus – qui fait toute la force et la profondeur de L’instruction. L’enquête suit une série d’indices: un suicide sous un train de banlieue, un cancer, un cauchemar, un patronyme rappelant l’Occupation… Elle obéit au sens d’une malédiction ironique qui révèle dans toute chose le grand jeu de la mort: «Dehors, le ciel couchant employait de belles teintes roses et sombres provoquées par la pollution en train de nous tuer tous.» C’est parfois par un seul mot que la narration porte le coup, comme lorsque Patrice Favre, visitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin d’y interroger une vieille dame atteinte d’Alzheimer, s’enquiert, «par urbanité», du bien-être des résident·es. Non par politesse ni par compassion, mais bien par «urbanité», notion ridicule et floue qui suggère une certaine sophistication creuse, un sens du commun bâtard, un terme faussement chic, un cache-misère dérisoire et pitoyable dans cette «antichambre de la mort». Un mot qui sonne comme le comble des faux-semblants auxquels le narrateur se prête tout en n’y croyant aucunement, et sans trop savoir pourquoi.
Toutefois, ce poids de grisaille n’anes-thésie pas l’empathie des lecteur·rices; au contraire, Patrice Favre, en dépit de sa petitesse ressentie, ne devient jamais indifférent en deçà du jeu social imposé. Interrogeant la veuve d’un surveillant de l’administration pénitentiaire, une femme à la vie dure, une laissée-pour-compte parmi des millions d’autres, le protagoniste se sait «mal préparé à accorder toute l’attention qu’ils méritent au destin piteux de cette femme, à la vie gâchée de son époux, préoccupé surtout de [s]es questions sèches, [s]es investigations sans état d’âme, où était [s]on humanité?». Comment retrouver l’humanité perdue? Poser la question, cela revient à croire que l’humanité peut encore être retrouvée.