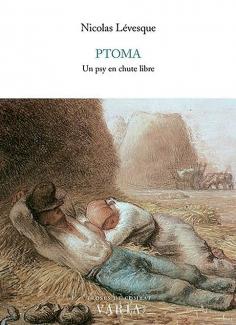Ptoma, de Nicolas Lévesque, habite les failles et les incertitudes du psychanalyste. Infidèle aux textes et aux images canoniques, l’œuvre explore avec humanité les chutes psychiques et citoyennes.
Ptoma, de Nicolas Lévesque, habite les failles et les incertitudes du psychanalyste. Infidèle aux textes et aux images canoniques, l’œuvre explore avec humanité les chutes psychiques et citoyennes.
J’ai toujours aimé la générosité de la pensée et de l’écriture de Nicolas Lévesque. Alors que l’essai littéraire, dans Phora (Varia, 2019), était conçu comme un «espace de sensibilité, et rien d’autre», une «serre, humide et chaude, où poussent librement les plantes», Ptoma va encore plus loin en «fond[ant] un espace littéraire, sans origine ni destination, où toutes les métamorphoses sont permises», une «écriture organique» qui «ressource» l’auteur. Rappelant, par ses thèmes et son souffle, la correspondance atypique dans Ce que dit l’écorce (Nota bene, 2014), que Lévesque a rédigé en collaboration avec Catherine Mavrikakis, Ptoma se donne à lire comme la suite inespérée de Phora. La continuité organique entre les deux ouvrages est manifeste, et cette plante «monstrueuse» que nous propose ici l’essayiste invite le lectorat à une réflexion libre et touffue sur le temps qui passe, le désir, la mort, le rêve et la vie qui tient bon.
Dévoilement
Sorte de surgissement en temps de pandémie, Ptoma, livre à la lecture parfois exigeante, tente de concilier littérature et vie au présent. Avec humilité, le psychanalyste de papier entremêle les histoires d’analysant·es et les réflexions touchant autant à la famille qu’au corps social.
Par le jeu avec les paroles des autres, Lévesque se dévoile dans chacun des fragments. Brodant toujours autour d’une chute (ptoma signifie «tomber»), chaque chapitre «invite à perdre l’équilibre», à accueillir l’imprévu. Passées du côté de la littérature, ces voix multiples qu’entremêle l’auteur sont autant de scènes où le regard peut enfin se retourner: c’est le psychanalyste qui se livre, qui se reconnaît et qui est vu. C’est lui, mais aussi soi-même que l’on entend, dans un souffle courageux, inlassablement retrouvé.
L’écriture comme «solitude habitée» laisse entrevoir, chez Lévesque, à la fois une grande intériorité et une véritable réflexion sur la culture et ses mécaniques. Elle laisse également poindre une solide prise de position critique devant le système de santé et les institutions. Psychanalyste politique, populaire mais non populiste, comme il aime l’écrire, Lévesque dresse un portrait sans complaisance du Québec d’aujourd’hui. Alors qu’on reconnaît, particulièrement dans le passage sur la souveraineté québécoise et ses nouvelles avenues possibles, certaines préoccupations d’autres auteurs de la collection «Proses de combat», des éditions Varia, Lévesque s’en distingue légèrement par sa posture dialogique: il se met constamment en danger par le mouvement de la pensée. Jamais orthodoxe, il décrie le manque d’accompagnement dans le domaine de la santé mentale et «notre paresse transformée en système public». Il évite le cynisme en prenant le chemin de la générosité et du doute: «La vie est une chose qui se partage. Et il n’y a pas d’autres raisons d’être de la psychanalyse: la juste circulation du vivant.»
L’art de la chute
Étayant une réflexion intéressante sur ses contemporain·es, Lévesque fait du tableau La sieste, de Jean-François Millet, un leitmotiv de son écriture. Constamment réinterprété, le couple endormi du maître français sert de locomotive aux chapitres: «C’est une peinture qui tombe sous le sens, en dessous du sens, pour s’en sauver, se protéger de la violence des idéologies.» L’amour, la mort, mais aussi les classes sociales font corps dans le regard que l’auteur pose sur l’œuvre. Sous sa plume, elle renvoie à un «au-delà de la peinture et de tous les langages qui nous appelle à déposer le pinceau, à nous rapprocher de la nature, des plantes, des animaux, des autres humains. […] Je me sens avec toi dans ce monde. Nous sommes paysage.»
De façon intéressante parce que souterraine, la figure de Saint-Denys Garneau traverse Ptoma. L’impossibilité de se (re)poser, mais aussi le jeu et l’accompagnement sont les fils rouges de l’essai. On reconnaît l’impression de transparence propre au poète chez le psychanalyste, sans peut-être l’abîme de solitude de Regards et jeux dans l’espace (1937). Le flâneur – à la fois comme idéal et forme de résistance – se retrouve dans l’imaginaire de l’ouvrage, prenant les habits du «temps de l’analyse, temporalité subversive, […] du temps sans but, sans programme, de l’errance, ce qui inquiète la Cité, qui aime contrôler les déplacements et les destinations».
Résolument près des pensées anticapitalistes et parfois même révolutionnaires, Ptoma jongle intelligemment avec le langage pour faire de nos mondes intérieurs et extérieurs des espaces un peu plus habitables.