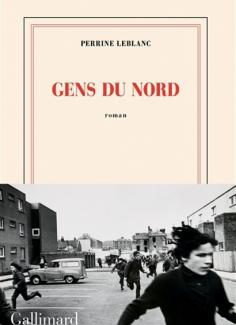Bien connu du lectorat québécois, le nom de Perrine Leblanc évoque les territoires du Nord. Après la Russie et la Gaspésie, voici l’Irlande avec ce roman oscillant entre politique, polar et romance.
Bien connu du lectorat québécois, le nom de Perrine Leblanc évoque les territoires du Nord. Après la Russie et la Gaspésie, voici l’Irlande avec ce roman oscillant entre politique, polar et romance.
Gens du Nord s’ouvre en 1991 sur l’exécution du poète irlandais Samuel Gallagher. En pleine tourmente entre républicains et royalistes, une jeune documentariste québécoise, Anne Kelly, se lance sur les traces de ce meurtre. De passage à Paris, elle est pistée par François Le Bars, grand reporter de trente-cinq ans proche des services de renseignement, mâle indomptable qui s’éprend de cette «belle rousse» «dont la couleur des cheveux di[t] danger». Il l’aidera à mener son enquête de Paris à l’Irlande du Nord, à coups de conseils et de rencontres entre deux chambres d’hôtel. Ce compagnonnage, ayant valeur d’initiation (non sans machisme), transforme profondément les deux membres du duo, qui s’engagent dans les arcanes de la poudrière irlandaise, des alliances impossibles, des utopies contrariées.
Palimpseste des Nords
Le roman nous transporte de Montréal à Belfast, en passant souvent par la capitale française, avec force descriptions, dont la minutie n’a d’égale que l’implication avec laquelle l’autrice a dû mener son enquête, aussi attentive aux détails que le serait une ancêtre revenue sur ses terres. Le paratexte mentionne la filiation qu’entretient Leblanc avec des lignées d’immigré·es irlandais·es, ainsi que la façon dont il lui est arrivé de voir vaciller et parfois s’effriter, non sans émotion ni peur, la frontière entre son investigation et sa vie. De cette friction entre personnel et fictionnel surgissent des pages inspirées où Anne semble aider Perrine – et vice-versa – à se frayer une voie à travers les paysages d’Irlande et les rues de Paris, autant que dans l’intrigue. Pourtant, l’instance narrative demeure à distance de ses personnages; quoiqu’abondamment et systématiquement caractérisés par des portraits physiques et moraux efficaces (malgré leur schématisme), ils sont résolument inaccessibles, aussi secs que la matière de l’ouvrage, tout en retenue – en «litote», comme le dit la narration, qui fait référence à la réserve avec laquelle une Québécoise se sent parfois obligée de parler en France.
«Litotique» aussi est le palimpseste qui, par petites touches, superpose les soubresauts républicains de l’Irlande du Nord au rêve éconduit de l’indépendantisme québécois. Ce parallèle, l’écriture revient discrètement dessus, mais assez souvent pour suggérer non seulement la question de ces pays qualifiés d’«interrompu[s]» dans le livre – pays interrompus parce qu’impossibles –, mais également, peut-être, celle du roman impossible. C’est en réalité Gens du Nord lui-même en tant qu’objet qui, dans son ambition foncière, se pose comme question. Car si l’œuvre se tient un peu au seuil de la tradition des imaginaires du Nord (tradition déjà riche dans les littératures de langue française, en plus d’être perfusée et revisitée par une très actuelle mouvance mainstream), le fait qu’elle soit écrite par une Québécoise publiant en France, mais surtout lue au Québec, dilue en quelque sorte les paramètres de sa réception et, de fait, les conditions de son énonciation ainsi que la nature de l’art poétique qui s’y déploie.
De l’adresse à la réception
Gens du Nord semble, tout au long de ses pages, négocier sa posture entre roman québécois tout court et roman québécois pour lectorat français. De telles considérations pourraient paraître secondaires si le style ne cherchait pas son équilibre entre des québécismes assumés (c’est à saluer) et une écriture qui veut faire français. Celle-ci transparaît essentiellement dans la redondance de grossièretés qui, sans justification diégétique, jure par rapport au registre discursif, en plus de nous amener à nous questionner sur le statut de l’instance narrative. Mais ces impairs stylistiques auraient pu simplement relever de maladresses si le roman ne s’obstinait pas à proposer des pages d’ethnographie tantôt parisiennes, tantôt irlandaises – nordiques. Alors que ces dernières sont globalement réussies, en dépit de quelques clichés, les premières, généreuses et ne lésinant pas sur les stéréotypes, peinent à convaincre: la supposée agressivité des gens de la capitale française, les cabines de douche minuscules, la chambre de bonne deux-pièces (chose inexistante) avec «vue somptueuse» sur le Sacré-Cœur, entre autres évocations de lieux emblématiques des parcours touristiques qui rendraient jalouse une certaine Emily (in Paris).
Là encore, tout ceci aurait pu relever d’une espèce de jeu bienvenu si le roman avait fait l’économie de ces longues digressions ethnographiques, nous menant de café en restaurant, de cabaret en chambre d’hôtel, sans nécessairement faire progresser l’intrigue. Ne s’interdisant ni lieux communs ni poncifs, les louvoiements amenuisent sensiblement les arcs dramatiques, pourtant tirés, dès la première page, de façon tonitruante et haletante. Arrivé à la dernière ligne, l’on se demande si ce livre, aux ambitions certaines et à l’esprit d’aventure entier, ne s’est pas un peu perdu de vue en cours de route.