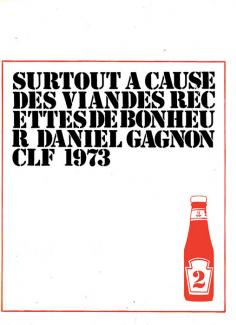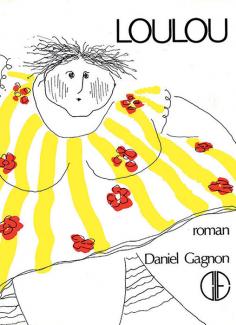L’ami Janson avait un petit verre au creux de la paume, lors du dernier lancement de LQ, et me parlait pour la troisième fois des archives du Mouvement de libération du taxi. Ça faisait longtemps que je voulais remuer cette soupe-là. Surtout l’ouvrage Le taxi: métier de crève-faim, de Germain Archambault (Parti pris, 1964). Puis ça a traîné comme un talon de chèque dans un tiroir, et Marc-André Cyr a fouillé le sujet1 de la libération du taxi pour Nouveau Projet.
Je n’avais plus trop envie de m’étendre sur Réjean Ducharme finissant ses runs chez Pauline et Gérald, ou sur Lucien Francœur et son permis de chauffeur probablement signé par Jim Morrisson. Encore moins sur Stanley Péan. J’ai tout de même cherché le mot «taxi», en compagnie de l’ami Mercier — un autre qui a souvent la paume pleine — dans le Dictionnaire des œuvres littéraires québécoises (DOLQ). J’aime bien les chauffeurs de taxi; c’est ma fibre arabe. On arrive au Québec en caressant des rêves d’autodafés de nos diplômes d’ingénieur, et de séances de tapochage de chauffeurs d’Uber. On est de même, quoi.
Le DOLQ contenait notamment une référence à un livre de Daniel Gagnon intitulé Loulou, publié en 1976, dans lequel un «héros adolescent […] fait un jour la connaissance de Loulou, énorme femme à la peau blanche qui porte la tare de la féminité, c’est-à-dire son sexe qui la fend […]. L’apothéose survient lorsqu’elle se laisse prendre par un cheval introduit dans l’appartement, répandant ainsi les tripes de l’héroïne un peu partout.»
Un roman dont le «climat de perversité et [l]es descriptions pornographiques expliquent pourquoi [il] a tant choqué».
J’avais justement besoin d’un peu de scandale, puisque l’été ne m’avait pas encore fait grâce des opinions de tout le monde et de sa cousine au sujet de Robert Lepage, des revues de création que personne ne lit et des homards qui ont aussi des sentiments. Alors j’ai lu Loulou — en édition originale déterrée sous une pile d’essais communistes ronflants, mis à rabais par la Librairie Vaugeois, à Québec.
Se brûler le cerveau à l’effet de loupe
Loulou est un conte cruel qui avance au rythme de la surenchère. C’est un peu comme si André Forcier avait filmé Les onze mille verges, en incorporant La grosse femme d’à côté est enceinte dans l’histoire. Par exemple:
Je pris un tiroir du petit bureau de Léo et le cassai en deux sur mes genoux pour en récolter les planches que je plaçai en entonnoir de chaque côté de la raie des fesses de Loulou. Et m’en servant comme d’un levier, j’arrivai à faire un trou passablement large. J’y jetai la Holy Bible qu’il y avait dans le tiroir.
— Tu vas te trémousser pour quelque chose ma grosse ressuée.
Il y a de tout dans ce livre-là: zoophilie, coprophilie, pédophilie, nécrophilie, gérontophilie name it… De la moulée pour appâter le maillon stratégique et hydrocéphale de la société post-humoristique. Celle dont les membres les plus en vue n’ont souvent aucun problème à distribuer des procès en ligne pour atteinte aux bonnes mœurs lorsque leur guidounage (ou le guidounage de leurs enfants) pour des marques quelconques a du plomb dans l’aile. «Cette indignation est commanditée par Wellbutrin. Pour consommer en souriant, il y a Wellbutrin.» Un cerveau à deux temps, ça ne pense pas, ça dépense, comme dit Desjardins. Mais je m’égare…
Mario Parent, qui a signé l’entrée de Loulou dans le DOLQ, explique qu’il faut dépasser l’effet de loupe que propose l’auteur pour découvrir ce qui se cache derrière les masques de ses personnages: le don de soi incompris et refusé, la misère de l’amour perdu, irremplaçable jusqu’à la mort même. Ça devrait aller de soi… non?
Je suis de ceux qui croient qu’il y a une grandeur dans l’amorale que la morale ne peut comprendre ou expliquer. D’ailleurs, lorsque quelqu’un déchire sa chemise au nom de la vertu ou de la morale, dans le monde de l’art, on en apprend souvent plus sur cette personne que sur les œuvres elles-mêmes. L’histoire de la réception de Sade est un exemple probant — Michaël Trahan l’a démontré dans La postérité du scandale (Nota bene, 2018). Celle de Josée Yvon aussi parmi les cercles féministes de son époque («Ciel! elle a utilisé le mot “bandé”… ») Quand la morale sert de socle à l’art, il n’en résulte généralement que des réflexions de «policiers-marketeurs». Notez que je parle bien de morale ici, et non d’éthique. Ça, c’est autre chose.
«Ça passerait plus» et autres phrases creuses
Il y a une double idiotie dans le fait de s’estimer fier que quelque chose ne «passe plus aujourd’hui». C’est soit 1) parce qu’on est trop con pour en prouver la valeur, ou 2) parce qu’on est trop con pour s’empêcher de produire de la fange. Au lieu de me dire que Loulou ne passerait plus aujourd’hui, j’ai donc écrit à Daniel Gagnon.
Après tout, dans l’entrevue qu’il avait accordée à Jacques Bélisle, dans XYZ. La revue de la nouvelle en 1986, Gagnon — cofondateur de la revue — avait parlé de la genèse du livre et de sa rencontre avec cette grosse femme, en expliquant que Loulou était «une légende vivante, une femme de quarante-cinq ans, pauvre et marginale», dont les actes, pour le moins dégradants — comme celui de se rentrer des bouteilles de bière dans le vagin — lui servaient de sésame pour lui ouvrir le monde clos des tavernes.
En la faisant revivre dans un roman, Gagnon avait ainsi réussi à exagérer encore plus cette vulgarité, non pas pour en faire un personnage qui veut ou doit entrer dans le monde des hommes, mais plutôt un personnage en qui le monde désire entrer, tant elle est «un monstre d’amour», bien que cela soit d’une manière improbable.
Quand j’ai reçu les réponses de Daniel Gagnon, aussi peintre et docteur en lettres, qu’Yvon Boucher avait défendu dans Le Devoir en 1976, en affirmant que Loulou «nous fait voir également à quel point le concept de culture est associé à tout un appareil d’intimidation», j’ai éprouvé le même sentiment que ressentent les gens dont l’œil décrypte un effet d’art optique pour la première fois. Fuck, c’était ça…
Mardi gras permanent
Aux yeux de Gagnon, Loulou — qui réapparaît plus tard dans son roman Une enfance magogoise (Trois-Pistoles, 2006) — est une insoumise:
«Vulgaire», elle ne l’est que dans le sens noble du mot, du latin vulgus, «le commun des hommes». Son «manque de distinction» lui vient de son appartenance à la masse du peuple. De là, elle tire une grande authenticité, son cœur est grand et noble, et son corps appartient au peuple qui justement souffre de l’hypocrisie des gens supposément distingués qui gouvernent et abusent des faibles et des petits.
Prise dans une espèce de Mardi gras permanent, Loulou, avec sa situation misérable, devrait attirer des sentiments de pitié, des sentiments riches et généreux. Mais poussé à l’extrême, exagéré dans une mascarade époustouflante, le tout sert à dénoncer le mépris dont elle est l’objet dans la vie réelle.
Il s’agit donc, comme le dit Gagnon, de «revenir au corps… au corps du Christ, en ce pays catholique de [s]on enfance. Peut-être, au “corps-hostie”, à la “grosse hostie-Loulou”, donnée en partage, en communion au peuple, sacrifiée sur l’autel des bars d’hôtels.»
Ainsi donne-t-elle également du corps au texte en ouvrant son corsage au tout venant, explique l’auteur, qui ajoute que Loulou est par ailleurs «un anticorps, et c’est pour cela qu’elle a été accablée, éreintée par la critique, tant le roman était chargé d’une impression du refus de se soumettre aux canons de beauté de la grande mascarade sociale».
Lui aussi…
Néanmoins, si Jacques Bélisle parlait, dans XYZ, de cette écriture comme «d’une écriture érotique fantasmatique», c’est peut-être là la plus grande méprise de lecture qu’on puisse faire. Gagnon réplique au contraire que le récit se veut anti-érotique:
Je fais partie d’une minorité importante d’enfants abusés qui ont vécu une sorte de trou de mémoire abyssal sur les abus sexuels qu’ils ont subis. Dans la cinquantaine, j’ai retrouvé des souvenirs effroyables d’abus et de prostitution aux mains de mon père, ce qui explique peut-être l’intensité de ma révolte. Je me sens très proche du mouvement et des combats #moiaussi [#metoo]. J’admire leur courage de parler.
Certaines scènes du roman rappellent ainsi les abus subis par Gagnon.
Quelques scènes sont encore vives, celles par exemple dans des hôtels où nous étions vendus à des hommes, mais parfois, comme dans ma Loulou, j’étais jeté nu sur le corps d’une femme, d’une prostituée, simplement pour faire rire perversement mon père et ses comparses avec mon petit sexe d’enfant effaré et humilié devant eux par sa réaction involontaire.
Le traitement réservé au mari de Loulou, Léo, devenu cadavre dans le roman, fait donc potentiellement référence au père de Gagnon, contre qui celui-ci a obtenu de la Cour supérieure du Québec une citation à comparaître pour abus sexuels, en 2003. «Il n’y a pas eu de procès, car il est mort en 2004 d’un cancer de la gorge. Comme si ses remords étaient restés pris dans son gosier, comme des excuses impossibles à cracher, comme des crimes impossibles à avouer.»
Serez-vous surpris si je vous dis que la police et le procureur avaient refusé d’entendre Daniel Gagnon? «Ma famille m’a ostracisé. C’est dire les difficultés que les victimes d’abus sexuels doivent affronter.»
Qu’est-ce qu’on répond à quelqu’un qui nous écrit ça? «Ça passerait plus aujourd’hui»? Me semble, oui. ♦
- 1. Marc-André Cyr, «Le mouvement de libération du taxi», Nouveau Projet, nO13 printemps-été 2018, p.38-39.