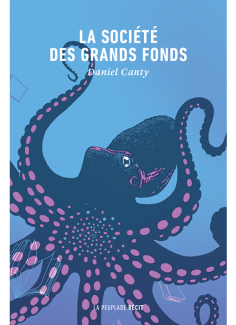Après les profondeurs du sommeil dans Le livre de chevet et la cartographie intime de Mappemonde, La Société des grands fonds, le dernier livre bleu de Daniel Canty, sonde les abysses des mers intérieures de la littérature.
Après les profondeurs du sommeil dans Le livre de chevet et la cartographie intime de Mappemonde, La Société des grands fonds, le dernier livre bleu de Daniel Canty, sonde les abysses des mers intérieures de la littérature.

J’ai longtemps pensé que Daniel Canty était le nom d’une nébuleuse. C’était au temps où les auteurs gravitant autour du Quartanier me semblaient porter des noms trop beaux pour être vrais. Ces noms, pensais-je, fidèle à Romain Gary, étaient tous des pseudonymes. J’aimais imaginer que derrière le personnage Daniel Canty se cachaient plusieurs personnes travaillant à l’édification d’une œuvre tentaculaire. Jusqu’à ce qu’un jour je lance un roman d’amour à la librairie Le Port de tête et que mon amie artiste s’accroche à mon bras pour m’annoncer à l’oreille, sa voix tremblant d’excitation, que Daniel Canty se trouvait dans la librairie.
Du doigt, elle a indiqué un homme aux yeux tristes, identiques au portrait qu’il donne de lui lors de sa période new-yorkaise dans La Société des grands fonds: «Certains de mes collègues me trouvaient un air de Buster Keaton — mon profil d’Irlandais mélancolique —, avec une touche de Marcel Marceau — j’affectionnais à l’époque le port du chandail rayé et du pantalon noir.» Sous ses boucles argentées, le «semi-jeune homme» portait, de fait, une marinière. Entre le souvenir de cette apparition et la lecture de son dernier ouvrage, j’ai pu constater que Daniel Canty existe et qu’il n’a pas changé.
Que son identité n’aille pas de soi, je ne suis pas la première à le remarquer. «La question de son identité n’en est pas moins fascinante et à vrai dire assez vertigineuse. Tout indique d’ailleurs qu’elle le soit à ses propres yeux», disait Pierre Nepveu dans sa présentation de l’auteur à l’Académie des lettres du Québec en novembre2017. Sa prolixité en divers domaines — littérature papier et «électrique», design d’édition et d’événement, traduction, dramaturgie, arts de l’écran — contribue à faire de lui un écrivain nébuleux. Ajoutons à cela que Daniel Canty ne se contente pas de jouer les touche-à-tout: il floute les formes attendues de tout ce qu’il touche. Ou les fait apparaître sous une autre forme, un fantasme. Jusqu’à la figure de l’auteur que son œuvre littéraire travaille à rendre insaisissable.
Dans une librairie de Toronto, je suis un jour tombée sur une copie de la traduction anglaise de Wigrum (La Peuplade, 2011). Elle était classée auprès des Exercices de style de Raymond Queneau dans une section intitulée «Fiction sans intrigue». La dénomination me semblait bien trouvée. De fait, ce «roman» de Daniel Canty se présente comme le catalogue d’objets divers ayant appartenu à Sebastian Wigrum. La présentation de cette collection par Joseph Strepniac convoque un défilé de personnages mélancoliques. Quant à Daniel Canty, en plus du livre, il signe une postface. Mais le lisant, on doute autant de l’identité de ou des auteurs que de la nature de l’ouvrage. «Sebastian Wigrum est-il vraiment fictif? Et Daniel Canty est-il réel, et est-il l’auteur? Heureux trouble», écrivait Catherine Lalonde dans Le Devoir.
Roman sans intrigue et faux collectif, Wigrum est aussi une somme d’érudition et d’imagination dans laquelle notre sens de la réalité perd pied. À l’image de ces noms d’auteurs que je croyais factices bien qu’ils fussent authentiques, la matière de Wigrum prend la forme d’un musée rêvé exhibant des «fragments excentriques mais pourtant bien réels de la culture savante et artistique des deux derniers siècles», ainsi que le disaient en 2012 Mathieu Arsenault et Catherine Cormier-Larose au gala de cette société plus underground qu’est l’Académie de la vie littéraire.

Votre admission à la Société des grands fonds
Les livres de Daniel Canty exigent de la lectrice que je suis (que vous êtes) d’accepter un principe de non-contradiction que la plupart des lecteurs se refusent à admettre, à savoir que l’imaginaire et le réel se confondent. Ayant la réputation d’être compliquée, l’œuvre de Canty présente une seule difficulté: la fiction n’est pas gardée du réel. Pas plus que la première ne se «mélange» à la seconde, comme on se borne souvent à définir l’autofiction. On est plutôt convié à une expérience de lecture dans laquelle l’imaginaire et la vie sont d’une même eau: «Il faut se rendre à l’évidence, est-il écrit dans La Société des grands fonds, que la fiction est composée de la même matière que nous. Qu’elle fait aussi partie de la réalité.»
Merveilleux livre que La Société des grands fonds. Le livre d’un rêveur, un rêve de lectrice. Pour l’essentiel, il s’agit, rassemblées (mais réécrites), de chroniques publiées de 2008 à 2013 dans feue la revue Le Bathyscaphe, qu’on associe aux éditions L’Oie de Cravan. Un bathyscaphe étant un sous-marin, Daniel Canty a eu l’idée d’écrire sur ce qui unit la lecture et l’heure du bain. Portrait de l’écrivain lorsqu’il était enfant, et du lecteur plongé dans un bain-tourbillon et un roman d’aventures, de Salinger ou de Borgès, alors qu’à l’étage en dessous son père écoutait La soirée du hockey. Par chacune de ses chroniques devenues chapitres, Daniel Canty fait le récit erratique de cette période que Roland Barthes appelait «l’adolescence liseuse». Tout laisse d’ailleurs supposer que l’auteur de La Société des grands fonds n’en a pas émergé.
Pour apprécier ce récit, il faut se laisser porter par le style élégant de Canty, «cette façon d’avancer sans savoir où il s’en va et pourtant d’atterrir toujours sur ses deux pieds» (pour emprunter les mots que son ami lecteur Michaël Trahan m’a répondus par courriel). Et voguer d’un souvenir, d’une image, d’un temps, d’un lieu à l’autre. Des familles de Kahnawake qui, pendant la Crise d’Oka, se rendaient au supermarché de Lachine en canot aux Chroniques martiennes de Ray Bradbury, de «la leçon de latin la plus populaire de l’été 1989» (carpe diem) aux sanglots qui souvent secouent le narrateur, d’un train en Oregon au naufrage des «poëmes» d’Alain Grandbois sur le Yang-Tsé, d’une pierre que l’on trouve sur la lune et dans les dalles du trottoir de New York à un dégât d’eau qui n’aurait épargné que les autrices de sa bibliothèque, la prose de Daniel Canty charrie son limon de faits réels, teintés de magie. Michaël Trahan dit: «C’est un virtuose. Et un grand styliste (on ne le dit pas assez)». Je suis d’accord avec lui.
Aux futurs lecteurs de La Société des grands fonds, j’aimerais dire ceci: il est préférable de baigner tout ce qui est raconté d’une certaine lumière. L’auteur la voudrait sans doute bleutée. Dans une veine qui rappelle Bluets (Wave Books, 2009) de Maggie Nelson, ce livre d’eau est aussi un ouvrage sur la couleur de la nuit et de l’inaccessible. Bleue serait la couleur «des livres qui sombrent en nous», écrit Canty. Si l’on ne perçoit pas aussi aisément en littérature qu’au cinéma l’atmosphère surannée d’une œuvre à la Wes Anderson (dont la Margot Tenenbaum figure dans La Société des grands fonds), c’est pourtant ainsi que vous devriez imaginer, dans votre cinéma intérieur, les livres de Daniel Canty: maniérés. Comme ces dessins de Stéphane Poirier qui coiffent chacun des chapitres dont la grâce rappelle les livres d’enfants. L’ampleur des lectures et de la géographie traversées n’a rien d’intimidant lorsqu’on se laisse toucher par la drôlerie d’un ton doucement emprunté. Et sa mélancolie.

Une société discrète
Dans son discours de réception à l’Académie des lettres du Québec, Daniel Canty a dit que «l’écriture donne accès à une sorte de société secrète, en tout cas discrète». Une société qui, à rebours des discours d’autorité, à rebours de la critique qui «se trompe toujours», me dit-il, à rebours des enthousiasmes de la rumeur ambiante, croirait au pouvoir d’enchantement de la littérature. S’il est question de cette société d’écrivains et de lecteurs dans La Société des grands fonds (puisqu’à plusieurs reprises, l’auteur s’adresse à sa lectrice dans l’idée de fomenter cette société), on peut également penser que toute l’œuvre de Daniel Canty, et particulièrement ses récits et ses essais, vise à créer cette communauté sensible.
Avant La Société des grands fonds, Daniel Canty publiait, en 2016, Mappemonde (Le Noroît). La séquence de publication a ceci d’heureux qu’elle permet de lire ces textes d’eau dans le prolongement de ce précédent récit. Ces deux livres partagent, en effet, un même territoire (la littérature et l’enfance), un même deuil (la mort du père) et un même temps complexe. Dans la métaphysique de Daniel Canty, le passé est chargé d’avenir et le présent est celui des images qui ne nous quittent pas. Des images banales, mais qui témoignent pourtant du mystère d’exister. «Je ne suis pas du genre à prendre rien à la légère», me dit-il en entrevue. Je l’aurais deviné. Avec Walter Benjamin, W.G. Sebald et Joan Didion, Daniel Canty fait partie du club des écrivains mélancoliques. De ceux qui tentent d’épingler, comme il le dit joliment, «ce qui dans le vécu échappe au vécu».
Il est une sorte de nébuleuse qu’on appelle diffuse. Elles «émettent ou réfléchissent la lumière» ainsi que nous renseigne l’Encyclopédie des Intertubes. Quand bien même Daniel Canty ne serait pas une nébuleuse, La Société des grands fonds est une œuvre absolument lumineuse. À l’image de ces villes dont l’auteur nous dit qu’à une certaine heure, vues d’une certaine distance, elles atteignent «la beauté du ciel». ♦