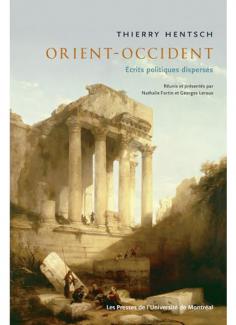Professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal, Thierry Hentsch est décédé prématurément. À sa mort en 2005, le quotidien Le Devoir avait consacré rien de moins, je m’en souviens, qu’un éditorial à sa mémoire, le présentant à cette occasion, non sans raison, comme une figure exemplaire de l’intellectuel d’ici. «Contrairement à la France, le Québec ne connaît pas le star-system intellectuel», écrivait Josée Boileau en déplorant leur mort récente:
Pas de Sartre ou Beauvoir ici, ou d’Aron, de Bourdieu, Lacan — ni de BHL, de Ferry, de Cyrulnik, de Badinter, d’Onfray. Ici, la timidité devant les débats d’idées — qui sont bien autre chose que l’échange d’opinions à l’emporte-pièce — ne favorise pas la mise en valeur de ceux qui portent une pensée forte et originale. Alors Vacher le philosophe essayiste, Desaulniers, l’analyste de la télévision, Hentsch, le philosophe politique, sont des noms qui parlent peu, ou pas du tout, au grand public. Et pourtant, leur œuvre aura été marquante.
Professeur doublé d’un écrivain, Thierry Hentsch avait eu le temps d’être récompensé de nombreux prix, dont celui du vice roi du Canada, le Prix littéraire du Gouverneur général, en hommage à ce beau livre qu’est Raconter et mourir (Presses de l’Université de Montréal, 2002).
De ses amis, Georges Leroux et Nathalie Fortin ont cru bon, à raison, de rassembler ses textes épars. Dans ce volume posthume, intitulé Orient-Occident: écrits politiques dispersés, apparaît la grande cohérence et l’élégance de cette plume qui demeure d’une actualité parfois étonnante.
Tous Américains
Par où commencer? Je lis, en particulier, ses écrits rédigés au lendemain du choc consécutif aux attentats du 11 septembre 2001. Hentsch se montrait particulièrement posé, mettant à profit plusieurs années de réflexion à l’égard du Moyen-Orient. Il doutait volontiers, non sans raison, de ces théories civilisationnelles à cinq sous qui ont connu leur heure de gloire à la suite de ces attentats. Il est vrai qu’avant même que le FBI ait indiqué la moindre piste, les médias occidentaux s’étaient instinctivement «tournés du côté du monde musulman pour chercher les coupables», observait Hentsch. Cette réaction qui désignait d’emblée comme coupable tout un milieu manifestait fort bien, ajoutait-il, «l’existence d’un malaise durable dans notre rapport à cette région du monde».
Ici comme ailleurs, on trouva de bon ton de lancer des professions de foi en faveur de Washington. À entendre bien des commentateurs soulevés par une vague revancharde, nous étions soudain «tous Américains». Vouloir soutenir des nuances, aller jusqu’à dire que cette Amérique portait peut-être en elle la responsabilité d’au moins une portion du malheur qui la frappait était conçu comme une hérésie. L’intellectuelle Susan Sontag en fit les frais, on s’en souviendra. Elle fut vertement semoncée pour avoir voulu indiquer quelques pistes de responsabilités de l’Amérique dans le désagrément du monde. Mais le discours dominant voulait seulement entendre que les terroristes étaient des fanatiques absolus, des monstres, des gens à mettre au ban de l’humanité, des insectes au sujet desquels il ne convenait même pas de réfléchir et qu’il était préférable d’exterminer sur-le-champ jusqu’au dernier. Dans cette même tonalité, un professeur réputé de l’Université Laval écrivit alors que les opposants de cette Amérique frappée au cœur étaient des rats qu’il fallait s’employer à éradiquer.
Dans quel monde voulions-nous vivre lorsque le président Georges W. Busch, comme réplique immédiate aux attentats, répétait à ses compatriotes pendus à ses lèvres d’aller magasiner, de poursuivre en somme la vie qu’on attendait qu’ils vivent? Quel monde étions-nous à nous fabriquer alors?
On croyait volontiers, même à l’université, que Samuel Huntington, avec son Choc des civilisations, avait raison. Thierry Hentsch en dénonçait la courte vue sans broncher. Pareils idéologues, résumait Hentsch, «supposent qu’entre certaines civilisations des incompatibilités fondamentales constituent de dangereuses sources de tensions dans le monde». Ces affrontements seraient d’abord d’ordre culturel. «Si cette manière de voir était exacte, les tensions russo-américaines auraient dû survivre intactes à l’effondrement du régime soviétique et l’Occident se montrer inapte à s’entendre avec la Chine, l’Inde et le Japon.» Et c’était sans compter que toute l’argumentation bancale des Huntington de ce monde convergeait vers la volonté de faire des musulmans un nouveau repoussoir commode pour imposer des visées de domination, au nom d’une théorie fumeuse qui «sert ici à désigner l’autre comme la source du problème». Ce qui revenait à vouloir croire d’emblée l’Occident comme immunisé contre toute forme de critique qui pourrait lui être adressée.
Il y aurait pourtant matière, rappelait Hentsch, à un retour sur soi. «Aucune civilisation n’a autant détruit que la nôtre», une destruction à grande échelle qui se manifeste de façon éclatante avec la «découverte» des Amériques et qui va croissant, à partir de là, sur plus de cinq siècles.
Intellectuels et experts-comptables
Est-ce le regard autocritique qui nous faisait défaut? Même pas. Aucune civilisation ne s’est autant critiquée mais avec si peu de conséquences logiques, soutenait Hentsch. «Nous avons prôné la tolérance et pratiqué l’exclusion, demandé la dignité et provoqué l’avilissement, prêché la liberté et asservi les peuples conquis.» Ce à quoi il ajoute que nous avons érigé «le mythe du sujet moderne, libre, autonome, et nous l’avons descendu de son piédestal, sans pour autant cesser de nous comporter comme si ce jeu existait. Même le culte de la raison ne nous a pas empêchés de connaître deux guerres mondiales, et des tueries à une échelle jusque-là inconcevable.» Aucune civilisation, en somme, n’a aussi radicalement cherché à maîtriser la nature tout en réussissant aussi mal à se contrôler elle-même.
Son analyse est cinglante et demeure d’une vive actualité. «Nous avons révoqué Dieu de la sphère publique et réinstallé la transcendance dans la nation, avant de la transférer dans le capital», écrit-il. Et ceci encore: «Les intellectuels qui, les yeux fermés, affichent leur confiance inébranlable en notre système ressemblent un peu à ces experts-comptables qui accordent leur bénédiction à une entreprise en roue libre sur la pente d’une faillite frauduleuse. Ce sont des nouilles ou des escrocs.»
Dans ce cadre, la «différence» que l’on célèbre partout est devenue un hochet commode, pour peu qu’elle ne dérange pas. La différence, note Hentsch, n’est devenue tolérable qu’en vertu des canons du folklore qui donnent une touche de couleur agréable à l’ordinaire, pourvu qu’il ne dérange pas celui-ci. Autrement, toute différence est jugée «intolérable». Ce qui revient à dire que «l’Occident n’exige rien d’autre, au fond, que de pouvoir paisiblement consommer le monde et tenir ses mendiants tranquilles en faisant mine de les inviter à sa table».
Quels que soient les avantages matériels que ce système capitaliste procure à quelques-uns — et Thierry Hentsch avait pleinement conscience d’être au nombre des privilégiés —, il est de plus en plus impensable d’évacuer de nos consciences les ravages immenses qu’il entraîne. «Nous savons bien que ce système ne peut indéfiniment faire du monde entier le champ d’une lutte impitoyable pour le profit en excluant comme simple déchet cette part du matériel humain qui fait obstacle à sa volonté.» Pourtant, c’est bien cette voie qu’on s’astreint à continuer de suivre, tête baissée, résignés.
Dans un des beaux essais qui composent ce livre posthume, Hentsch rappelle que ce monde qu’on tente de percevoir comme enchanté ne supporte pas l’idée qu’on puisse se tenir en marge du rêve officiel, montrant de la sorte que la tolérance de ce système est plus limitée qu’on veut se le faire croire. Il invoquait à preuve le cas de citoyens américains frappés d’ostracisme dans la mesure où ils décidaient de rejoindre le monde d’idées des talibans. Devenir Américain, fait remarquer Hentsch, c’est selon la rhétorique ambiante atteindre à ce que l’humanité a produit de mieux. Il est donc tenu pour normal que tous le désirent et «inconcevable que quiconque puisse raisonnablement y renoncer». Ce qui donne la confirmation implicite, soutient finalement Hentsch, «de notre incapacité à penser un horizon politique, social et philosophique différent du nôtre». Dans ce livre, sans conteste, on trouvera matière à de riches réflexions.