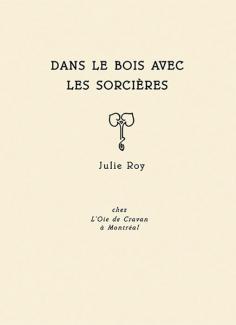Dans le bois avec les sorcières, le deuxième livre de Julie Roy, ressemble davantage à une longue marche dans la plaine du quotidien qu’à quelque ensorcellement.
Dans le bois avec les sorcières, le deuxième livre de Julie Roy, ressemble davantage à une longue marche dans la plaine du quotidien qu’à quelque ensorcellement.
Certains recueils sont des invitations aux errances, des péré-grinations en bonne et due forme dans des univers calqués sur le réel avec des touches d’étrangeté. Plus de dix ans après Le vol des esprits (L’Hexagone, 2005), l’auteure revient avec une poésie tout aussi épurée, une langue parfois même saccadée, tentant de circonscrire en de courts textes l’essence poétique d’une fantaisie urbaine. La suite de poèmes se déplie donc rapidement devant celui qui s’efforcera de trouver où camper entre réel candide et onirisme plaqué.
Dès les premiers poèmes, les vers s’entrechoquent précipitamment, confrontant le banal avec le beau, et le lecteur se demande si la rencontre est ici désirée par son architecte, ou si elle n’est que le fruit d’une fortuite paresse stylistique. «J’étais la madame fine au centre d’achats / Je doutais comme une sainte fatiguée». Dans cette forêt dessinée par Julie Roy, on tangue entre l’enfance et l’âge adulte, entre précision et flou opaque. Si elle «ouvre le colis du jour / Sous un ciel de slush», le poème, comme le lecteur, reste pris entre deux âges. On est «chacun dans nos tiroirs / À inventer nos rêves», pourtant, à peine deux poèmes plus loin, le réel se mêle au fantasque, revêtant parfois de banals habits:
Ton grand-père algonquin
Ça nous disait rien
Le char a embrassé l’arbre
Au parc Outremont
Ça sent nos blessures
Plus on s’enfonce dans ce boisé, moins il s’avère homogène. Le suite de poèmes ne repose pas sur un socle cohérent qui ferait tenir les poèmes ensemble, ce qui en soi n’est pas un problème. Par contre, aucun d’eux ne semble posséder la force suffisante lui permettant de vivre sans s’appuyer sur les autres. Car si «Le soleil / D’un dessin d’enfant / M’éclabousse / De lumière», le poème, lui, ne génère que trop peu d’échos.
Au long du recueil, la cousine Sylvie et la maîtresse d’école croisent Schubert et les hommes dans la rue tandis que les chats y errent à répétition sous un couvert de neige qui se dépose inlassablement, jusqu’à se congestionner parfois sur le même poème: «J’ai une fenêtre / Le soir la neige la lune / Une paix lovée en moi / Comme un chat». Les personnages, quant à eux, ne sont là qu’au détour d’un vers, ne sachant que traverser le poème; ils sont aussi éphémères que les lieux.
La mécanique utilisé par Julie Roy pour créer l’image se répète, laissant croire à un coffre à outils quelque peu dégarni. On doute «comme une sainte fatiguée», on s’endort «Comme un vieil / Oiseau», les faux cils courent «comme des araignées», «L’homme dans la rue / Comme une guenille», la bouette est jaune «comme sur une autre / Planète», en courant on fait un bruit d’enfer «Comme dans un manège» et la liste de comparaisons s’allonge au rythme des poèmes, amoindrissant à chaque coup l’effet des ressorts poétiques.
On progresse dans ce livre de Julie Roy de la même façon que dans un bois sans sentier: on y cherche des repères et tout est pourtant à la fois si identique et si différent qu’on peine parfois à se retrouver. Mais à quelques endroits, et on s’en étonne, certains poèmes s’extraient du lichen pour atteindre directement la canopée: «Les érables écrivent / Une sauvagerie verte / Que j’ai pas fini de lire». Ou encore:
Dans le couloir du métro
L’homme m’a insultée
Il m’a quêté de l’argent
Il m’a donné sa bénédiction
Et des larmes de Noël
Mais si ces vers polis semblent se cacher par-delà la cime des arbres ou au détour d’une chute clandestine, le lecteur doit entrer dans ce bois en se promettant d’en ressortir. Ce sera presque un jeu: une quête de perles trop peu nombreuses, dans un bois désenchanté en manque de lumière.♦