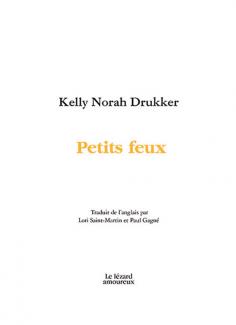Avec son premier recueil, l’Anglo-Montréalaise Kelly Norah Drukker nous offre une poésie insulaire qui cherche sans cesse la terre ferme.
Avec son premier recueil, l’Anglo-Montréalaise Kelly Norah Drukker nous offre une poésie insulaire qui cherche sans cesse la terre ferme.
Deux ans après la parution de Small Fires (McGill-Queen’s Universtiy Press), nous parvient la traduction au Lézard amoureux de ce recueil finaliste au Grand Prix du livre de Montréal en 2016. Quarante poèmes regroupés en cinq parties courant sur plus d’une centaine de pages constituent cet ouvrage d’une rare densité et d’une grande cohérence. Entre l’Irlande, la France et Montréal, Drukker laisse errer dans ses vers des héroïnes qui ne plient jamais l’échine devant vents, marées et paysage. Debout, le regard à l’horizon, cherchant parfois l’écho d’une réponse en toisant les étoiles, elles sont l’épicentre de ce livre hautement narratif où la forme du poème semble toujours se transformer pour servir l’histoire qui se dessine au détour des vers.
Un lieu autre
Sur Inis Mór, la première et la plus dense des parties, s’ouvre avec La traversée du ferry, long poème narratif annonçant l’isolement qui sera le nôtre dans les textes qui suivent. Inis Mór est la plus grande des îles d’Aran, archipel situé dans la baie irlandaise de Galway, à l’ouest du pays. L’annonce est sans appel: «À notre arrivée nous serons dans un lieu, ici nous sommes dans un autre.» Ce lieu est celui de Teampall Bheanáin où les toits des églises s’effondrent,la plage Cill Einne où deux prêtres se sont noyés — «la prière, un cri affamé/à l’instant précis où le monde/les dissolvait», autant de paysages qui rappellent l’importance de leur fixité: «[r]ien dans mes os qui ne connaissent pas ses collines.» C’est ainsi que tout l’édifice du recueil prend paradoxalement de la hauteur, en s’enracinant à même la terre. Car ce qui est clair, c’est que dans ce lieu autre, «personne ne te suivra jusqu’ici, personne ne frappera à ta porte.» On tangue toujours entre l’enracinement et la fuite, ne sachant jamais si le présent est la résultante d’un départ où les prémisses d’un exil. Mais à toutes les questions qui apparaissent, les réponses sont violentes: «[o]n ne rentre jamais chez soi. Le monde ancien glisse par à-coups, et se détourne.»
La deuxième partie est celle du départ. Courts et efficaces, les poèmes disent le récit de celle qui quitte le village, l’île, le pays, le continent. «Penchée sur le four de la cuisine je fais cuire le/pain dans la cuisine —/mes petits frères pendus/à mon tablier.» Si on rêve de chuchoter «emporte-moi» à une femme-océan, on ne sait jamais si la mer sera porteuse d’un nouveau départ ou d’une fin abrupte. Et ce n’est qu’au petit matin qu’on marche vers la mer, qu’on marche vers le port, qu’on marche vers l’ailleurs, qu’on quitte enfin: «Je suis sur le pont/montagne ensevelie sous les haillons/ni mère encore/ni tout à fait femme.» Il semble alors que tout peut commencer.
Multiplier la forme
Lorsque le recueil se transporte dans le sud de la France, dans la troisième partie, l’écriture se fait moins évocatrice, les paysages des Hautes-Pyrénées ne parvenant pas à prendre le dessus sur les vers, le décor semble soudain moins souverain qu’au début de l’ouvrage. À flanc de montagne et dans la chaleur des vignes, les images conviées sont celles d’un quotidien autarcique où les cierges vacillent, le brouillard s’installe et les laies sont sacrifiées. Et juste au moment où on craint l’essoufflement, Drukker signe peut-être l’une des plus belles suites du recueil, Les cagots, sur ces ouvriers longtemps persécutés sans raison dans la région. Le vers qui jusqu’ici était ample mais jamais prolixe, se retrouve ciselé, au mot près, flottant dans la page comme une apparition: «[I]ls fabriquaient/des tonneaux/pour le vin/des cercueils/pour les morts/bâtissaient/des églises/d’où ils étaient/exclus.»
Le travail de traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné est remarquable, leur expérience et leurs nombreux prix en traduction faisant foi de leur talent, car à aucun moment on ne lève le sourcil en se demandant si c’est bien l’image que Drukker voulait nous proposer. Poésie narrative ambitieuse et à long déploiement, Petits feux est un premier recueil qui sème plusieurs promesses. La dernière partie montréalaise, La maison incendiée, beaucoup plus intime, parvient à bien tisser ensemble les questions de filiation et de territoire chères à l’écrivaine, alors qu’on sent le texte beaucoup plus près d’elle. Cette fin rachète en quelque sorte le creux de vague de la partie centrale, moins forte que l’ouverture en Irlande. Si l’entreprise se fait parfois répétitive et qu’on souhaite retrouver les moments de grâce précédemment rencontrés, Petits feux demeure l’entrée en scène remarquable d’une voix qui ne craint d’ériger des poèmes ainsi que des ruines sur lesquelles le vent souffle comme un cantique. ♦