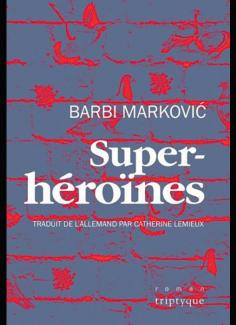Barbi Markovi propose un récit fantastique qui déjoue les représentations stéréotypées de la sorcellerie moderne et donne à voir une critique impitoyable de la vie urbaine à l’ère néolibérale.
Barbi Markovi propose un récit fantastique qui déjoue les représentations stéréotypées de la sorcellerie moderne et donne à voir une critique impitoyable de la vie urbaine à l’ère néolibérale.
Ces dernières années, les pratiques de sorcellerie semblent particulièrement au goût du jour. La popularité accrue du tarot, des voyantes, de l’astrologie et d’autres traditions ésotériques, ou encore le fort retentissement d’ouvrages comme Sorcières: la puissance invaincue des femmes (La Découverte, 2019) de la journaliste française Mona Chollet, témoignent bien de cet engouement. L’univers de Superhéroïnes, si on peut sans doute l’associer à cet effet de mode, n’a toutefois rien d’attendu. Ayant pour trame de fond une Vienne dépressionniste, le roman met en scène trois femmes immigrantes, chacune «née dans une capitale des pays pauvres voisins», qui se rencontrent hebdomadairement dans un café de quartier afin de mettre collectivement leurs «superpouvoirs» au profit d’un monde meilleur.
Chaque semaine, au terme d’un processus de décision démocratique, elles identifient une personne ou un petit groupe d’individus dont la situation leur paraît critique — par exemple des chômeurs susceptibles de ne jamais se retrouver d’emplois —, puis font appel à leurs pouvoirs magiques afin de leur offrir une aide. Les échanges entre les sorcières prennent parfois l’allure de dialogues philosophiques, où l’idéalisme optimiste de certaines est confronté au pessimisme destructeur qu’inspire chez une de leur consœur l’omniprésence du racisme systémique et du capitalisme sauvage en Europe. Chaque décision découle d’un dilemme difficile, car si les trois sorcières sont affligées par l’état global du monde, leur champ d’action ne concerne que les cas individuels, leur magie «perdant exponentiellement de sa force lorsque la cible s’élargit».
La misère sous les panneaux lumineux
Ce récit fantastique traduit ainsi une véritable réflexion sur la précarité et la marginalité sociales. Le trio de superhéroïnes a peu à voir avec le cliché, souvent associé à la sorcellerie, d’une communauté secrète qui se rassemblerait en cachette dans des lieux reclus. Les protagonistes sont éminemment engagées dans le monde, parce que leur mission consiste à lutter contre les inégalités, mais aussi parce que leur posture socio-économique — leur pauvreté, leurs origines «étrangères» sur la base desquelles elles sont stigmatisées, leur statut de femme, vivant seule, — ne leur permet pas, justement, de se soustraire au tumulte et à l’hostilité des espaces publics. Elles développent une perception originale du monde et de ses maux au fil des conversations entendues dans des fast-foods où elles entrent se réchauffer, l’hiver, alors qu’elles n’ont pas de logements fixes, des scènes entrevues dans les commerces où elles travaillent et dans les rues où elles flânent.
L’originalité de l’écriture de Markovi tient d’ailleurs en partie à ses représentations expressives de la ville, dont elle accentue les travers jusqu’à créer des portraits aux allures dystopiques. La traductrice Catherine Lemieux décrit bien cette particularité figurative lorsqu’elle mentionne dans la préface que l’autrice «exagère souvent, mais ne fabule jamais», relevant «les manifestations grotesques» des lois pernicieuses qui régissent notre «monde mercantile». Dans l’univers de Superhéroïnes, les centres d’achats deviennent des zones coercitives où les gens dont la pauvreté n’est pas trop visible passent du temps à errer, «assaillis par la fatigue et la grippe» sans jamais avoir le droit de s’asseoir nulle part. La narration est entrecoupée de passages composés en gras qui juxtaposent des séries de slogans publicitaires, de messages de santé publique, d’annonces de soldes et de phrases qui semblent tirées de unes de journaux, créant un effet de cacophonie agressante. À travers de telles descriptions, l’environnement urbain paraît s’animer, mais cette sorte d’agentivité conférée aux lieux vient mettre en lumière, par contraste, la difficulté des gens qui y évoluent — surtout les plus démuni·es — à disposer de leur propre destin.
La fin des illusions
Markovi fait ainsi preuve d’un sens de l’ironie particulièrement réjouissant, qui s’attaque autant à la bien-pensance des milieux aisés viennois qu’à la culture consumériste qui prévaut dans les grandes villes. La fin du récit laisse voir un profond cynisme, auquel finissent par céder les sorcières. Abandonnant le projet d’améliorer le sort du monde par leurs enchantements ponctuels, elles utilisent pour la première fois leurs pouvoirs afin de changer leur propre condition et de rejoindre la classe moyenne bourgeoise, «à laquelle elles se sentaient appartenir de tout leur cœur, mais jamais de tout leur budget». Pour mettre fin à leur précarité économique, elles formulent le souhait de gagner beaucoup d’argent au casino, et dès que les chiffres commencent à se multiplier sur les écrans des machines à sous, le miracle opère: les femmes éprouvent un sentiment de soulagement instantané, perdent leurs facultés magiques et se rencontrent désormais dans les supermarchés pour magasiner ensemble des aliments de luxe et des produits de beauté. Au-delà de son caractère ludique, cette conclusion révèle une vision profondément matérialiste, lucide et pertinente des inégalités sociales, à l’opposé de perspectives plus libérales qui verraient dans les actes de subversion individuels des solutions substantielles. Le système contre lequel luttent les personnages de Superhéroïnes est indémontable, et ses écueils ne s’évitent pas grâce à des remèdes ancestraux et des potions magiques. ♦