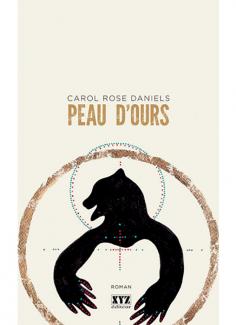De 1960 à 1980, le gouvernement canadien a retiré plus de 16000 enfants autochtones de leur foyer d’origine pour les confier à des familles «blanches».
De 1960 à 1980, le gouvernement canadien a retiré plus de 16000 enfants autochtones de leur foyer d’origine pour les confier à des familles «blanches».
On a appelé «rafle», Sixties Scoop en anglais, cet épisode honteux de l’histoire canadienne, et Sandy Pelly, l’héroïne de Peau d’ours, en a été une des victimes. Sa mère étant célibataire, les fonctionnaires fédéraux ne la considéraient pas en mesure de s’occuper convenablement d’un enfant. C’est ainsi que Sandy a été enlevée à son milieu dès sa naissance et adoptée par une famille ukrainienne qui l’a élevée avec amour. Si elle a eu ce genre de chance dans son malheur, on ne peut hélas pas en dire autant de tous les jeunes «placés» dans le cadre de ce projet: nombre d’entre eux ont été méprisés, voire traités comme des esclaves par ceux qui avaient pour mission d’en prendre soin.
En quête de ses origines
Écrit à la troisième personne, Peau d’ours retrace, avec quelques retours dans le passé, le parcours de Sandy à partir de ses débuts de journaliste jusqu’au jour où elle renoue avec ses origines. Pour ce faire, l’auteure privilégie presque toujours le point de vue de Sandy, sauf à quelques occasions où elle adopte celui de Blue, son amoureux. Ces passages sont à mon avis superflus, car trop rares pour qu’on parvienne à cerner le personnage.
Encouragée par sa famille d’adoption, particulièrement par sa Baba (sa grand-mère), Sandy est résolue à réussir sa vie. Elle suit un cours de journalisme et parvient à se faire embaucher comme reporter dans une station de télévision à Régina. C’est la première fois qu’une Autochtone accède à un tel poste. Pourtant, là encore, elle est en butte au racisme. Certains de ses collègues ricanent méchamment et l’accueillent par des sarcasmes et des wou-wou-wou — une façon un peu étrange de rendre ce prétendu cri de ralliement amérindien — à la première réunion lorsque, pleine de bonne volonté, elle propose de présenter un reportage sur un cours d’artisanat «conçu pour faire revivre la culture et les traditions amérindiennes parmi les femmes autochtones». «Ça intéresse personne, cette bullshit fleur bleue», la rabrouent-ils.
Quand l’histoire commence, Sandy se trouve dans un bar country où elle fait la connaissance de Blue, un policier métis dont elle tombe aussitôt follement amoureuse. Mais Sandy a un problème: l’alcool. Quand les choses vont mal, le vin et la vodka la réconfortent et c’est à ces «remèdes» qu’elle a recours lorsque Blue lui annonce qu’il a déjà une petite amie. Il reviendra pourtant et lui proposera d’aller vivre avec lui.
Saskatoon
Elle abandonne donc tout pour suivre Blue à Saskatoon où elle retrouve bientôt du travail dans une nouvelle station de télévision. C’est dans cette ville qu’elle fait la connaissance de Joe, un aîné amérindien sage — ex-alcoolique — qui la prend sous son aile, c’est là aussi qu’elle se lie d’amitié avec un caméraman, Kyle, qu’elle retrouve sa famille biologique, qu’elle fait des rêves prémonitoires peuplés d’ours, qu’elle s’évanouit à quelques reprises, qu’elle participe à son premier pow-wow. Mais quand son histoire d’amour avec le policier métis, qui se révélera lâche et veule, prend brutalement fin, le désespoir s’installe et l’alcool sert une fois de plus à panser les plaies de Sandy.
Un jour, Joe lui apprend que des jeunes filles autochtones sont violentées, parfois même tuées par des policiers blancs corrompus — la chose s’est vue au Québec aussi —, et Sandy décide de braver tous les dangers et d’enquêter. Pour ce faire, elle se déguise en prostituée, perruque rousse, minijupe rouge en latex, bustier blanc, cuissardes. Elle laissera presque sa peau dans l’aventure.
L’auteure, elle-même journaliste autochtone, a sans doute vécu des événements similaires, été l’objet d’insultes et de racisme (sinon elle en a été le témoin). Dans son roman, tous les méchants sont des Blancs, tous les Autochtones sont gentils, généreux, tous respectent la nature et les aînés. Bien qu’on comprenne la souffrance de ces derniers, un tel manichéisme crée chez le lecteur un sentiment de malaise.
Le roman est divisé en soixante-cinq courts chapitres d’une dizaine de pages au maximum auxquelles s’ajoutent à l’occasion des poèmes — peu convaincants. L’écriture est simple, descriptive, par moments laborieuse, à la limite de la banalité. Le texte est sans surprise, sans élan, et c’est en vain qu’on espère un moment d’éblouissement pendant la lecture. Ne l’ayant pas lu dans sa version originale, j’ignore si le problème vient de la traduction ou de l’écriture même. N’empêche qu’une révision plus rigoureuse aurait été souhaitable, car certaines tournures sont maladroites, «plouc d’habitant», par exemple, ou «il est plus jeune qu’attendu», et quelques malheureuses coquilles ont été oubliées. Cela ne fait pas pourtant de Peau d’ours un roman «minable», loin de là, ne serait-ce que par tout ce qu’il nous apprend sur les traditions et les valeurs des Premières Nations — nous les connaissons si mal. Mais, mis à part les deux scènes d’amour explicites (je les ai trouvées passablement clichés et, en fin de compte, plutôt inutiles), l’ensemble est tellement linéaire, prévisible que j’avais parfois l’impression de lire une œuvre pour la jeunesse. ♦