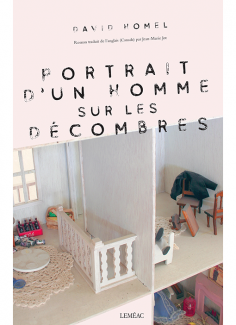Œuvre sur le vieillissement et les deuils qu’il entraîne, Portrait d’un homme sur les décombres rappelle que David Homel maîtrise un art du récit alliant la confession intime et les aléas de l’histoire.
Œuvre sur le vieillissement et les deuils qu’il entraîne, Portrait d’un homme sur les décombres rappelle que David Homel maîtrise un art du récit alliant la confession intime et les aléas de l’histoire.
David Homel est un cas singulier dans les lettres anglo-québécoises. Il circule activement entre les milieux anglophone et francophone, traduisant de nombreux auteurs du Québec, ayant longtemps tenu une chronique sur la littérature en traduction dans un quotidien montréalais. Son dernier roman, son huitième, paraît simultanément en anglais et en traduction française, signe que le public francophone compte pour une large part dans sa reconnaissance littéraire. Ce statut au seuil de deux corpus a ceci d’intéressant qu’il métaphorise des images, récurrentes dans son œuvre, de passages, de déplacements : frontières, voyages, exils, immigrations occupent une large place dans son écriture.
La balkanisation d’un père
Roman en deux parties, qui sont autant de jalons dans la léthargie que vit Phil Benner, Portrait d’un homme sur les décombres raconte la crise d’un journaliste sans contrat qui cherche à aider sa fille Dana, coupée du monde dans sa chambre où elle se consacre sans retenue à l’étude de la famine ukrainienne des années 1920. Son mariage avec Amy s’étiole et il pense trouver de nouveaux repères dans une liaison avec une patiente de la thérapeute qu’il consulte. La crise vécue par Phil est banale, quotidienne, reproductible, mais racontée en une voix omnisciente et extérieure, capable de se camper sur l’étroite route entre la distance ironique et la sincérité de la confession. Homel dissèque les pertes d’un homme, avec tendresse et gravité, dans un phrasé amalgamant l’autoréflexion d’un mari, qui veut s’en sortir et qui affronte ses échecs et ses deuils, et l’émotion que cette situation provoque chez le journaliste. Dans ces moments d’analyse, où la subjectivité de Phil devient le moteur pour écrire la vie ordinaire, Homel accède à une écriture proche de celle de l’écrivain américain Philip Roth (La pastorale américaine, Un homme).
Et comme chez Roth, l’intimité, pour Homel, est toujours en tension avec l’histoire, dans la mesure où les deux romanciers excellent à lier la trame personnelle aux sursauts des évènements politiques. Ainsi, deux frontières structurent le roman : l’une, privée — la porte de la chambre de Dana, que Phil ouvre constamment —, l’autre, géopolitique. En effet, la seconde partie du roman présente Phil en reportage en Serbie, où il couvre, accompagné de sa fille sortie pour l’occasion de sa chambre, la crise des réfugiés. Il est là-bas pour décrire l’accueil hospitalier des Serbes, eux qui avaient été du mauvais côté de l’histoire lors de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Si la réaction serbe à l’arrivée des réfugiés est vue comme une occasion pour ce peuple de se racheter, la présence de Dana aux côtés de Phil a la même vertu rédemptrice. Il résulte de cette partie, plus active, plus dynamique, avec des personnages forts, originaux, une cadence qui faisait défaut dans la première section. Homel semble alors reprendre là où il avait laissé avec son excellent L’analyste (Leméac/Actes Sud, 2003), consacré aussi aux Balkans. Il parvient à nous montrer comment les médias construisent des versions unilatérales des évènements historiques et comment le regard distancié, subjectif du récit peut redonner à des êtres, à des cultures, à des lieux un pouvoir de complexité et d’empathie.
L’être nostalgique
La crise que traverse Phil est détaillée et présentée à travers ses interactions avec quelques femmes, son épouse Amy, sa fille Dana, sa thérapeute, l’autre femme endeuillée avec qui il a un flirt. Un homme occupe pourtant une place importante pour lui : son ami Bruno, qu’il retrouve pour boire et discuter. C’est dans ces moments que ressort le plus intensément une composante forte du roman, sa vision nostalgique. Si le titre réfère à une image obsessive qui hante le journaliste, celle d’un enfant au sommet d’un dépotoir urbain en Russie, elle évoque aussi la figure de la réminiscence. Le regard ainsi porté sur le passé est marqué par le deuil, par la perte, dont l’une des trames est celle du langage : la capacité à nommer les choses se délite, le politiquement correct envahit tout, l’ironie et la critique sont dorénavant vues comme des prises de paroles offensantes. Ce type de discours chagrins, comme ceux tenus sur l’appropriation culturelle et la société des identités, est répété inlassablement par Phil, signalant l’amertume du regard posé, mais aussi une lecture de l’actualité où une part de liberté aurait été dilapidée. L’être nostalgique ainsi présenté ne pourrait pas échapper à sa crise, pris dans une vision des choses marquée par la désuétude. Heureusement, le récit oppose à cette vision la deuxième amitié masculine de Phil, celle de son traducteur serbe, plus acerbe, narquois, qui lui fait voir d’autres lectures du contemporain. C’est alors que le roman échappe au jugement et à l’exclusion qui en découle, et qu’il devient une perspective pour passer outre certaines frontières qu’on érige en soi. Avec ce nouveau titre, Homel approfondit un réalisme distancié qu’on retrouvait dans Un singe à Moscou (Leméac/Actes Sud, 1995) et qui est rafraichissant dans le paysage littéraire québécois, peu porté sur ce type d’observation. ♦