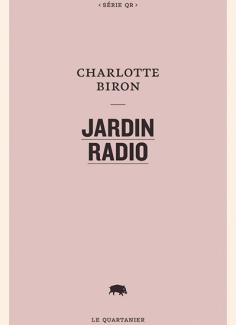Jardin radio n’est pas un miroir que l’on promène le long d’une route, mais un magnétophone.
En écoutant un balado sur Nietzsche, j’apprends que le philosophe a réfléchi à la valeur positive de l’oubli. Il conçoit que certaines choses qui échappent à la vie consciente sont rendues inconscientes, puis incorporées à la vie du corps. Il donne en exemple les grandes fonctions organiques qui agissent malgré nous, à notre insu. Parmi celles-ci, il s’attache à la digestion, qu’il utilise comme une métaphore de ce travail de l’oubli. Tout à coup me revient en tête une phrase de Jardin radio, de Charlotte Biron1, qui écrit à propos de l’œuvre sonore de l’artiste Honor Eastly:
Elle capte sa voix, ses gémissements, ses larmes, ses pensées, elle retient les sons et les idées qui naissent durant les jours où elle pense mourir et elle les confie à un microphone qui les mange, qui les digère et qui les répète sans pudeur à un producteur radio.
Avaler/être avalée
Cette phrase recèle les préoccupations qui conduisent le récit de Biron, lequela à voir avec un désir d’enregistrer la réalité d’un corps que le langage et la raison ne parviennent pas à saisir avec justesse. Atteinte d’une tumeur à la mâchoire, soumise à plusieurs interventions chirurgicales sur une période de quatre ans, l’autrice rend compte du cours d’une vie qui soudain dévie lorsque les forces organiques prennent momentanément le dessus. Comme sidérée, mais aussi terrifiée par ce que son corps et son quotidien sont en train de devenir, la narratrice de Jardin radio s’engage à trouver le bon moyen de médiatiser (de digérer) la maladie: «je m’efforce de retrouver mes carnets, j’essaie d’être fidèle au déroulement de la maladie, je tente de recréer de petites fictions sur le ruban du temps, je le dévide, méticuleuse, mais les événements les ravalent, les événements n’en ont rien à faire des petites fictions». Méticuleux: s’il est un mot pour qualifier le style de Biron, ce pourrait être celui-là. On admirera en effet l’élégance et l’attention (au sens de soin et de concentration appliquée) avec lesquelles elle tente de «parler de ce qui nous empêche de parler».
Aux prises avec cette apparente impossibilité, le récit se développe néanmoins en une enfilade de fragments nourris et animés par les paroles de divers·es artistes, penseur·ses et essayistes, lu·es ou entendu·es à la radio. Cette dernière devient un refuge pour celle qui n’a plus la force de travailler et est assignée à résidence dans une solitude la confinant à un état presque ensauvagé, «à côté du monde». Coupée de la vie sociale normale, la narratrice se tourne vers d’autres formes de réalités desquelles la maladie la rapproche: «Les cailloux que je garde sont aussi une promesse de mort, un rappel d’une autre durée, l’indice qu’il existe un autre temps.»; «J’aspire à une patience minérale.» Ainsi, les descriptions de chair découpée, ablatie, suturée mettent en écho des fréquences tout à coup amplifiées: «Les liquides me lèvent le cœur. […] Mes fantasmes deviennent des textures.» Orientée vers ce champ infraconscient, l’écriture de Biron met en relief cette part de notre condition organique.
«Une distance entre la phrase et moi»
Pour montrer mon appréciation de ce récit, et désireuse de mimer la démarche de l’autrice, je me garde d’employer un vocabulaire emphatique et des superlatifs. On pourrait très bien y faire appel, et c’est peut-être à ce type de réflexe que nous renvoie l’écrivaine, qui s’entête à demeurer au ras de l’existence, loin des tentations que nous offre la langue pour embellir, dramatiser, enjoliver la moindre expérience. C’est la banalité de ce qui continue de vivre malgré nous qui mobilise l’écriture de Biron. Celle-ci, attirée par le rêve de la représentation objective et flirtant parfois avec une esthétique documentaire, est tiraillée entre le refus de la métaphore, comme mise à distance du réel, et son inévitable recours, puisqu’elle semble essentielle à toute parole: «Pour entendre le temps qui passe et les jours qui se vident, il ne suffit pas de placer du blanc entre les blocs de mots, mais je n’ai pas trouvé d’autres moyens.» En effet, malgré l’insatisfaction devant l’impuissance du langage, les mots doivent être suffisants.
S’il «refuse la sublimation», Jardin radio n’échappe toutefois pas à la beauté que sa prose méthodique, presque neutre, nous présente. Cette beauté provient peut-être de ce qui fait œuvre, en dépit de la raison (celle de l’autrice? la nôtre?). La lecture devient alors, à son tour, une forme de digestion.
- 1. L’autrice collabore également au dossier du présent numéro.