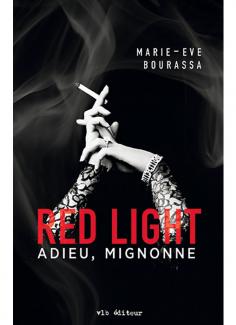Avec Red Light, sa trilogie policière et historique, Marie-Ève Bourassa fait des Années folles une toile complexe et captivante, où les gangs de rue se disputent une Montréal en rut, abandonnée par la police.
Avec Red Light, sa trilogie policière et historique, Marie-Ève Bourassa fait des Années folles une toile complexe et captivante, où les gangs de rue se disputent une Montréal en rut, abandonnée par la police.
«On n’était pas à Chicago, icitte, saint chrême, on n’était ben rien qu’à Montréal!» Il n’empêche que dans Red Light, les environs de la Main offrent aux noctambules des plaisirs pas trop catholiques. Des fumeries du Chinatown aux speakeasies des beaux quartiers, en passant par les maisons closes, quelque deux cent cinquante casinos clandestins (!) font le bonheur des pègres juive et italienne. Dans ces nuits parfumées au sexe et à l’alcool claudique le narrateur, un privé qui deviendra vite inoubliable: Eugène Duchamp. «Mais les gens m’appellent Gène. Ou "mon sacrament". C’est selon.»
Trompe-la-mort
Ancien policier ayant facilité l’arrestation d’un collègue «croche comme un vilebrequin», Duchamp s’est engagé dans le Royal 22e régiment pour fuir les représailles. La Grande Guerre s’est jetée sur lui, mais l’a recraché sur le champ de bataille de Passchendaele, d’où il a ramené une jambe inerte et des cauchemars de tranchées. Sa manie de fouiller là où il ne faut pas lui a fait perdre ses deux auriculaires. Bref, son corps est «une histoire bien triste», mais la canne à pommeau de tête de chien sur laquelle il s’appuie donne une allure de dandy à sa dégaine de vagabond. Abonné à la douleur chronique, il erre entre l’opium, la codéine et le cannabis — un cocktail qui le rend insomniaque, lui ouvrant les nuits interdites de Montréal. Perspicace, naïf et désabusé, il fréquente indifféremment toutes les bandes, dont il connaît les jargons et manières. Tant les policiers que les truands le fréquentent pour ses tuyaux, qui lui reviennent immanquablement à la figure, vu son talent pour se mettre dans le pétrin. «Ben pour dire, la seule personne que je voyais perpétrer une connerie du genre, c’était moi.» La voix de Duchamp donne beaucoup de légèreté à la narration de Red Light; et même dans les situations les plus inconfortables, le détective n’abandonnera jamais sa gouaille savoureuse: «Si t’es pour me faire subir ton haleine de cigare cheap, arrange-toi donc pour me dire quelque chose que j’sais pas, viarge!»
Adieu, Mignonne, le premier roman de la série, nous présente l’épave dans toute sa splendeur. Duchamp se relevant d’une beuverie dans un taudis du Chinatown, soigné par sa femme, la stoïque Pei-Shan aux petits pieds. Une jeune prostituée lui demande de retrouver le bébé qu’on lui a volé, la police n’ayant que faire des filles-mères. Comme ce sera le cas dans les deux romans qui suivront, tirer sur un fil initial en entraînera plusieurs autres, la visite des bordels comme des maisons bourgeoises révélant les combines des bandes rivales pour s’approprier le territoire. Frères d’infortune (tome 2) cherchera à percer un trafic de femmes qui ébranlera la ville jusque dans les clubs noirs de la Petite-Bourgogne, tandis que Le sentier des bêtes (tome 3) écumera les music-halls en déclin pour élucider le meurtre d’une danseuse. Les intrigues de Bourassa, tressées serrées, relient les différents milieux du Red Light, qui évoluent en arrière-plan, avant de revenir éclabousser l’enquête principale. Portée par un souffle et un sens du récit impressionnants, Bourassa organise une mosaïque de détails, dont le plus anodin s’avère parfois être un fusil de Tchekhov sous-estimé. Il faut ouvrir l’œil, et le bon, car la romancière aime visiblement se jouer de son lecteur.
Le piment du portrait et des dialogues
Comme dans un bon Dumas, l’intérêt des aventures et de la reconstitution historique repose sur une solide galerie de personnages, qui huilent l’engrenage ou y jettent du sable, selon leur quête de pouvoir ou leur besoin de survie. L’auteure a le sens du portrait, ses figures sont contrastées, jamais stéréotypées. Même les personnages tertiaires (par exemple, Marcelle, la prostituée altruiste et mal embouchée, ou Lee «Candy Man», qui tient la fumerie d’opium) ont leur passé, leurs talents, leurs manies, leur destin. Le lecteur suit leur évolution discrète d’un roman à l’autre, les regarde vieillir, au gré des épreuves ou des cartes bien jouées. Les méchants sont des manipulateurs qu’on voit rarement venir; cruels, ils infligent des blessures psychologiques raffinées, parfois pires que la mort. Duchamp a beau assez les connaître pour ne pas les sous-estimer, ils auront souvent trois coups d’avance sur lui.
Et c’est là où cela se complique. Rien de plus vulnérable qu’un détective amoureux d’une femme ou attaché à un ami. Toute sanglante puisse-t-elle être, la trilogie Red Light est une histoire de liens, et sur ce chapitre, Duchamp est bien malchanceux. La femme de sa vie, Lilian, alias «Mignonne», est fidèle dans l’inconstance: égocentrique, résiliente, furieusement indépendante, elle prend un malin plaisir à épouser les mauvais types sans jamais cesser de fréquenter le lit de Duchamp. Dans les premier et troisième volets, Duchamp s’inquiétera de la retrouver dans les casinos ou cabarets des voyous qu’il file.
Le deuxième tome, Frères d’infortune, repose quant à lui sur l’amitié, tantôt comique, tantôt poignante, entre Eugène et son ancien collègue, Edgar Beaudry. «L’inspecteur Beaudry n’avait malheureusement jamais été particulièrement doué pour se faire des amis: il était donc tout naturel qu’il vienne frapper à ma porte […]». Élégant dans sa mise, vulgaire dans l’invective, «le beau merle» avance comme Duchamp sur le mince fil entre le bien et le mal: «Beaudry et moi, on faisait une saprée belle paire de trimpes.» Même si Duchamp et lui travaillent séparément, sans nécessairement se révéler leurs découvertes, ils finissent par se retrouver au même endroit au même moment, ce qui les exaspère. Car aucun des deux n’arrive à supporter l’autre, encore moins à s’en passer, ils n’ont pas le choix de s’endurer — ce qui donne lieu à d’amusants échanges acidulés:
— Tu vas finir passé dans une ruelle, j’te dis.
— Oh! wow. Pis ça, ça vient du gars qui vit chaque jour comme s’il attendait juste de crever.
Les dialogues donnent beaucoup de couleur à Red Light, révélant des caractères bien campés, imparfaits, libres — si vivants.
Ode à Montréal
Le plaisir du lecteur ne fait pas honneur au travail de l’auteure, dont les heures passées à peaufiner son plan, ses personnages — et surtout, sa recherche minutieuse — disparaissent au profit d’une narration fluide, aux ambiances cinématographiques. À croire que Bourassa, après avoir vécu les Années folles, s’est téléportée jusqu’à nous pour raconter ce qu’elle y a vécu.
«Les Roaring Twenties avaient donné naissance aux Dirty Thirties, et les gens faisaient de leur mieux pour survivre, ce qui signifiait trop souvent s’adonner au pire.» La voix de Duchamp est forte, parfois lyrique, sans épanchement. De l’après-guerre à l’après-crise, Montréal se trémousse sur des airs de jazz, de blues ou de ragtime, auxquels se mêlent les chansons de la Bolduc. La ségrégation entre Blancs et Noirs (personne ne s’intéresse aux Chinois) se manifeste jusque dans les orchestres enfumés des clubs. Jack Johnson boxe contre Jim Jeffries, les femmes sont des «créatures», et dans la misogynie consensuelle, la psychanalyse pourchasse leur hystérie jusque dans les maisons closes. Dans La Patrie se lisent les descentes de police de la veille. La croisade de Pax Plante et de Jean Drapeau contre le crime organisé n’est pas encore un fantasme, la police est facile à corrompre: «Après tout, on s’habituait vite à avoir de l’argent dans les poches, et les billets sales ont toujours eu la particularité de se dépenser plus rapidement que ceux qu’on gagne honnêtement.»
Au fil de ses enquêtes, Eugène Duchamp écume une Montréal fascinante à revisiter: il questionne un porteur à la gare Windsor, séduit une catin de la haute au Mount Royal Hotel, accompagne des cambrioleurs à la Banque d’Hochelaga, assiste à un défilé dans les jardins victoriens du square Viger, rend visite à un médecin dans sa luxueuse demeure du Golden Square Mile… La romancière maîtrise l’ancienne carte jusque dans le fonctionnement des réseaux de transport. Les Taxi Diamond sillonnent une ville à la toponymie anglophone, en pleine expansion, dont certains tableaux champêtres font soupirer de nostalgie: «On est passés à côté des champs des Décarie, là où on cultivait les plus gros melons de Montréal.» L’opium, débarqué par bateaux dans les îles de Boucherville, préparé à l’île Jésus, est fumé dans la rue De La Gauchetière. Non, ce n’est pas Chicago. C’est chez nous, et ça fait rêver.
Adieu, Mignonne a remporté le prix Arthur-Ellis 2017 du meilleur roman policier canadien en français, ainsi que le prix Jacques-Mayer 2016 de la Société du roman policier de Saint-Pacôme. Il ne s’agit certainement pas des derniers lauriers de Red Light, qui mérite d’être largement diffusé, même au-delà de nos frontières. La fine analyse de la société montréalaise n’a en effet rien à envier aux fresques bostoniennes de Dennis Lehane (Un pays à l’aube, 2009; Ils vivent la nuit, 2013; Ce monde disparu, 2016), où l’autopsie de la police et de la pègre, en exposant celles-ci dans leurs rouages, contradictions et porosités, donne la mesure d’un entre-deux-guerres féroce et aux abois, une américanité passionnante à explorer. Quant au personnage d’Eugène Duchamp, dont l’esprit, la frivolité et l’idéalisme désabusé fondent en un seul homme Lupin, Gatsby et Sam Spade, il s’inscrit déjà comme l’un des plus attachants antihéros de notre répertoire. À lire la trilogie de Marie-Ève Bourassa, on se dit, avec un contentement chauvin, que notre littérature se porte bien. Et qu’elle est même florissante. ♦