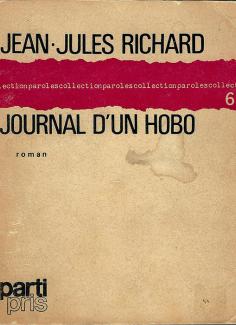Il y a près de trente ans, un collaborateur de Lettres québécoises, Patrick Imbert, dans sa chronique «Relecture», posait la question: «Connaissez-vous Jean-Jules Richard?» S’affairant à relever différentes omissions impensables dans la composition d’anthologies de la littérature québécoise, Imbert empoignait l’institution et la confrontait à ce qui s’apparente au paradoxe du fromage à trous.
Ce paradoxe, aussi appelé celui du gruyère, se résume à ceci: «plus il y a de fromage, plus il y a de trous, or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage, donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage». Remplacez «fromage» par «auteurs» et vous voyez où je veux en venir.
Doigtant allègrement les cratères de son Petit Québec, Imbert s’attardait à une pléiade d’envoyés ad patres, tout en braquant les projecteurs sur l’œuvre de Jean-Jules Richard, alors déjà en manque de lecteurs. «L’institution littéraire a […] quelque peu oublié Jean-Jules Richard et a canonisé des textes parfois moins travaillés, mais plus nettement liés à des envolées nationalistes», constatait-il.
Comme l’écho de ce genre de cris du cœur est rarement déclencheur d’avalanches, permettez que j’ambitionne de faire avancer le chariot de l’humanité en traitant d’une pépite qu’il serait temps de voir rééditée. Une proposition unique, en ce qu’elle constitue notamment le premier roman québécois à mettre en scène un narrateur hermaphrodite (un «berdache»): Journal d’un hobo, paru aux éditions Parti pris en 1965.
Jusqu’au dernier droit de la ligne du risque
Dans le corpus littéraire québécois, Jean-Jules Richard se taille une place de précurseur semblable à celle que René Bail occupe dans notre cinématographie. Autant par leur propos que par leur esthétique, les œuvres iconoclastes de ces deux hommes ont participé au décloisonnement de l’esprit et de la pratique d’une minorité d’individus de la génération qui les a suivis, et qui, elle, a radicalement transformé son champ d’action.
Annonçant la contre-culture des années 1960 et les productions joualisantes des parti-pristes, Jean-Jules Richard figure parmi ces romanciers dont l’œuvre donne l’impression que l’auteur a traîné l’histoire du Québec à la semelle de ses souliers, sans que cette histoire ne daigne jamais lui offrir la postérité en retour.
On se souvient surtout de lui pour Neuf jours de haine, l’un des rares romans de guerre québécois du milieu du XXe siècle. Un récit présentant neuf épisodes dans la vie de deux soldats canadiens-français (Noireau et Frisé) débarqués en Normandie le 6juin 1944, qui fut réédité en 1999 chez Bibliothèque québécoise (BQ).
La faute à Miron
Renvoyé du cours classique pour indiscipline, engagé volontairement durant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Jules Richard ajouta la «mécréance» à son pedigree lorsqu’il abjura officiellement, du temps où il se mit à fréquenter les hobos.
Il prit contact avec la littérature par l’entremise de Jean-Charles Harvey, au journal Le Jour, où il côtoya les Charles Hamel, Charles Doyon et autres Jean-Aubert Loranger. Malgré ses pérégrinations parmi ce cercle d’écrivains, aucune des publications de ses contemporains n’aura su anticiper le Journal d’un hobo.
À ce titre, le manuscrit de ce livre depuis longtemps épuisé fut refusé pratiquement partout. Expédié en France, il n’y trouva pas plus de lecteurs.
C’est finalement Gaston Miron qui en facilita la publication à Parti pris, après s’être enquis du manuscrit chez un éditeur parisien. Comme le confiait le principal intéressé à Réginald Martel, en 1972: «Il devait s’ennuyer à Paris, puisqu’il l’a lu. Et il l’a recommandé à Parti pris1.»
«De la Main aux montagnes Rocheuses»
Mettant en scène une figure qui prend progressivement des attributs christiques, le roman de Richard s’ouvre sur deux citations de l’apocryphe Évangile selon Thomas, qui renvoient à l’idée que le Royaume des cieux appartient à ceux qui se feront à la fois mâle et femelle.
S’attardant d’abord à l’enfance du narrateur, au sein d’une famille où «l’homme-père» fait office (pour une rare fois dans la littérature québécoise) de figure structurante, le Journal d’un hobo s’attarde également au mythe de la bispiritualité amérindienne, par l’entremise d’un sorcier micmac. Une improbable convocation qui sert de deuxième figure structurante à ce voyage débauché et violent à travers les bordels et les premiers grands remous du mouvement ouvrier du siècle dernier.
«Un roman cochon pour un gros monsieur du Parlement»
Victor-Laurent Tremblay, un chercheur qui s’est intéressé aux représentations de la masculinité dans la littérature québécoise, souligne qu’avant les années 1950, bien que certains auteurs, comme Albert Laberge, Jean-Charles Harvey et Berthelot Brunet, aient abordé timidement la sexualité dans leurs œuvres, il n’y a pratiquement que le roman sadomasochiste et homosexuel Orage sur mon corps (1944), signé André Béland, qui ose traiter ouvertement de sexualité.
L’un des premiers ouvrages à s’attaquer à la morale puritaine de son temps, le Journal d’un hobo prend cependant un tout autre sens lorsqu’on s’attarde à sa genèse.
Employé à la librairie d’Henri Tranquille, où il travailla un moment avec Jean-Paul Mousseau, Jean-Jules Richard pondit la première mouture du Journal d’un hobo après qu’un professeur de lettres de l’Université Laval lui eut commandé un «roman cochon», pour le compte d’un «gros monsieur du Parlement», avait-il confié à Réginal Martel.
On saura donc gré à un politicien en manque d’imagination d’avoir été à l’origine du premier roman québécois se rapprochant des œuvres de bourlingueurs américains comme Jack Black (You Can’t Win, 1926), Jim Tully (Beggars of Life, 1924) et Jack London (The Road, 1907). Des œuvres qui, à l’inverse de celle de Richard, ont pu trouver et renouveler leurs publics et leurs ambassadeurs au fil des décennies.
Décédé dix ans après la publication du Journal d’un hobo, Jean-Jules Richard n’aura pas vécu assez longtemps pour constater le sens prophétique que l’on aurait pu donner à cette confidence faite à la revue Liberté en 1972: «J’ai toujours été rare! Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait vingt ans d’avance.»
Quand on repense à l’émergence du journal militant montréalais Le Berdache, publié par l’Association pour les droits de la communauté gaie du Québec, au tournant des années 1980, et à l’intérêt que suscite par les temps qui courent le travail sur les identités sexuelles dans la littérature, on ne peut que se dire que le vieux maudit avait raison. Souhaitons seulement que la rareté du propos de cet auteur négligé cesse d’être en corrélation parfaite avec la disponibilité de son œuvre.♦
- 1. Réginald Martel, «Jean-Jules Richard au présent», Liberté, vol. 14, n° 3, juillet 1972, p. 40-52.