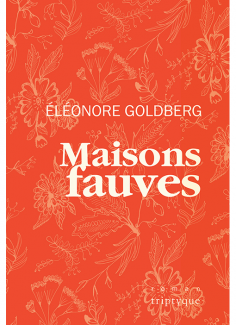Dans Maisons fauves, son premier roman, Éléonore Goldberg se lance dans une entreprise de remémoration aux envergures presque proustiennes.
Dans Maisons fauves, son premier roman, Éléonore Goldberg se lance dans une entreprise de remémoration aux envergures presque proustiennes.
Près de la Recherche, le texte l’est par son travail de restitution, mais aussi par la posture énonciative qu’adopte la voix qui raconte. Ici, cependant, les madeleines sont multiples, puisque ce sont les maisons successives habitées par l’autrice qui modulent et découpent la logique de l’anamnèse (en opposition à l’amnésie).
Comme la Recherche aussi, le texte est présenté tel un roman, bien que sa structure et son propos n’en rappellent pas moins le récit biographique. Cette appartenance générique n’implique pas une obligation de multiplier les recoupements entre l’ouvrage et le vécu supposé de l’autrice, mais elle impose plutôt un rythme, un souffle et un rapport à la mémoire qui, en plus d’évoquer Proust, nous fait aussi songer aux ruses nocturnes de la Persane Schéhérazade. « Lorsque j’aurais terminé, tu aurais toujours les yeux ouverts, tu m’aurais écouté toute la nuit », suppose celle qui se confie à un interlocuteur anonyme sur le mode d’une longue hypothèse : c’est que la narratrice, assimilable ou non à l’autrice, sait qu’« il y a une princesse de la nuit en [elle] ».
Mille et une maisons
Dès l’abord, une analogie forte se tisse : le corps et les maisons d’antan sont présentés comme des espaces à dompter, et l’exercice complexe d’habiter l’un ne peut s’effectuer qu’en apprivoisant les autres. Car apprendre à se tenir dans sa chair comme dans sa demeure, cela ne va pas de soi et ne se déroule pas sans heurt : « Au fond, le chez-soi se résume à ceux que l’on aime et à notre corps. Mon corps est une maison en ruine. » C’est toute une pensée du corps meurtri qui trouve ses échos dans les planchers bancals, les salles de bain moisies, les murs trop minces ou les pièces étroites pour celle qui « demeure dans la crainte ».
Ainsi se déploie un inventaire des logis, mais aussi des blessures, des cicatrices qui ont marqué la peau : les griffures des chats, les otites chroniques, les crises d’asthme, la croissance des seins, le trouble alimentaire de l’adolescence, l’apparition et la disparition des règles, la grossesse sont comme autant d’entailles qui, sur les cadres de porte des domiciles familiaux, servent à mesurer la chair qui croît. Or, cette dernière persiste à être tantôt « de trop » (comme dans l’appartement de Verdun), tantôt « pas assez » (c’est le cas à Orléans), toujours en surplus ou en carence de sa propre présence au monde.
S’arpenter
L’écriture s’apparente alors à un rite d’apprentissage au cours duquel sont investis ces deux ordres d’espace, qu’il a été si difficile d’habiter, et que le souvenir parvient à ressaisir, à revisiter, comme une autre modalité de l’occupation des lieux. Dans cette tentative, plusieurs stratégies d’arpentage sont déployées : les plans à vol d’oiseau qui parsèment les pages sont comme autant de cartographies de la mémoire, donnant séjour au souvenir. La longue succession des chats domestiques constitue une constante rassurante, presque autant que l’évocation de certains films, qui ont laissé une empreinte significative sur l’esprit. Toutes ces tactiques interrogent le même mystère, dont l’élucidation persiste à être constamment différée : « S’incarner… comment fait-on ? »
Longtemps je me suis couchée
Mais si l’épouse des Mille et une nuits cherchait à différer sa mise à mort par le long fil de ses histoires interrompues, quel destin funeste, alors, essaie-t-on ici d’esquiver ? Peut-être est-ce celui du souvenir condamné à l’essoufflement : « Tous mes souvenirs s’entremêlent. Je ne sais plus ce qui est arrivé et quand », « [j]’oublie les détails et la chronologie », confesse celle qui aspire à « [r]etrouver les traces perdues ».
Dans ce processus de reconquête semble s’estomper l’adéquation entre corps et maison au profit de celle qui se dessine entre texte et asile : « Je collecte les morceaux [de souvenir] qui émergent pour les mettre en tas. Je me recueille. » Dans ce choix de verbe, il faut entendre à la fois cette capacité de récolter et celle d’héberger, voire celle, pronominale, de se recueillir, mais il faut aussi être sensible à l’idée de recueil, au sens anthologique du terme, qui semble les lier toutes. Car c’est finalement par le recours à cette forme du recu(ei)l que se bâtit l’ultime logis dans lequel les débris du passé trouvent droit de cité. « Mon corps est un royaume dans lequel je suis lion », écrit la narratrice : une maison fauve où cohabitent la bête et son dompteur. C’est en ce sens que le texte devient la seule demeure possible, où corps et maisons peuvent enfin venir se lover, souverains. ♦