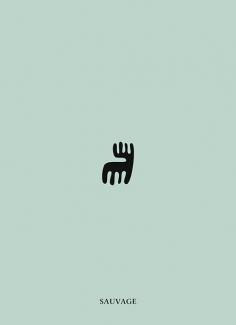Primoromancier français, Baptiste Thery-Guilbert frappe fort avec Pas dire, un excellent roman qui s’ajoute à la collection «Sauvage» d’Annika Parance Éditeur.
Primoromancier français, Baptiste Thery-Guilbert frappe fort avec Pas dire, un excellent roman qui s’ajoute à la collection «Sauvage» d’Annika Parance Éditeur.
«Du plus récent au plus ancien c’est logique. Commencez par la fin si la chronologie vous est importante.» Dès le début du livre, les lecteur·rices sont plongé·es in medias res dans «une déflagration», «[u]n monde qui s’écroule», une passion dévorante qui a laissé le narrateur meurtri, exsangue. Il remonte petit à petit aux origines de cet amour dévastateur, livrant au passage ses pensées intimes et inavouables. La structure inversée de l’œuvre est totalement maîtrisée, l’auteur privilégiant l’esthétique du fragment, bien adaptée au propos, et procédant par touches impressionnistes: l’accumulation de brefs segments permet de reconstituer la désagrégation de cette relation.
Passion simple
Pas dire présente la France grise des années 1980 et 1990, marquées par le marasme politique et la crise du sida. Fuyant son frère dépressif et ses parents envahissants, le narrateur mène une existence morne à Paris, où il multiplie les rencontres sexuelles anonymes. Mathieu et Hervé – écrivain et sorte de double fictionnel de l’auteur Hervé Guibert – sont ses seuls remparts contre la solitude, jusqu’au jour où il entame une relation avec un protagoniste jamais nommé: son prénom est caviardé (il est toujours recouvert d’une bande noire), comme si «[d]ire la vérité serait mentir».
Subjugué par cet être innommable, «ses épaules blanches, ses grains de beauté partout, ce petit buste si plat et limpide» et «l’empreinte qu[e] laiss[e] son corps sur les draps», le narrateur entreprend une «étude archéologique de sa peau», laissant libre cours à ses désirs les plus fous. Progressivement, il devient amoureux de cet homme dont il ne connaît que le corps et les façons de le faire jouir: «J’apprends que les nuits s’étirent en sa compagnie. Que le temps peut flotter.» En sa présence, il retrouve goût à la vie.
(Ne pas) s’accepter
Toutefois, l’amant en question n’accepte pas son homosexualité et ne veut surtout pas qu’on sache qu’il est «comme ça». Rongé par la culpabilité et la honte, «[u]ne loi d’autant plus cruelle qu’elle est implicite», écartelé entre son identité intrinsèque et un idéal de vie hétéronormatif imposé par sa famille, il se réfugie dans le paraître, les faux-semblants, les mensonges. Il est «[t]oujours en improvisation de son propre rôle» factice: celui d’un homme qui performe sa masculinité en regardant les mannequins dans les vitrines des magasins de lingerie; celui d’un homme qui utilise les femmes pour «que disparaisse […] son amour pour les hommes»; celui d’un homme qu’il n’est pas, mais qu’il aspire à devenir. Il essaie de se convaincre «que ce n’est que temporaire, cette histoire» avec le narrateur, pour qui le secret est trop lourd à porter. Ce dernier, excédé par le déni, l’aveuglement et la mauvaise foi de son partenaire, se venge et révèle la vérité aux membres de son entourage: «Il a toujours tenté de me faire croire autre chose que ce qu’il s’était réellement passé. C’est à son tour de se prendre la réalité en pleine gueule.» Dès lors, le lien qui unissait les deux personnages s’étiole, s’effrite, pour laisser place à l’ennui, au vide, à la solitude mortifère.
Au fil des fragments, l’auteur expose les mécanismes de l’homophobie intériorisée: la peur du jugement, la haine ainsi que le dégoût de soi et des autres homosexuels, la violence verbale et physique, la dépossession. Il renouvelle le discours sur le sujet – loin d’être inédit – grâce à ses phrases tels «des pics à glace» ainsi qu’à son étonnante et admirable économie de moyens:
Il me raconte qu’enfant il vivait encore en Saône-et-Loire, et que sa tante avait surpris son cousin en train de sodomiser un jeune agent d’entretien du lycée où il allait. L’employé avait été viré. Et le cousin défenestré une semaine après.
Le style direct, objectif et parfois oralisant du romancier m’a rappelé, pour mon plus grand plaisir, l’écriture sèche, lapidaire et limpide d’Annie Ernaux.
Le dire, l’écrire
À l’instar de l’autrice de La place (1983), Thery-Guilbert intègre à sa prose de nombreux et riches questionnements sur l’écriture. Ainsi peut-on lire, parmi tant d’autres passages qui portent à réfléchir: «Qu’est-ce qui vaut la peine de noircir une page, parfois un détail insignifiant pour les autres, il ne l’est pas pour moi, sinon je ne l’écrirais pas.» Ou encore: «Reste l’écriture lorsque la parole est interdite.» Oui, heureusement, il reste l’écriture quand la réalité fuit constamment. Elle autorise à tout dire. Toujours.