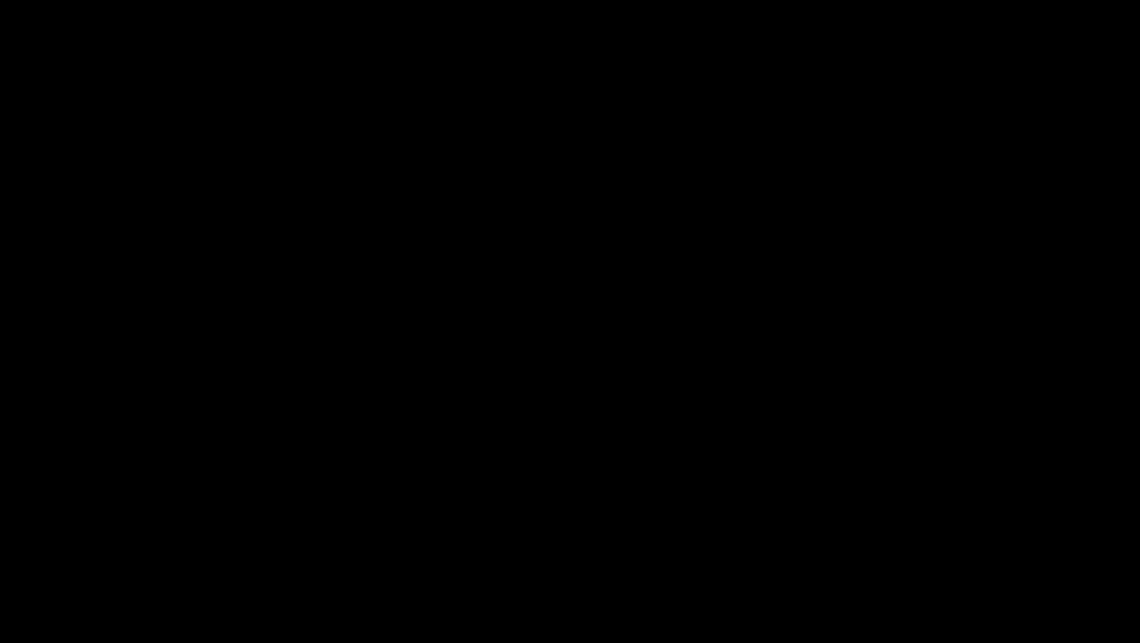
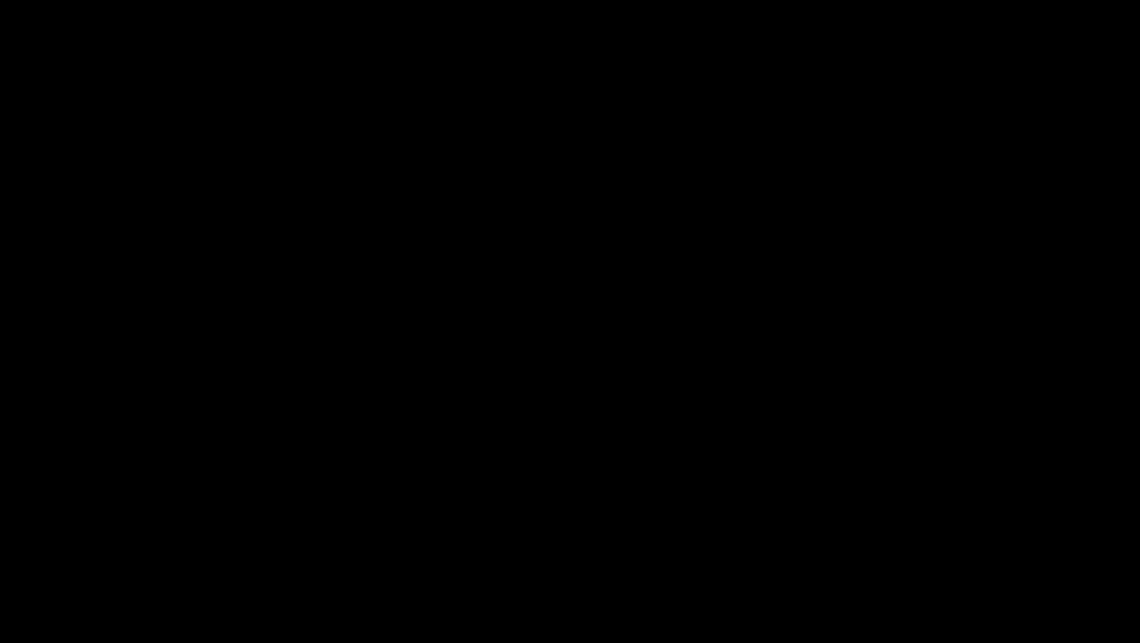
Dans ce premier roman, Jennifer Bélanger entremêle avec sobriété plusieurs thèmes qui résonnent avec pertinence : douleurs physiques, liens générationnels féminins et marginalité sociale.
La jeune narratrice de Menthol souffre de douleurs chroniques non circonscrites. Maigre source d’apaisement, l’huile essentielle de menthe poivrée qu’elle applique sur ses tempes, liniment dont émane un effluve devenu récurrent : « L’odeur est celle d’un corps abattu. » Ce relent de douleur est aussi celui de sa mère, du cancer maternel veillé à l’hôpital et des cigarettes mentholées, dont la fumée était soufflée à l’oreille de la narratrice lorsque, petite fille, elle souffrait d’otites à répétition. Ce parfum, par-delà les époques et les corps, l’amène à réévaluer sa relation avec sa mère – « ma mère était ma maladie » – et, plus loin encore dans le temps, les liens unissant les femmes de la famille : « Je comprends aujourd’hui que l’odeur âcre était là depuis plusieurs générations, qu’elle suivait les femmes de ma famille, des corps qui s’épuisaient plus vite que la moyenne des corps. » Bélanger explore une filiation féminine pleine de colère, minée par la maladie, la minorisation sociale et la violence masculine : « Le récit de ma mère s’écrit à partir du manque. »
Bouche
Menthol est un roman qui chemine du corps à l’amour; qui part d’expériences de souffrances immédiatement physiques, de celles qui abattent, abrutissent et isolent, du « désordre de [s]oi-même », pour tendre vers le besoin d’être aimé. À plusieurs reprises, la narratrice insiste sur la bouche de la mère engouffrant des cigarettes (bouche à laquelle il manque deux dents et qui n’a pas su dire les mots d’amour). L’orifice buccal devient le lien symbolique de deux femmes qui se ressemblent malgré elles : l’une dévore l’autre en lieu et place d’amour, la phagocyte, la « mentholise » et s’incruste comme un mal. Le mal-amour de ce récit ne s’éloigne jamais du corps. Le plus touchant, à la lecture, est de deviner l’amour de la mère, maladroit et sourd, qui parfois épouille sa fille; celle-ci ne conserve toutefois de ces moments de soin qu’un souvenir d’hygiène et de honte. Se dessine alors une équation en apparence évidente, mais aux soubassements mystérieux, reliant l’absence de mots à la douleur physique. La langue retenue et sobre de la narratrice fait écho au « cri de femme » ouvrant le livre et ayant « fissuré [la] mémoire en deux ». D’un côté, le cri; de l’autre, les paroles de qui peinent à comprendre, à dire et à réparer. Le texte hésite entre première et troisième personne, comme s’il n’arrivait pas à positionner l’instance narrative face à l’expérience, allant au-devant d’un inévitable déficit de sens.
Sens de la douleur
Le sens de la douleur apparaît comme l’un des enjeux principaux de Menthol. La maladie et la souffrance dépouillent les êtres. Elles impliquent certes un devoir de soin et un besoin d’histoire – dire l’histoire de la mère, l’histoire de la douleur –, mais elles mettent également l’existence à nue. J’ai personnellement été marqué par les mots de Deleuze qui, dans L’abécédaire de Gilles Deleuze, un documentaire produit par Pierre-André Boutang et tourné entre 1988 et 1989, affirme à Claire Parnet que les personnes âgées et les malades ne sont plus quelque chose, mais qu’ils « sont tout court ». Ainsi, que signifie « être tout court »? La vie fondée sur un mal? Si l’on n’est qu’« un être tout court » – et ceci, sous l’effet de la maladie et de la douleur –, quelles conclusions tirer de ce lien étroit entre être et douleur? Que la douleur est un étaiement de l’existence ? Que cette dernière repose sur la souffrance, ou qu’elle est graine de souffrance éclose en fleur d’existence? « Être tout court », dans la douleur ou la maladie, reviendrait à être une fleur sans pétales. Peut-on retirer à une telle création de la nature l’espoir d’un sens? « L’homme, l’animal le plus courageux et le plus exercé à souffrir, ne refuse pas la souffrance; il la veut, il la cherche même, pourvu qu’on lui montre le sens, le pourquoi de la souffrance », écrit Nietzsche dans La généalogie de la morale.
Le roman de Bélanger retient le sens de la douleur : il n’en donne que les pièces et le laisse à reconstituer. Il dresse le portrait d’une fleur sans pétales. La narratrice nomme la douleur de l’autre pour circonscrire la douleur de soi, pour dire « aime-moi », sans proposer d’au-delà significatif. En somme, Menthol repose sur l’absence de ces mots simples : « J’ai mal, aime-moi. » Ils demeurent ce qu’il y a peut-être de fondamental à dire quand le sens manque. Le livre met en scène une parole bloquée, limitée, un « monstre d’amour » pour qui le supplice du Christ – le parapluie métaphysique, la vieille réponse de l’Occident – n’est plus qu’un jeu de rôle à pratiquer pendant les récréations. L’œuvre tiraille, interroge et se résume à une plainte inaboutie; à une expérience narrative qui ne joue pas la gamme de l’agréable, refuse la transcendance et recèle un peu du mystère sans mots de la souffrance, comme certains insectes transportent un pollen dont naîtront de futures fleurs. À moins qu’ils ne s’égarent en terres stériles.


