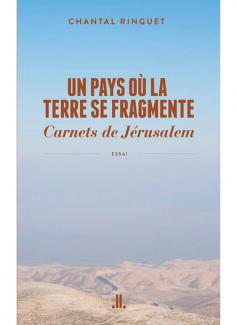La finesse de Vita Sackville-West quand elle écrit que le plaisir du voyage est le plus personnel qui soit. Son ironie quand elle ajoute qu’«il n’est de pire importun que celui qui vous conte ses voyages.»
La finesse de Vita Sackville-West quand elle écrit que le plaisir du voyage est le plus personnel qui soit. Son ironie quand elle ajoute qu’«il n’est de pire importun que celui qui vous conte ses voyages.»
J’ai passé tout le printemps en compagnie de Vita Sackville-West et de ses récits de voyage. Un plaisir qui a commencé avec Passenger to Teheran (1926), traduit par Une Anglaise en Orient, et dont les premières phrases m’avaient tout de suite conquise. «There is no greater bore than the travel bore.» C’était une boutade qui semblait prometteuse puisque, sans détour, Sackville-West annonçait les pièges du genre auquel appartenait son récit. Souriant, je me rappelais la lettre que Virginia Woolf lui avait envoyée pour lui confier que son manuscrit était «awfully good» et qu’il y avait là quelque chose d’infiniment romantique.
L’idée derrière les Carnets de Jérusalem rejoint celle de pousser le voyage au-delà de lui-même. D’y faire voir autre chose que les chemins empruntés et les découvertes culinaires. De ne pas mentionner les aléas du temps sinon pour en évoquer les tempêtes imaginaires, les grandes solitudes qui naissent parfois sous le soleil trop fort et le bruit des foules. Et pourtant...
Au tour des femmes
Avec un exergue d’Hélène Cixous tiré de Correspondance avec le Mur, une note qui promet au lecteur un récit en contre-chants inspiré de l’Iliade et de l’Odyssée — cette forme qui «fait allusion au contrepoint, une forme d’écriture musicale datant de la Renaissance et où se superposent plusieurs lignes mélodiques» —, une référence éloquente à L’Érouv de Jérusalem (1996) de Sophie Calle, il est difficile de ne pas vouloir avancer en ce Pays où la terre se fragmente comme on le fait dans la mer. La peur du courant qui s’oublie et fait place à quelque chose de plus grand encore, d’étrangement familier.
«Nous irons là où les mots se bousculent où les sons s’entre-choquent, où les écritures se déploient, tandis que sur la place publique règne un tumulte incessant, souvent déguisé en joie de vivre.» Chantal Ringuet évoque l’harmonie d’un chœur d’écrivaines, de voyageuses et de citoyennes du Proche-Orient dont les voix «secondaires» viendraient accompagner la sienne. Elle se dit guide, «Artémis des temps modernes», et nous demande de la suivre, de «scruter» avec elle «les écritures qui s’imbriquent les unes aux autres, formant des strates où se juxtaposent les influences et les courants qui reflètent des croisements de sens dans le corps de la ville et au-delà.» À la fin d’un préambule qui mime bien la voracité des débuts, la déambulation propre au voyage, Ringuet écrit qu’«[i]l est temps d’y parvenir, avant d’affronter le Déluge.»
Par-delà les anecdotes
Les promesses sont grandes. Et le sens du jeu et de l’érotisme, indéniable. Mais le ton a quelque chose de radiophonique. Moins à cause de l’alternance entre des passages plus méditatifs et les descriptions plus triviales, que par certains dialogues qui tombent à plat et des anecdotes qui provoquent parfois un profond malaise. Je pense notamment à l’épisode de la robe rouge qui, servant à dénoncer une certaine misogynie ambiante en reproduit exactement le mécanisme. Je pense aussi à l’apparition subtile, mais ponctuelle, du «compagnon» de la narratrice qui brise la bulle promise du début quand elle annonçait justement, sous l’armure d’Artémis, qu’elle «caracole[rait] dans les sentiers obscurs» et «s’élancer[ait] vers la source lumineuse de la connaissance universelle.» En lisant qu’elle «par[tait] de [son] plein gré, maudissant sur [son] passage les hommes et les êtres inférieurs qui croient que les femmes sont dangereuses lorsqu’elles s’émancipent du territoire qui leur a été assigné depuis des siècles», je savourais doucement l’éventualité de son triomphe. D’avance, l’idée qu’il puisse exister une Artémis dans le monde parfois trop sérieux des recherches universitaires comblait mon enthousiasme.
Cela dit, malgré la fadeur des descriptions géographiques et des dialogues, les Carnets finissent par remonter, à retrouver leurs remous du début. Il y a ce passage, vers la fin, où face au mur, Ringuet évoque l’anéantissement qui l’habite. «Chaque regard qui se dirigeait vers le mur perdait immédiatement de sa contenance, car il se retrouvait une inquiétude primordiale [...] nous n’étions plus rien: ni voyageurs, ni chercheurs, ni étrangers.» C’est sur ce point de non-retour que nous laisse Ringuet, celui que signe le silence; ce petit vide qui se crée en soi au terme d’un voyage. «Il n’y avait pas de rires, de larmes ou de cris; pas de tirs non plus. Rien qu’une absence infinie. [...] Alors, j’ai compris: il me fallait écrire.»
Le désir de donner forme aux traversées est ce qui convainc chez Ringuet. Par les conversations qu’elle rapporte, comme autant de souvenirs et de secrets parfois, elle ne nous fait pas douter de l’honnêteté de sa démarche. Les correspondances et le sentiment d’étrangeté qui la suivent jusqu’à Montréal prouvent, finalement, que le temps du voyage peut être là où tout commence.♦