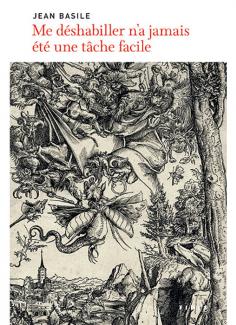En achevant la lecture d’un inachevé monumental, on est bien tenté d’admettre que «[...] finir” n’a aucune importance, que toute œuvre, aussi parfaite d’apparence soit-elle, n’est jamais finie, car elle s’enlise dans le néant du silence où rien ne peut finir jamais [...]».
En achevant la lecture d’un inachevé monumental, on est bien tenté d’admettre que «[...] finir” n’a aucune importance, que toute œuvre, aussi parfaite d’apparence soit-elle, n’est jamais finie, car elle s’enlise dans le néant du silence où rien ne peut finir jamais [...]».
C’est exactement là le sentiment qui vient accabler le lecteur au sortir de Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, un voyage littéraire de près de huit cents pages, champ de bataille sublime où les mots et l’encre l’ont lourdement emporté sur les marges et la blancheur du papier. La locomotive du récit était pourtant bien lancée, la mécanique du style fonctionnait à merveille et les volutes qui suivaient l’équipée étaient crachées par une cheminée s’approvisionnant à la fournaise d’un génie rendu fantasque par l’opium. Seulement, au terme de la voie ferrée ne se trouvait qu’un immense désert dans lequel est venue s’ensabler l’une des fictions les plus prometteuses de la littérature québécoise. La lecture s’est arrêtée en catastrophe comme le coureur au bord d’un précipice jusqu’alors invisible. Une fois enlisé dans le néant du silence, il faut se retourner pour de nouveau entendre la prégnance des échos passés.
Le continent inconnu
Difficile de comprendre pourquoi Jean Basile, après avoir travaillé de 1984 à 1987 à ce qui aurait dû devenir son chef-d’oeuvre, a décidé de l’abandonner. À constater le niveau d’aboutissement de la partie émergée de l’iceberg, impossible de parler d’ébauche. On a plutôt l’intime conviction de se trouver en présence d’un manuscrit cent fois raturé, à classer au panthéon des œuvres inachevées. C’est là que repose L’homme sans qualité en une compagnie triée sur le volet. Rien à voir avec les pauvres pages que l’on essaie souvent de faire tenir entre une couverture et sa quatrième, de celles qu’un éditeur en manque d’espèces sonnantes et trébuchantes n’aurait jamais dû extirper d’un fond de tiroir poussiéreux. Heureusement, il y a amplement à lire dans ce que Basile nous a laissé.
Sous la plume d’un esthète vieillisant et dans un style éminement proustien, le narrateur de Me déshabiller... nous fait la chronique de l’homosexualité masculine dans le Montréal des années 1960. Fasciné par quatre hommes qui vivent leur homosexualité à une époque où la chose s’apparente à la recherche d’un contient inconnu, le dandy opiomane décide de se faire leur biographe. Remettons-nous en contexte et situons-nous dans ce Québec où il était encore possible à la reine d’Angleterre de déclarer que l’homosexualité n’existait pas. Un Québec où le couple homme-homme n’était pas encore devenu «quelque chose d’ennuyeusement cocasse» et où ce qui nous paraît normal aujourd’hui ne pouvait exister que dans la clandestinité.
Quatre hommes cardinaux
Ils sont donc quatre, ces archétypes auxquels nous allons attacher nos pas. D’abord Marcellin Gastineau, peintre-laideron condamné par son physique ingrat à se terrer hors du monde et à ne vivre son désir que comme un fantasme lancinant. Vient ensuite Isabel Müller à la rigueur toute allemande, fasciné par les uniformes et les «hommes de cuir», par ceux qui sont appelés à dominer ceux qui attendent de l’être. Adolphe von Klein, pour sa part, préfère les plus jeunes, désir inadmissible s’il en est un et qu’il cache derrière une culture classique qui le fait paraître charmant. Le quatuor est complété par Julien Perrot, journaliste et jouisseur impénitent, fils de bonne famille et peut-être celui des quatre qui aspire le plus à la normalité. À ces quatre hommes cardinaux, il faut ajouter un centre afin que la rose des vents soit complète. Ce centre, c’est Montréal, cette ville qui n’a pas encore pris la hauteur qu’on lui connaît aujourd’hui et que le narrateur n’hésite pas à qualifier de grand village. On y déambule en s’étonnant du chemin qu’elle a depuis lors parcouru, découvrant les débats qui l’agitaient et s’appuyant sur ce qui n’a pas changé pour s’orienter.
Il faut certes du souffle pour franchir la page d’arrivée d’un pavé aussi fourni. Mais pour qui aime les styles fleuris, chaque page sera teintée du singulier plaisir qu’il y a à contempler l’équilibre d’une phrase-paragraphe toute en arabesque. L’immense talent de Basile se trouve là, dans cette prodigieuse capacité à discourir, avec la même verve, d’un opéra de Wagner et d’un Perrier que l’on se fout au cul. C’est dans ce contraste entre sublime et grotesque — bien que les deux parfois se confondent — que réside la force de ce texte qui, même une fois ensablé, continue de nous habiter par la force de ses réflexions, par ses innombrables traits d’esprit, par la marge qu’il continue d’incarner et par cette célébration d’une homosexualité qui se sait différente et qui n’a pas peur de déployer la magnificence de ses «ailes vibrantes de velours noirs».♦