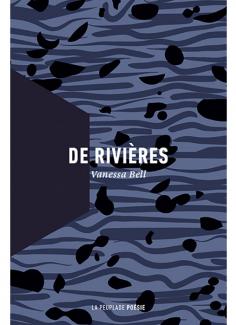Ce premier recueil confirme l’originalité de la voix féministe de Vanessa Bell, qui explore avec une intelligence sensible les topos de la nature et de la sororité.
Ce premier recueil confirme l’originalité de la voix féministe de Vanessa Bell, qui explore avec une intelligence sensible les topos de la nature et de la sororité.
Dans son introduction au recueil de textes écoféministes dont elle a dirigé la publication en 2016 aux éditions Cambourakis,
la philosophe française Émilie Hache explique que le terme reclaim, qui donne son titre à l’ouvrage et dont on trouve difficilement un équivalent français, est celui qui décrit le mieux la démarche des militantes écoféministes: «Il signifie tout à la fois réhabiliter […] quelque chose de détruit, de dévalorisé, et le modifier comme être modifié par cette réappropriation.» Les écoféministes proposent — à travers différentes perspectives, selon les courants et les écoles de pensée — de repenser nos rapports à la nature. Elles invitent à cesser de concevoir celle-ci comme une ressource à exploiter pour en reconnaître plutôt la diversité et la force immanente, à développer des modes d’être et de vivre qui respectent ses potentiels et à trouver une forme d’agentivité à travers cette revalorisation. Sans s’inscrire explicitement dans une perspective politique ou militante, la poésie de Vanessa Bell, par le rapport à la nature qu’elle investit, évoque, il me semble, une telle démarche de réappropriation.
Survivre à ce qui nous dépasse
De rivières laisse entendre une parole sensible, définie par une posture à la fois de vulnérabilité et de résistance. Les fleuves, les roches, les lacs, les montagnes, abondamment décrits et convoqués tout au long du recueil, n’ont rien de paisible ou de régénérateur. Dans cet imaginaire poétique, l’espace extérieur n’est pas un paysage à contempler: il sous-tend, plutôt, une puissance impossible à maîtriser, qui nous dépasse infiniment et nous ramène à notre propre faiblesse, un courant qui peut nous porter, mais aussi nous emporter. La quête existentielle qui se révèle au fil des brefs poèmes ne concerne pas l’atteinte d’une stabilité ou d’une paix intérieure; s’affirme au contraire le choix — ou peut-être la nécessité — pour vivre de s’exposer à une sorte de «violence du dehors». «[J]e construis ma maison à l’extérieur de ma bouche»; «je cours au carnage {il faut courir}/sachant qu’avec vous/mes chevilles se rompent»: l’œuvre regorge d’images qui disent bien un impossible recueillement, l’obligation de toujours se mettre en danger, de s’ouvrir à un univers parfois violent, de s’en imprégner pour continuer à avancer.
Dans son superbe recueil Chauffer le dehors, également publié à La Peuplade à l’hiver 2019, Marie-Andrée Gill évoque ses escapades en solitaire dans le bois, au lendemain d’une peine d’amour, et se décrit comme «pas tuable — pas grand-chose et totale», à la fois petite devant l’immensité du fjord et des forêts, mais forte de cette capacité à trouver son propre chemin au cœur de cette immensité. C’est un regard similaire sur la vie et sur le monde que pose ici Vanessa Bell: celui d’une femme qui se demande «combien de fois peut-on mourir/dans la même journée», mais qui, «dans un respir long comme le cœur», affirme sa force de résilience.
De l’indignation en héritage
L’œuvre s’ouvre sur deux séries de poèmes assez faibles par rapport à l’ensemble, avec des formulations plus absconses et la présence de syntagmes entre crochets — «si tu poses la question {je réponds}», par exemple —, qui, dans certains cas, brisent davantage le rythme du texte qu’ils n’étoffent son propos ou sa poétique. Des passages de ces premières parties empruntent parfois un ton plaintif: «quels mots mâches-tu/quand j’émiette le silence/les avions s’éteignent/et tu pars». Ce léger effet de complainte s’estompe dans les deux parties subséquentes pour laisser place à une colère assumée et cathartique, qu’on sent monter graduellement. La troisième série, intitulée «Grosse roche», presque entièrement adressée au «vous», à des «filles avortées», est constituée de vers particulièrement forts, construits pour la plupart comme des injonctions au travers desquelles est revendiqué le droit à un «féminisme imparfait», pour reprendre une expression éloquente de l’autrice. «[S]oyez mauvaises/rouez les gardiennes des pouponnières/incendiez les chevaux et les lacs/ne laissez personne en repos»: ce n’est pas une posture éthique qui est prônée ici, mais bien une révolte indomptable, faite de douleurs, de débordements et de désirs, une réappropriation sans balise de l’amour, de l’espace, de la parole.
Amorcé sur un ton plus intimiste, De rivières s’ouvre à une commu-nauté de résistances — celle de «toutes les femmes/dont nous sommes faites» —, à une forme de solidarité salvatrice dans un écosystème trop souvent hostile. ♦