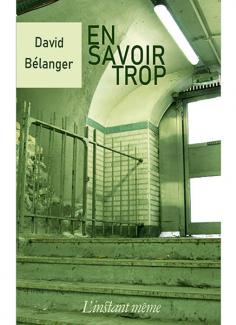Les nouvelles de Bélanger produisent l’effet qu’on espère obtenir d’un ensemble de textes: ils font recueil, brodent autour d’un thème commun pour en dévider les virtualités, en découdre avec une idée, un motif, dédaignent l’abord frontal pour multiplier les points d’entrée.
Les nouvelles de Bélanger produisent l’effet qu’on espère obtenir d’un ensemble de textes: ils font recueil, brodent autour d’un thème commun pour en dévider les virtualités, en découdre avec une idée, un motif, dédaignent l’abord frontal pour multiplier les points d’entrée.
Le leitmotiv, le titre nous le donne d’emblée: la locution en savoir trop évoque immédiatement le trope hitchcockien et, avec lui, une pléthore de références au film noir. Bélanger n’en fait d’ailleurs pas l’économie, dispersant ici un «il interprétait l’espion qui ne doit piper mot, si je te le dis, je devrai te tuer» («Les histoires»), là un «si je vous le dis, madame, il faudra vous tuer» («1h45»).
Mais le recueil dépeint aussi à plusieurs reprises un milieu académique envers lequel il n’est pas tendre… Car en savoir trop, c’est parfois réaliser que la surenchère de connaissances peut tourner à l’incommunicabilité. C’est le sort qui attend le spécialiste dont on n’écoute pas les avertissements parce qu’ils semblent trop alarmistes dans «L’espèce», mais également le lot de cette suppléante qui, dans «Peler la classe», réalise que «les sciences de l’éducation ne pouvaient rien contre le mutisme de la classe», ou encore de cette figure récurrente du chargé de cours déprimé (dépeint dans «Les Histoires», «Couve-effet», «1h45») qui ne pourra sauver son enfant d’un étrange trouble de la perception, d’un tremblement de terre ou encore de la mort, quelle que soit la quantité de thèses dont il effectue la relecture attentive.
Excédentaire
C’est qu’à l’université comme dans les polars, la surabondance d’informations revêt souvent un caractère mortifère, ne serait-ce que parce qu’elle condamne l’individu à la conscience de sa propre impuissance ou au désenchantement ordinaire. Des nouvelles telles que «La chasse aux dinosaures», laquelle rassemble de courts fragments ayant en commun de porter sur la merde — plus précisément sur la certitude que tous, de l’être cher aux plus hautes éminences intellectuelles, chient —, nous rappellent à quel point le cerveau cherche systématiquement à se prémunir de détails qui n’accommodent pas son désir de transcendance.
Or, on sait que les désagréments cognitifs qui assaillent aujourd’hui l’homo sapiens (dont le nom est d’ailleurs marqué du sceau de la sapience), du transit intestinal aux cataclysmes climatiques, ne manquent pas. L’individu est obligatoirement rivé à «la conviction, si simple pourtant, que nous mourrons […] et qu’il ne reste, pour nous raconter, qu’à déterminer dans quel ordre et selon quelles modalités»; paradoxalement, il se découvre contraint à l’exercice de sa propre amnésie, dont les défaillances l’«empêche[nt] d’apprécier [s]on histoire».
Fort-Da
«Quelle histoire pour celui qui lit des histoires?» Dans cette question que pose Bélanger, on pourrait remplacer l’indéfini des par le démonstratif ces. Car ce sont des craintes bien spécifiques que cerne concentriquement le recueil: «chaque matin qui nous trouve encore vivants», chacun se mesure à une actualité truffée de meurtres sordides, d’apocalypses imminentes, de théories du complot, d’alertes contre les dangers du plastique ou ceux de la surveillance étatique. Comment survivre à nos propres connaissances lorsqu’elles n’ont d’autre utilité que de hiérarchiser ces «combats que nous savons perdus d’avance»?
Certaines autres constantes apparaissent d’ailleurs, comme l’endossement de la narration par un homme, souvent père de famille, plus spécifiquement d’une très jeune fille, ou la survenue d’un drame — personnel, familial, collectif —, qui va de la séparation au rapt, en passant par le meurtre. Ces concordances pourraient pratiquement nous faire croire à une identité narrative fixe si la ronde fluctuante des prénoms ne nous indiquait pas le contraire.
Mais la répétition est moins, dans En savoir trop, un défaut de fabrication qu’une indication quant au patron sur lequel se modèle ce costume tissé d’angoisse. L’exergue, emprunté à Winnicott, sait bien nous le signaler: «Il y a des moments où un patient a besoin qu’on lui dise que l’effondrement dont la crainte mine sa vie a déjà eu lieu.» Dans le recueil s’articule alors un genre de Fort-Da freudien, cette répétition d’une activité génératrice de déplaisir visant à nous préparer à l’actualisation de l’épreuve. Dans cette réinterprétation du jeu de la bobine, l’écriture simule un drame non advenu, mais d’allure inéluctable — comme pour s’en prémunir, le conjurer en l’actant dans la fiction ou, à tout le moins, expurger cette éventualité désastreuse de son caractère le plus terrifiant: l’inintelligibilité. C’est qu’à la manière des épouvantails qui, pour les corbeaux, font office tantôt de repoussoirs, tantôt de perchoirs, l’angoisse symptomatique, les dérèglements du monde, les fantasmes de destruction violente et les scénarios macabres nous effraient autant qu’ils nous soutiennent, nous qui sommes «contraints de [nous] raconter une histoire atroce, juste assez esquissée pour être figurable». ♦