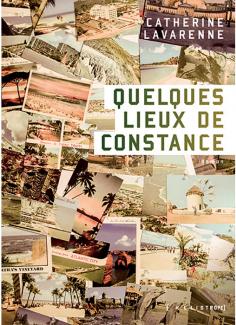Une femme revient à Montréal pour autoriser le débranchement fatal de sa mère et se remémore son enfance pour repousser, anticiper et contrecarrer le deuil.
Une femme revient à Montréal pour autoriser le débranchement fatal de sa mère et se remémore son enfance pour repousser, anticiper et contrecarrer le deuil.
Dans Quelques lieux de Constance, Catherine Lavarenne explore les méandres de l’attachement. Qu’est-ce que le lien filial? Qu’est-ce qui nous attache aux êtres et aux choses de notre enfance? Comment en sortir? Comment renouer avec le passé? Ce premier roman nuancé, sensible, mais qui butine trop de fleurs, s’organise autour d’une musicienne toujours sur la route aux États-Unis, Constance, de retour vingt ans plus tard, anxieuse, attentive et avec une conscience aiguë d’être déplacée, auprès de sa mère adoptive, hospitalisée et plongée dans un coma dont elle ne se remettra pas. Constance doit renouer avec son frère Sébastien pour signer les papiers autorisant le débranchement définitif.
Le récit tient dans cette période de latence entre l’arrivée et la signature, où les failles du passé s’ouvrent à nouveau, où la fuite, stratégie usuelle, n’est plus possible. L’écriture, qui se joue de l’ellipse, des images de l’intime, des photos comme des cartes postales opaques, construit, pas à pas, doucement, la trame de Constance. La mort de sa mère Madeleine comme un éclairage diffracté sur la jeunesse d’une femme solitaire, attirée par les départs.
Une structure défaillante
Le roman est structuré en trois parties, qui chacune insiste sur une dimension différente de l’anamnèse de Constance. D’abord, c’est à un repérage spatial que celle-ci occupe son temps, en parcourant les lieux significatifs de sa famille. De l’aéroport à l’hôpital en passant par la maison familiale, elle va affronter ses démons, comprendre le rôle de cette mère adoptive et de Sébastien, ami du primaire qui a tôt été choisi comme frère. Les lieux de mémoire parcourus la ramènent à sa mère biologique, Mitsy, chanteuse anglophone un peu fantasque, à ses recherches à l’adolescence pour la retrouver, à cette fuite éperdue dans l’État de New York pour cerner sa perte. Une telle errance a pour effet de différer ce qu’elle était venue faire à Montréal et la deuxième partie s’attarde sur ce délai volontaire, alors que Constance tisse des liens saugrenus mais forts avec une patiente inconnue qui lui permettra de raconter son histoire, ses désirs non avoués, ses gestes honteux.
Cette seconde partie capte un état de confidence généralisé à l’hôpital, une espèce de solidarité endeuillée, une sororité de la maladie, et c’est la partie la plus forte du roman, même si elle brouille la trame jusqu’alors exposée et la rend un peu caduque, parce qu’elle excentre les enjeux de la mort et de la famille. La troisième partie, axée sur Mitsy et sa collection de cartes postales expédiées par ses amants de passage, insiste sur la dérive familiale, sur la sensation de glissement qui est au cœur du regard de la musicienne.
Récit d’hôpital qui réussit à éviter, comme Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, les clichés de la médecine déshumanisante et des questions éthiques associées aux traitements de fin de vie, le roman de Lavarenne parvient à faire de ces chambres quelconques des espaces de dialogues, de confidences léguées précisément à des inconnues pour se libérer du poids de la mémoire. L’hôpital devient une chambre d’échos, où se répercutent des mémoires croisées, des correspondances entre les trajectoires individuelles, des images figées comme des cartes postales dont on aurait égaré la clé interprétative ou le souvenir de l’expéditeur. Le récit en perd certes sa cohérence, mais il gagne en humanité. La route de Constance vers la mort de Madeleine est alors jalonnée par le regard singulier de plusieurs malades, sensibles à ses hésitations, à son écoute et à ses confessions. Il est toutefois dommage que le personnage de Constance se délite un peu dans ce portrait, surtout habile à présenter Arielle et madame Padoie, deux vieilles femmes malades qui partagent une chambre fréquentée par la nomade.
Une histoire qui fugue
Si ce sentiment d’inconsistance — alors que le nom de la protagoniste devrait évoquer au contraire une certaine stabilité — se fait sentir, c’est que la relation actuelle à la mère adoptive et au frère est ravalée par le jeu sur la mémoire de l’enfance, si bien que celui-ci devient moins clair à mesure que la relation avec ses familles échappe à Constance. Et cela ne l’aide pas non plus à régler la question des origines. Constance ne se résigne pas à signer le document; elle repousse le moment, fréquente des patientes inconnues, sans mettre les mots sur ce qu’elle éprouve vis-à-vis de sa mère, dont la maladie devient alors davantage un prétexte pour revenir sur les lieux de l’enfance qu’un événement chargé de sens. Même si Lavarenne sait décrire les menues sensations éprouvées, même si elle a une capacité à faire surgir des images claires, un sentiment de perte accompagne le lecteur dans cette construction tripartite qui atténue constamment la trame principale, jusqu’à une conclusion bancale et décevante. ♦