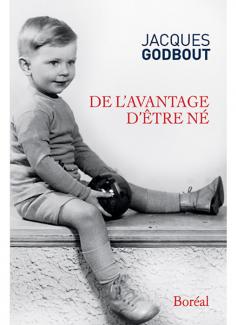L’autobiographie est un genre qui suppose un accord tacite de vérité entre l’auteur et le lecteur. Les mémoires de Jacques Godbout viennent travailler les limites de ce pacte implicite.
L’autobiographie est un genre qui suppose un accord tacite de vérité entre l’auteur et le lecteur. Les mémoires de Jacques Godbout viennent travailler les limites de ce pacte implicite.
Doug Archibald, philosophe sous-estimé et père d’un écrivain saguenéen à succès, a inventé — ou peut-être volé — une maxime qui s’applique merveilleusement bien à notre époque de confessions en ligne: «Si t’en parles, c’est que c’est pas vrai.» Vous essayerez de l’appliquer la prochaine fois que vous verrez passer sur Facebook la réplique formidable qu’a dite l’enfant de quelqu’un ou l’action si vertueuse qu’a posée un de vos «amis» des réseaux: s’ils en parlent, c’est que ce n’est probablement pas vrai. Le doute systématique est un baume sur notre vivre ensemble de plus en plus insupportable, surtout depuis que nous vivons tous les uns sur les autres virtuellement.
On aurait envie d’appliquer la même logique à la dernière (du moins, on l’imagine) autobiographie de Jacques Godbout intitulée De l’avantage d’être né et publiée au Boréal en mai dernier. Allez! Je vous jure que je n’ai pas inventé ce titre qui n’a rien pour redorer la réputation d’égocentrisme de Godbout. D’ailleurs, les mauvaises blagues pleuvaient au moment de la sortie du livre. «Jacques Godbout écrit enfin un livre sur le sujet qui lui tient le plus à cœur: lui-même», écrivait ailleurs une langue de vipère de ma connaissance numérique.
À triompher sans gloire…
Mais il n’y a rien de drôle à rire de Godbout tant c’est devenu facile. Le bougre a des habitudes un peu princières et on l’imagine souvent s’attribuer à lui-même l’avènement de la Révolution tranquille. Mais n’allons pas rigoler tout de suite, au risque de se faire taxer d’«âgisme» par le principal intéressé, comme ç’a été le cas de notre collègue lettres-québéciste, Jean-François Nadeau, à la page248 (c’est vrai qu’il l’est un peu, mais quand même).
Il y a, dans les faits, du plaisir à prendre en lisant l’autobiographie de Godbout. Pas tant pour le retour sur l’œuvre romanesque, dont on garde moins de souvenirs, que pour ses pérégrinations à l’ONF et le retour sur certains de ses meilleurs films comme L’affaire Norman William ou Alias William James. Godbout a été de tous les combats du monde culturel depuis les années 1960 et donne l’impression d’avoir connu et croisé tout le monde.
Bien sûr, certains passages gênent un peu, notamment lorsqu’il est question d’Haïti où «le vaudou, qui permet au peuple d’accepter ses souffrances, reste la raison profonde d’un manque d’initiatives politiques pour accéder au xxesiècle». D’autres moments, en Éthiopie, font franchement Tintin au Congo, comme quand il parle des «traits plus négroïdes» des Galas et du «type sémite, couleur chocolat au lait» des Amahras «doués pour l’administration», ou qu’il raconte comment il a abattu un babouin pour ajuster sa mire, mais il faut croire que tout cela était d’«époque» comme on se plaît souvent à le dire.
Godbout reste, qu’on le veuille ou non, un témoin privilégié de son temps qui a suivi de près la fin du duplessisme, l’arrivée de Lesage au pouvoir, la montée de l’indépendantisme dans un moment d’effervescence culturelle. Il a vu de près le développement de la littérature et du cinéma québécois, et de leur système subventionnaire, il a été au cœur de ce réseau de créateurs, mais quelques problèmes demeurent.
Capitaine Bonhomme
D’abord, comme l’annonce le titre de Godbout, ce livre est le compte rendu d’une vie de privilégié. Bien né, bien éduqué, chanceux comme un bossu, il en devient presque difficile de ne pas lui souhaiter ne serait-ce qu’un petit malheur. Jacques Godbout est de cette génération où ceux qui étaient de bonne extraction pouvaient tout avoir, et il ne se prive pas de nous le rappeler, passant de poste de cinéaste en poste de direction, filant des emplois à ses amis qui lui refilaient des contrats ensuite. Du point de vue d’une génération qui en arrache au xxiesiècle à se trouver ne serait-ce qu’un emploi temporaire décent, ou à recevoir un maigre cachet pour un article, le lire en train de fanfaronner donne sérieusement envie de l’inviter à prendre un café, de ne pas se pointer, et d’en profiter pour aller voler chez lui, à Outremont.
Ensuite, il y a des problèmes emmerdants pour une autobiographie, qui suppose une sorte de pacte de vérité avec le lecteur. Godbout est centré sur son expérience, avare de détails, et il est souvent tentant de ne pas le croire. Une controverse avait d’ailleurs éclaté en mars dernier dans Le Devoir au sujet de son traitement de Gaston Miron, qu’il accusait d’avoir proféré des commentaires désobligeants à l’égard des immigrants, mais il me semble que ce n’est pas que ce passage qui pose problème.
Certains règlements de comptes sont carrément pathétiques, comme lorsqu’il dénigre Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais ou l’œuvre de Michel Tremblay. D’autres encore sont si centrés sur lui qu’ils semblent peu fiables, comme lorsqu’il parle d’un conflit avec Daniel Pinard, alors directeur de la production française de l’ONF, parce que Godbout serait «indifférent au fait que [Pinard] est homosexuel». Il ne s’agit que d’un exemple, mais d’autres règlements de comptes ou anecdotes laissent planer ce doute. Et, comme dirait Doug Archibald: s’il en parle… ♦