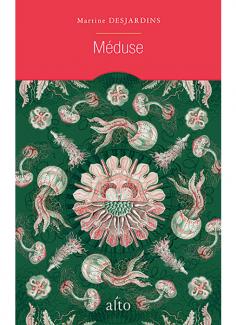Écho contemporain du mythe de cette Gorgone, Méduse, de Martine Desjardins, présente en une succession de tableaux un conte cruel qui ne possède pas le souffle romanesque de La chambre verte (Alto, 2012).
Écho contemporain du mythe de cette Gorgone, Méduse, de Martine Desjardins, présente en une succession de tableaux un conte cruel qui ne possède pas le souffle romanesque de La chambre verte (Alto, 2012).
Dans son sixième livre, Martine Desjardins nous livre une étrange réflexion sur la monstruosité, la féminité, le désir et la perversion. La table semble mise pour une œuvre forte: l’autrice affiche un solide pedigree, le sujet est plein de promesses, et La chambre verte hausse admirablement l’espérance de vie des fictions publiées à l’heure actuelle. Dès les premières pages de Méduse, on retrouve l’ampleur du style de l’écrivaine.
Ainsi, je ne connaîtrai jamais la consolation de pleurnicher sur mon triste sort, de brailler comme un veau quand je me cogne l’orteil contre un meuble, d’inonder mes joues après avoir été humiliée, d’essorer mon mouchoir devant un mélodrame de chaumière.
L’internat social
L’héroïne et narratrice du livre explique ci-dessus l’aridité de ses «Monstruosités», l’un des nombreux mots peu flatteurs qu’elle utilise pour qualifier ses yeux. Le sens de l’image,
le ton décalé, l’humour frondeur: tout l’art de Desjardins y est. Ce qui cloche ne tarde pourtant pas à se révéler.
Toujours soucieuse de dénoncer les impostures qui se cachent derrière les bons sentiments et la morale de façade de la haute société (c’était l’avarice dans La chambre verte), la romancière critique ici la propension à dissimuler les sources de honte pour préserver une réputation douteuse. Révulsés par la laideur de leur fille, qu’ils gardent prisonnière dans leur demeure, les parents de Méduse n’hésitent pas à l’envoyer dans le plus cruel des internats le jour où elle tue par accident la bonne de la famille en l’exposant à son regard. Dès lors, les portes du bien mal nommé Athanæum se referment sur la pauvre Méduse, comme celles du récit sur les lecteur·rices.
C’est en effet à ce moment précis que la machine romanesque s’embourbe pour n’en ressortir que chancelante et amoindrie. Pendant près de la moitié du livre, il nous faut rester cloîtré·es dans ce sinistre pensionnat, qui prend assez rapidement les airs d’une version dénaturée des douze travaux d’Hercule. Sous la férule de la mesquine directrice, Méduse subit d’inventifs châtiments qui confinent Aurore, l’enfant martyre (1921) aux contes de fées un peu mièvres. La cruauté est créative et révèle, par son large spectre et sa dimension ludique, la puérilité de celles et ceux qui l’exercent sur la captive. Les bourreaux (les «bienfaiteurs» de l’institut) utilisent Méduse l’un après l’autre pour assouvir leurs fantasmes, du plus inoffensif au plus sordide. Ils apprécient particulièrement l’immunité presque totale de la jeune fille à la douleur. Peu à peu, l’allégorie féministe se fait plus lourde et démontre sans subtilité que chaque homme de pouvoir demeure un éternel garçon en culottes courtes, frustré, capricieux, dangereux même, si on lui garantit l’impunité.
Ces prétendus libres-penseurs refusent d’obéir aux dogmes dépourvus de fondements scientifiques ou philosophiques, mais ils se soumettent aux règles archaïques de leur club. Ils se disent éclairés, or ils maintiennent leurs protégés dans l’ignorance la plus abjecte. Ils se croient libres et ils sont esclaves de leurs passions puériles.
Vengeance sans catharsis
Dans cette chic prison située au bord d’un lac enchanteur plein de méduses (animales, celles-là), la seule issue possible ressemble à un cimetière lacustre où d’inquiétantes lumières s’ébattent en silence. Chaque supplice est bien décrit et forme le tableau d’un roman initiatique et atmosphérique qui fait connaître sa morale à l’issue d’un (trop) long passage. Prenant conscience de sa propre puissance (et donc de sa beauté), Méduse cesse de courber l’échine et prend sa revanche sur le monde. Assumant pleinement sa singularité, elle châtie dûment ceux qui l’ont rejetée ou ont voulu tirer profit de son corps sans y avoir été préalablement invités. Elle laisse derrière elle une forêt grimaçante de visages pétrifiés pour enfin trouver, alors qu’elle ne les cherchait plus, des yeux désireux de se perdre dans les siens.
Je ne vous révélerai pas l’ensemble de la fable. J’insisterai seulement sur mes attentes déçues par le manque de vitalité de ce livre. Il me semble que le plan apparaît trop souvent en filigrane, que le propos, malgré sa pertinence, est plaqué par endroits, et que même la rédemption n’atteint pas la catharsis nécessaire à ce type de récit. Certes, une foule de beaux passages jalonnent Méduse, et le style demeure d’une qualité exceptionnelle, mais le roman n’arrive pas à convaincre, surtout lorsqu’on sait tout ce dont est capable la grande Martine Desjardins.