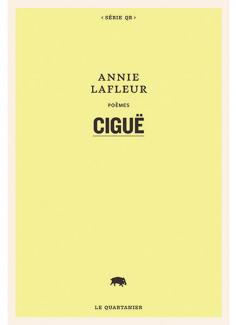Il y a des fins du monde plus belles que d’autres. La désolation qu’Annie Lafleur donne à lire dans Ciguë s’accompagne d’un doux parfum de résilience.
Il y a des fins du monde plus belles que d’autres. La désolation qu’Annie Lafleur donne à lire dans Ciguë s’accompagne d’un doux parfum de résilience.
La densité que l’on trouve dans l’œuvre de la poète est rare: elle oscille entre l’orfèvrerie et la spontanéité, comme si chaque vers s’imposait. Chez elle, la démultiplication des images fait flèche de tout bois et propose une panoplie d’arrêts où le regard doit se poser. Plante ou poison, la Ciguë d’Annie Lafleur tangue entre les deux éléments d’un poème à l’autre, entre ce désir d’en finir, de s’extraire du monde, et une ode à sa suite, avec ou sans protagoniste: «au champ de lavande je pense à mon ravage voix calcinée à la loupe je laisse la fourmi traverser l’horizon j’endure sa passion à la fois debout et courbée ma force décuple». Il y a des airs d’apocalypse tout au long de ce recueil, dans lequel la prose et le vers s’entrecoupent. Les textes aménagent les seuls réels temps d’arrêt, la virgule n’y faisant aucune apparition: le lecteur a alors le luxe de créer lui-même certaines narrations. À parcourir le livre, on se dit que si tel est le poison, comme Socrate, nous le boirons jusqu’au bout!
Aux armes, citoyens!
«Je me tire une balle dans la tête à l’heure pile à la bonne date»: ainsi débute cette plongée poétique, qui est tout sauf un abandon, mais plutôt une renaissance. Ce long poème rappelle un peu l’ouverture de Bec-de-lièvre (Le Quartanier, 2016), finaliste au Prix des libraires et au Prix du Gouverneur général en 2017, qui commençait comme suit: «on a tout jeté au feu/déchiré nos ceintures mangé les baies/escaladé une butte perdu un rein/[…]/on a gravé nos noms le jour l’année/zippé nos manteaux/on a sauté». Si alors, c’était la fuite, ici, la mise à mort semble le seul point de départ possible: «embrassée sous le gui qu’on m’achève à la poivrière/au pied-de-biche aux aiguilles à tricot à la queue de billard». Le ton est donné: l’univers est incertain et ne cesse de s’obscurcir. Rapidement, on mentionne «Guerre au parc on tire à vue»: on comprend qu’il faudra prendre les armes, comme si la poète voulait ici survivre, question de mourir en paix. C’est que tout est étrange, y compris «l’eau qui tient sans le sable». C’est également l’une des nombreuses raisons de s’armer: arc, arbalète, épée, rifle sont du nombre. En somme, «un de plus un de moins/disent-ils on ne sait pas tirer».
Plus on avance dans le recueil, moins on sent que la poète désire nous tenir la main. Les images fusent, se défaisant au même rythme qu’elles se créent:
Ivoire sous la laine me charrie dos piqué par les taons un boulet a fondu dans mon rein ça y est bleu poudré la tente sans piquets mon âme a crochi dans la roche
Malgré le caractère pérenne de l’écrit, on découvre quelque chose de magnifiquement éphémère dans les poèmes de Lafleur. On y cherche ce qui a émané lors de notre première lecture, on les relit et c’est autre chose qui apparaît. La densité de la proposition y est pour quelque chose: rien n’est vraiment dicté par les sauts de ligne, le lecteur peut se perdre, un peu comme le sujet, dans un monde où la raison fuit, mais où la beauté se détourne du réel pour se réfugier dans les sens triturés. «Je saoule le cheval pour l’hiver pour de bon»: arrive un moment dans le livre où l’on se dit qu’on aurait dû faire la même chose.
Ivresse singulière
Si certains pouvaient espérer un quelconque salut en cours de route, aux trois quarts du recueil, les fins heureuses semblent encore loin: «Cour à bois un marshal abattu/les pieds cuits à l’azote je cours». Non sans rappeler, dans une certaine mesure, Chien de fusil d’Alexie Morin (Le Quartanier, 2013), Lafleur s’empare de l’imaginaire récemment très fertile des fins du monde et des contrées postapocalyptiques pour y déplier une poésie résiliente, pour la simple et bonne raison que les fins sont ici multiples, prétextes aux recommencements.
Il y a une puissance étrange dans la poésie d’Annie Lafleur, comme si on se demandait si les images sont sibyllines ou tout simplement trop claires tellement elles éblouissent. Là réside tout le jeu poétique proposé par l’autrice, un jeu qui nécessite plusieurs parties. Ciguë est un livre dans lequel on peut errer longuement. Loin du poison, c’est plutôt une ivresse que la poète offre au lecteur: celle des écrivains qui savent se jouer de la langue et la connaître assez pour la renverser et ainsi aspirer à une réelle singularité. ♦