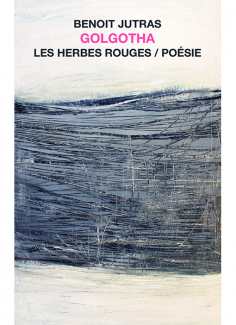Confirmant l’importance de Benoit Jutras dans la poésie québécoise contemporaine, Golgotha se présente à nous tel un banquet où toutes les identités de l’écrivain sont attablées.
Confirmant l’importance de Benoit Jutras dans la poésie québécoise contemporaine, Golgotha se présente à nous tel un banquet où toutes les identités de l’écrivain sont attablées.
Si certains peuvent penser qu’avec Outrenuit, le précédent recueil de Jutras, l’auteur avait touché à la quintessence de son projet poétique, c’est parce qu’ils n’ont pas encore gravi Golgotha, une somme d’écriture poétique dense, majeure, inclassable. Sur près de deux cents pages, le lauréat du prix Émile-Nelligan pour Nous serons sans voix (Les herbes rouges, 2002) nous convie à une immersion totale dans l’être, proposant des identités multiples et éclatant du même coup la question du « je » qui taraude le poète dans ses ouvrages. Si Outrenuit se voulait une dissection du « je » en bonne et due forme, le présent recueil tente une exploration des possibilités exponentielles que ce pronominduit ; une façon d’éclairer la totalité de ce qui nous forme, un effort pour sonder les différentes voix enfermées dans la « boîte noire » de Jutras.
Brûler toutes les effigies
Découpé en sept parties, Golgotha propose une recherche formelle saisissante : la prose au long souffle dans « Race privée » est balancée par une versification succincte et souple dans « Gnossiennes », « Office » et « Boîte noire ». Loin d’un simple clin d’œil évangélique, le titre du livre confirme les obsessions du poète pour les saintes Écritures — Jésus ayant été crucifié sur le Golgotha —, elles qui ont également su trouver refuge dans les précédents recueils de Jutras, aux côtés d’une fascination en général pour la mythologie christique. Bien que ce titre place le lieu du poème rapidement — Golgotha signifie « le lieu du crâne » —, l’exergue tiré du Théâtre des paroles de Valère Novarina offre peut-être l’une des meilleures pistes pour gravir ce sommet :
Le théâtre a été inventé pour y brûler la nuit toutes les figures humaines. C’est pas un lieu où faire le beau, paraître sur deux pattes, intelligent et bien dressé chez les dogmates, singer l’homme, mais un grand Golgotha de papier où brûler toutes les effigies de la tête de l’homme.
C’est peut-être davantage une mise en scène qu’un recueil de poésie que signe l’écrivain, avec pour distribution des Kjartansson, Ibsen, DeLillo, Jelinek, Siméon de toutes sortes, qu’on retrouve en titres de différents poèmes en prose de Race privée : de longs portraits, ou plutôt de longs monologues précédés d’une phrase ou deux s’apparentant aux didascalies théâtrales. Si Jutras « arrive blanc comme c’est écrit » dès les premiers vers, c’est qu’il se présente comme un canevas vierge que la poésie saura transformer : « changer était un métier aux heures liquides, un triangle sur les tempes, un ministère des morts, une maison fermée à clé, changer était une idée volée aux plaines. » Golgotha comme le théâtre du crâne, maintenant. Un endroit où l’homme laisse les voix qui l’habitent s’exprimer souverainement, au risque de perdre leur sens. Le poète préfère espérer en créer un nouveau.
Ostinato
À la lecture, il ne faut pas perdre son temps dans une quête de sens du poème pris séparément, une atomisation du texte ; ce dont il faut rendre compte ici, c’est l’habileté de Jutras à mettre le feu, au détour d’un vers. Au moment où le lecteur cherche la main du poète dans la forêt du recueil, celui-là, tantôt un éclair, tantôt un cerf, se présente comme une révélation : à mi-chemin entre un énoncé sibyllin et une vérité auguste.
Nous héritons du rôle des nuages. Les chaînes, la révolution de la mer, nos corps portent tout, nos corps sont des serpes. Nous connaissons l’huile, la sueur, la musique des monstres et des confessions. Gardez tout, nous vous en prions : nous vivons loin derrière nos dents. Nous sommes le couteau et la louange et le roman de personne. Nous nous taisons pour ne pas réveiller les chevaux qui nous aiment.
« Nous vivons loin derrière nos dents. » Combien de fois me suis-je répété ce vers comme une vérité, un catéchisme ? Là réside le projet de Benoit Jutras : plutôt que de proposer une lecture nouvelle du monde, c’est un renversement du sens du monde qu’il donne à lire, le lecteur s’y trouvant alors beaucoup plus libre, affranchi des chaînes sémantiques assujettissant la majorité des discours.
« Motif mélodique ou rythmique répété obstinément. » Ainsi définit-on l’ostinato dans le Larousse. Je croyais en trouver quelques-uns dans l’œuvre du poète, tout comme certaines litanies — les grandes religions, le rôle du sujet en poésie, l’herméneutique littéraire —, mais force est de constater que le seul ostinato qui importe, à la lecture de Golgotha, est celui dont nous extrait Jutras avec ce livre. Le sens règne, partout et futile à la fois, à la radio comme au souper, on nous propose des homélies que l’on connaît par cœur, qu’on nous répète obstinément. Le temps d’un recueil, la poésie de Jutras nous extirpe de ce bruit de ce bruit de fond pour nous rappeler toutes les possibilités du langage, la nécessité littéraire. ♦