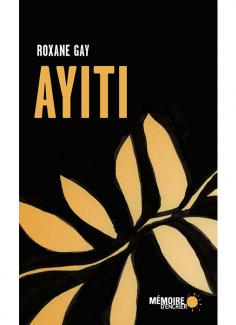Avant tout, il y a eu Ayiti : un lieu, un air, un fantasme. Un livre incontournable.

Avant tout, il y a eu Ayiti : un lieu, un air, un fantasme. Un livre incontournable.
Aujourd’hui, Roxane Gay n’est plus méconnue. Ayant acquis une renommée mondiale après la parution, en 2014, de Bad Feminist (New York, Harper Perennial) – œuvre qui a d’ailleurs été traduite, en 2018, vers le français sous le même titre et diffusée dans l’espace francophone grâce aux Éditions Denoël –, puis, en 2017, de Hunger : A Memoir of (My) Body (New York, Harper), et avec la publication de nombreuses chroniques dans une variété de journaux et de magazines, l’écrivaine s’est forgé une place importante dans le paysage culturel contemporain. Que l’on soit familier ou non de son œuvre, celle-ci résonne néanmoins en un écho assez puissant pour retenir l’attention, celle entre autres de Stanley Péan, le traducteur de Ayiti (originalement paru en 2011 à l’enseigne de Artistically Declined Press) pour Mémoire d’encrier. Dans une note à la fin de ce bouleversant recueil de récits, Péan confie n’avoir connu, jusqu’alors, le travail de Gay que de réputation. Mais à la lecture de ces fictions, nous dit-il, il s’est « retrouvé dans un univers si familier », réalisant qu’il partageait avec l’écrivaine des éléments biographiques de même qu’une sensibilité et une frustration à l’égard de la « privation de la terre natale », mais aussi du « racisme ordinaire et de l’ignorance crasse », des « présomptions et [d]es a priori », des « idées préconçues et [d]es mensonges colportés sur [le compte des Haïtiano-Montréalais] et celui du peuple haïtien en général ». Bien que les seize récits composant Ayiti soient tous engagés dans ces relations violentes qui définissent l’expérience haïtienne de la diaspora, le fil rouge de l’écriture de Gay trace avant tout les contours singuliers d’une « mythologie complexe » : celle, écrit-elle, que « les gens qui quittent les îles emportent toujours avec eux ».
Réverbérations
Les récits hétéroclites d’Ayiti parcourent des époques et régions diverses, et le point de vue varie selon l’énonciation : un « je » et un « nous » qui s’incarnent, à chaque texte, dans un corps différent, changeant d’aspect, d’âge et de sexe. Ce qui assure la filiation et la cohérence entre chacun d’eux est, plus qu’un simple enjeu thématique, un art de la variation qui, comme en musique, se joue dans l’intervalle, le changement de tonalité et la modulation harmonique. Chez Gay, les différentes voix s’éloignent et, dans la fugue de leur singularité, nous rappellent la première phrase mélodique, l’Haïti originel : « [S]a voix sonnait comme celle de Port-au-Prince, des rues animées, des cuivres éclatants, une odeur de viande grillée et de maïs rôti, une chaleur épaisse et tranquille […]. » Cette musique, elle s’entend dans la prose de l’autrice, dans la poésie des passions et des souffrances qu’elle décrit, dans la beauté et la laideur des paysages qu’elle dépeint; mais elle s’entend surtout dans cette langue « pas consciente de l’accent », qui résiste aux stigmates : « Quand mes frères et moi [i]mitions [notre père], il souriait avec indulgence. Avant chaque voyelle un “h”, à la fin de chaque pluriel, aucun “s”. […] Pendant plusieurs années nous n’avions pas conscience de l’accent de nos parents […]. Tout ce que nous entendions, nous, c’était le pays natal […]. »
Possessions
Comme l’amour possédant Micheline, qui a jeté un charme vaudou à son amant Lionel dans le récit intitulé « Zonbi », Gay donne corps à l’esprit d’Haïti : il s’empare de l’écriture, la possède. Cet esprit, ce pneuma, ce souffle, à l’image du mot préféré du personnage de la grand-mère du huitième récit, suffusion (« qui désigne l’action de se répandre de manière diffuse, à la manière de l’eau ou de la lumière »), se diffuse et est agent de hantise et de dévotion. Si Haïti est le « pays que [l’on] aim[e] avant d’aimer quoi que ce soit d’autre », il tourmente aussi des générations entières, désormais « hantée[s] par l’odeur du sang ».
Il est une expression en anglais, to sugarcoat (littéralement « saupoudrer de sucre »), pour signifier une manière d’embellir une réalité autrement dérangeante. Chez Gay, même si le sucre est « doux sur la langue », il « érafle la peau ». Il est impossible d’extraire l’amertume de la jouissance, la douleur de la volupté, pour nous épargner ainsi la terreur de l’Histoire au profit d’un plaisir inaltéré. C’est ce qui fonde la sensualité essentielle et puissamment envoûtante de son écriture, qui nous fait entendre « le son de son cœur qui bat, de son sang qui coule » ; nous montre « les membres enchevêtrés, les corps unis, respirant le souffle l’[un] de l’autre ». C’est au rythme de ce souffle, qui de bouche en bouche circule, que le charme d’Ayiti opère, nous faisant croire aux « spectres ou peut-être [aux] ombres » comme en cette force de résilience donnant au « goût amer qui brûle » le goût de l’amour.