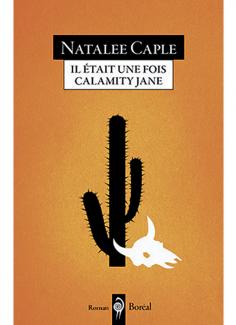Calamity Jane, tout le monde connaît son nom. On l’a lu dans des livres, on l’a entendu
en chansons, on a vu le personnage au cinéma et en bandes dessinées – je me souviens d’un Lucky Luke –, tout un folklore envahit la mémoire.
Calamity Jane, tout le monde connaît son nom. On l’a lu dans des livres, on l’a entendu
en chansons, on a vu le personnage au cinéma et en bandes dessinées – je me souviens d’un Lucky Luke –, tout un folklore envahit la mémoire.
On imagine un Far West sans foi ni loi, on la voit galoper dans la plaine, cheveux au vent, son pistolet encore fumant à la main. Qui était-elle? A-t-elle vraiment existé? Ou bien n’est-elle qu’une légende?
Montréalaise vivant à Toronto, Natalee Caple tente de répondre à cette question, de discerner le vrai de l’inventé — ou d’inventer la vérité — dans son dernier roman, Il était une fois Calamity Jane. Comme elle l’explique à la fin de l’ouvrage, il s’agit d’une «œuvre de métafiction historiographique. La plupart des faits concernant Calamity Jane, y compris son identité à la naissance, sont difficiles à établir avec certitude.» Il semble pourtant presque sûr qu’elle a eu une fille avec Wild Bill Hickok, le seul homme qu’elle a aimé— assassiné d’une balle dans la tête dans une salle de jeu. Elle aurait alors donné cette enfant, Miette, en adoption à un homme d’Église, qui l’a élevée. Et elle ne l’a jamais revue. Ou peut-être que oui. Autour de Calamity Jane gravitent certains personnages qui ont vraiment existé; Buffalo Bill, par exemple, certains événements, notamment l’assassinat du président William McKinley en 1901, pendant l’Exposition panaméricaine, sont authentiques. Pour le reste, il faut suivre l’auteure dans sa recréation du monde. Et on la suit avec ravissement. Si elle invente, on veut la croire.
La quête
Le roman commence à la mort du père adoptif, lorsqu’il demande à Miette de retrouver sa mère.
J’ai dit oui parce que je ne pleure pas et que je l’aimais et que, au cours de notre dernière heure ensemble, je lui aurais promis n’importe quoi.
La jeune fille se met donc en route, vêtue des habits de son père, avec sa jument, une couverture, quelques provisions, une carabine et un pistolet. Le voyage sera long, très long, semé d’embuches et d’épreuves toutes plus pénibles les unes que les autres: quand ce n’est pas le mauvais temps — la pluie, la foudre, le froid, le vent qui hurle dans la nuit —, c’est la faim qui la tenaille, ce sont les animaux sauvages qui la menacent, la perte de sa jument, la fatigue, la peur, les blessures, la maladie.
Son parcours sera aussi jalonné de rencontres, parfois heureuses, parfois néfastes. Paumés, despérados, éclopés, tous ceux qu’elle croise prétendent avoir connu Calamity Jane, c’est parfois vrai, ou bien ils ont entendu parler d’elle, ils lui donnent des photos, ils disent qu’elle était bonne, ou bien qu’elle était dure, qu’elle soignait avec dévouement les malades, qu’elle ne ratait jamais sa cible. Éclaireuse dans l’armée, chercheuse d’or — sans avoir jamais trouvé une seule pépite —, ivrogne notoire, elle a conduit du bétail, livré le courrier à ses risques et périls, et à l’époque c’était vraiment périlleux, s’est exhibée à l’Exposition panaméricaine. Ils disent qu’elle est maintenant dans telle ville, et Miette s’y rend, et là, on lui dit qu’elle est ailleurs, elle rebrousse chemin, à pied, à cheval, en train, et c’est comme si elle poursuivait un mirage, cette mère qu’elle ne connaît pas, qu’elle ne veut pas connaître, qu’elle refuse d’aimer.
Le roman est divisé en courts chapitres où alternent la voix de Miette, à la première personne, et l’histoire de Martha, alias Calamity Jane, à la troisième. S’y insèrent à l’occasion des poèmes, des chansons, les récits de personnages rencontrés le long de la route, Lew Spencer, par exemple, minstrel et danseur de gigue itinérant, ou Dora DuFran, tenancière de bordel au grand cœur, amie de Calamity Jane.
Cette construction baroque confère à l’ensemble du roman, admira-blement rendu par l’excellente traduction — je veux dire ici qu’on ne la sent jamais — de Lori Saint-Martin et de Paul Gagné, un rythme particulier, envoûtant. L’écriture est à la fois précise et poétique.
Miette reçoit finalement une lettre dans laquelle Martha lui raconte sa vie, lui explique pourquoi elle a préféré se séparer d’elle.
Je savais que si je te gardais, tu ne survivrais pas. Je risquais de me soûler et de te laisser mourir de faim ou de froid. Je risquais de ramener à la maison des personnes peu recommandables. Je risquais de perdre au jeu l’argent nécessaire pour t’acheter des chaussures et des livres et des robes. Je risquais de me faire descendre, un beau soir, et de te laisser sans défense.
La rencontre aura finalement lieu, à Deadwood, où Miette retrouve sa mère moribonde, désormais moins que l’ombre d’elle-même. Ceux qui croyaient lire une biographie de cette héroïne du Far West seront sans doute déçus, mais les autres, qui privilégient l’originalité de la démarche, l’élégance du style, trouveront leur compte dans Il était une fois Calamity Jane. L’œuvre a fait l’objet de critiques élogieuses dans tout le Canada anglophone.♦