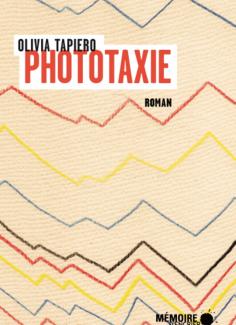Dans Phototaxie, Olivia Tapiero renoue avec son funeste sujet de prédilection, comme moyen radical de lutter contre l’immobilisme et la facilité.
Dans Phototaxie, Olivia Tapiero renoue avec son funeste sujet de prédilection, comme moyen radical de lutter contre l’immobilisme et la facilité.
Olivia Tapiero a l’habitude des personnages épris de la mort. Surtout celle que l’on se donne: après Les murs (lauréat du prix Robert-Cliche en 2009) et Espaces (2012), Phototaxie érige le suicide en réponse possible à un chaos qui n’en finit plus de ne pas survenir. «Si l’apocalypse était une mise en lumière, nous nous laisserions blondir au soleil, blottis les uns contre les autres», affirmera d’emblée l’un des protagonistes. Dans ce roman court, mais exigeant, l’auteure de vingt-sept ans s’attaque à nos existences lisses, à nos révoltes cotonneuses, à nos têtes pleines «de ronces, d’accolades et de références».
Refus intégral
Trois jeunes adultes gravitent autour d’un idéal de révolution, comme des phalènes flirtant avec la lumière: Théo, musicien célèbre et «confortablement suicidaire» qui, dans sa fascination pour le désastre, tente de faire oublier ses origines bourgeoises; Zev, chef charismatique d’un mouvement militant, bientôt exilé à l’Ouest; et Narr, indignée tranquille, immigrante refusant l’identité qui la précède. «J’aurais dû être un chat errant, une plante grimpante, un crustacé, la tête vide, une folie souveraine», dira-t-elle dans un de ces passages où la plume de Tapiero, rigoureuse et inventive, nous éblouit.
Un quatrième personnage, «l’homme qui tombe», traverse Phototaxie comme un leitmotiv. Jouée en boucle sur l’écran de Théo, sa chute ainsi esthétisée fait écho à la vigoureuse charge du roman contre la léthargie ambiante — cette léthargie qui transforme les colères «en délits mineurs, en voies de fait, en discours, en lettres ouvertes et en débats de forums publics». Contre une forme de sensationnalisme, aussi, qui injecte du sens dans ce qui n’en a pas: «Ces rapaces sont capables de tout pour rétablir une certaine cohérence. On me dira mentalement instable, on parlera des femmes, de l’économie ou de l’immigration», déplore Narr, mesurant les conséquences d’un geste fatal.
Or une catastrophe est bien en cours dans cette cité où le sol est recouvert d’une «boue sanguine» et l’air, saturé d’odeurs putrides. Le gouvernement a beau tenter de l’endiguer, elle lui coule entre les doigts. Et ce n’est pas beau à voir: «Les viandes molles et visqueuses croupissent le long des routes qui mènent au Conservatoire. Même les rats n’en veulent plus, il n’y a que les mouches et les asticots qui s’y tortillent.» Quelque chose, dans les descriptions crues de cette ville qui moisit ostensiblement, fait d’ailleurs penser à Oscar De Profundis, le récent roman de Catherine Mavrikakis. Sauf que l’art et la mémoire, plutôt que d’exercer un pouvoir salvateur, sont ramenés à un tas de racines encombrantes — comme si, en témoins implacables de l’humanité, ils plombaient toute velléité de changement, condamnaient à l’immobilisme. Ainsi le musée brûle; ainsi les livres flambent; ainsi le piano, dompteur de consciences et de chaos, se compare à un cercueil. Il faut nourrir le feu plutôt que de chercher à le contrôler, semblent dire les personnages, devant une population qui suit les ordres avec une joyeuse docilité. «[T]uer le mur en préservant la fenêtre.»
Écrire le chaos
«Ne pourrais-je pas simplement arriver de nulle part, librement exsangue? Il me semble n’être qu’un corps qu’on cherche à ficher», soupire Narr, bientôt isolée. Alors que sa famille tente de la prendre en charge à distance, la jeune femme s’enfonce dans le désenchantement. Et la narration, qui fricotait jusque-là avec un hermétisme ponctuel — des phrases alambiquées parmi d’autres, follement bien tournées —, est de moins en moins ancrée dans le réel, jette une ombre sur l’expérience de lecture. Peut-être est-ce un choix, celui de performer l’éphémère et l’errance jusqu’au bout, deux éléments clés de ce roman qui s’élève contre l’institutionnalisation des êtres? Il faut le reconnaître: même si l’on admet une part d’abstraction, certains passages, surtout vers la fin, sont obscurs. Il aurait fallu quelques pierres blanches pour marquer le chemin. Un appel d’air au cœur de l’incendie.
Tout de même, personne ne pourra reprocher à Olivia Tapiero d’être paresseuse. Ni dans son écriture, ni dans la structure même du roman, qui s’écartent toutes deux des banalités et des conventions — de lumineuse façon, le plus souvent. Celle qui s’inscrivait en marge de l’époque avec ses précédents livres y entre cette fois de plein fouet, pour en prendre le contre-pied: furieusement, courageusement, radicalement.♦