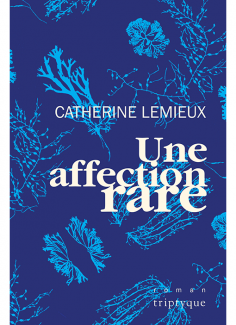Les ombres magistrales projetées tant par les Smiths que par Boris Vian abondent dans ce premier roman de Catherine Lemieux.
Les ombres magistrales projetées tant par les Smiths que par Boris Vian abondent dans ce premier roman de Catherine Lemieux.
Rare, l’affection de l’héroïne-narratrice qui nous occupe ici l’est sans doute puisqu’elle souffre d’une maladie orpheline entravant la bonne marche de ses poumons en laissant s’y développer des algues. De l’algue au nénuphar, il n’y a qu’une brasse, mais celle-ci suffit pour distancier l’univers de Lemieux de celui de Vian. Voyez-vous, le style de cette nouvelle romancière a beau être fleuri, élégant comme une phrase en tenue de soirée, il vit sous un ciel perpétuellement gris qui ne permet pas aux jours de laisser dans leur sillage un peu d’écume. Ce ne sont donc pas les fusils poussant en terre qui révoltent la narratrice, mais bien la nécessité accablante de se « déguiser en jeune fille avec de l’avenir », tâche d’autant plus ardue au royaume des « animateurs déchets de la radio poubelle ». Si autour d’elle certaines jeunes filles se trouvent en fleur, elle préfère piétiner les jardins de sa connaissance au son de Bowie, The Cure et The Smiths. Avec son acolyte Sarah, elle a trouvé dans la contre-culture un refuge « à la cité de la léthargie perpétuelle », « deux naufragées de la new wave anglaise, échouées sur les rives du Saint-Laurent ».
Survivre à la puberté
Traversée d’aléas somme toute assez banals, la relation des deux amies demeure essentiellement conflictuelle. Sans incarner une amitié aussi fondamentalement malsaine et tragique, la dynamique de ces deux adolescentes rappelle parfois la fascination éprouvée à la lecture de la désormais célèbre tétralogie d’Elena Ferrante, L’amie prodigieuse (Gallimard, 2014-2018). Certes moins ambitieux que ce cycle aux multiples ramifications politiques, culturelles et psychologiques, Une affection rare s’ancre solidement dans une littérature de l’intime et de l’introspection, donnant par l’emploi de la première personne du singulier un accès éclairant et direct aux pensées d’une femme bouillonnante et changeante. Pressée de quitter « [les] parents, [la] maison et [le] port qui sent le poisson pourri », elle n’a pas pour autant la moindre idée de la destination à prendre une fois arrivée au grand carrefour. Ainsi faut-il s’abîmer pour se donner une manière de patine, ne pas trop parler au troupeau de peur de se rendre compte que sa propre toison n’est finalement pas aussi noire qu’on le croyait. Il faut également nager, nager à en perdre haleine, de façon à ne plus proférer les sentences incendiaires que dans la sécurité du bastion mental, trop essoufflée par l’effort pour attiser en public les braises de la colère qui ronge. L’adolescence grimpée trop vite au sommet de ce qu’elle croit la vie a tout raté en chemin, aveugle à la beauté, niant le futur, engoncée dans un mal-être de passage.
La colère qui sauve
la dernière longueur de la journée s’achève dans le bruit le bruit agréablement assourdi pendant les deux heures de l’entraînement à présent terminé retour du chaos des paroles criardes qui font éclosion dans ma tête et dans mon corps comme autant de sifflements malvenus comme autant de petits agents irritants d’anodins poisons quotidiens avalés en disant merci oui oui les paroles deviennent des cris et les cris me font chavirer me font mal comme la lumière fait mal après un long sommeil lourd […]
Pensées coulant en un long fleuve intranquille, inapaisé, ces passages agissent comme des électrochocs au long du roman, fouettant le sang du lecteur qui tombe à la suite de la narratrice dans le noir marasme d’une puberté sans fin, où tout semble ennuyeux ou vain. Ils sont la goulée d’air salutaire qui s’engouffre dans les poumons quand la tête de la crawleuse émerge brièvement hors de l’eau, bijoux de fureur, sursauts de vitalité. Heureusement qu’ils y sont d’ailleurs, car la plume de Lemieux a beau être éblouissante, elle ne suffit pas entièrement à rendre mémorable cette histoire qui donne parfois l’impression de faire du sur-place en eau profonde, battant furieusement les jambes pour ne pas sombrer, sans toutefois esquisser le geste qui rapprocherait du rivage. La trame narrative ténue est ainsi la faiblesse principale de ce texte aux atmosphères réussies, aux personnages crédibles et au style recelant les promesses d’une belle œuvre à venir. À l’école de l’irrévérence, les théories pèsent peu dans la balance, les esquisses et les plans sont de meilleur goût une fois en cendres, et rien ne vaut les travaux pratiques.
Tout le monde danse. Moi aussi. Fouillis de résolutions. J’apprendrai le vaudou. J’apprendrai la solitude et la dignité. J’apprendrai l’irrévérence. J’apprendrai la révolte. Je m’en sortirai. Je m’en sors.
Dans ce beau portrait d’une jeune femme qui se veut plus rebelle qu’elle ne l’est réellement, on continue d’attendre l’étincelle qui mettra le feu à ses aspirations, l’instant de clarté vacillante où les « lubies de [ses] dix-sept ans » lui apparaîtront comme révolues, lui laissant enfin la place de se réinventer, enfin adulte. ♦