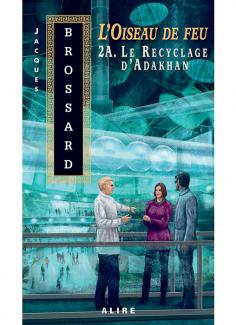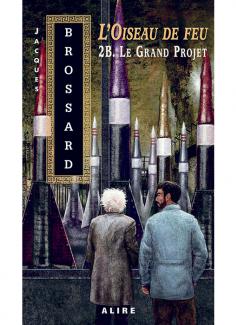Entre 1989 et 1997, Jacques Brossard (1933-2010) a fait paraître chez Leméac une fresque échelonnée sur plus de 2500 pages. Les cinq volumes massifs de L’Oiseau de feu témoignent avec éloquence de l’ambition de l’écrivain qui a donné son nom au Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois à partir de 2008.
Entre 1989 et 1997, Jacques Brossard (1933-2010) a fait paraître chez Leméac une fresque échelonnée sur plus de 2500 pages. Les cinq volumes massifs de L’Oiseau de feu témoignent avec éloquence de l’ambition de l’écrivain qui a donné son nom au Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois à partir de 2008.
L’eau enflammée des profondeur
À l’image d’Adakhan Demuthsen, son héros façonneur de métaux, Jacques Brossard forge patiemment une œuvre en trois temps (ce n’est pas un hasard si la «trilogie intérieure» est numérotée 2A-2B-2C). Nous parcourons en premier lieu Manokhsor, la Cité-simulacre aux enceintes infranchissables, pourvue de douze quartiers étanches et circulaires: «lacis inextricable, […] labyrinthe désordonné et complexe de venelles, d’impasses». À l’égal des Périphériens, Adakhan (dont le prénom signifie «l’arrivée du chef») évolue dans un univers totalitaire, les habitants des quartiers n’ayant le droit ni de se questionner ni de se révolter. Lorsqu’ils désobéissent, des proches disparaissent, des édifices s’affaissent, des archers au sang olivâtre décochent des flèches meurtrières ou des anges aux cuirasses étincelantes surgissent du ciel… Mais Adakhan possède une curiosité innée, il est destiné à être toujours «celui qui march[e] en tête, d’un pas régulier — celui d’un somnambule». Il fait ainsi fi des règlements de Manokhsor, déterminé à visiter coûte que coûte le territoire par-delà le désert. Car, comme sa seconde compagne Selvah, une Centralienne, le forgeron ne veut «pas d’une soif qu’on assouvit trop facilement».
La plupart des actes du jeune homme seront conséquemment guidés par une volonté de connaissance, de dépasser les évidences, par exemple lorsqu’il fuit la fête du Roi (une mise en scène déliquescente) ou quand il s’introduit dans les souterrains de son quartier, descendant en quelque sorte jusqu’aux Enfers… de la Centrale. Car cette Centrale «mythique», dont seule la tour est visible aux habitants de la surface, constitue en fin de compte une nouvelle forme de totalitarisme. Dans les profondeurs de cette «Maison-Dieu» vivent les Centraliens, quasi immortels dont la santé est à toute épreuve. Leur métabolisme est chimiquement ralenti, gelé par l’aghératol. Ces privilégiés, qui ne respirent pas l’air fétide de la Cité extérieure (sauf s’ils souhaitent s’y promener), sélectionnent de rares résidents des quartiers «mal famés» pour rallier leurs rangs. Grâce à sa fougue et à sa curiosité, mais surtout à ses liens de parenté avec un dirigeant, Adakhan est un candidat tout désigné pour rejoindre l’équipe de son parrain.
Le jeune forgeron évolue dès lors, dans le deuxième et le troisième volume, à l’intérieur d’un lieu aseptisé, idéologiquement biaisé, sur lequel règnent plusieurs chefs, notamment Lokhfer (LC4-FR5) et Syrius (JH3-VH9), dont les «noms de code» rendent compte de leur allégeance au mal (Lucifer) et au bien (Jéhovah). Mais le temps presse: un nouveau recul technologique s’annonce et, plus grave encore, les séismes enlisent peu à peu Manokhsor dans la terre, vers les entrailles de la Centrale.
Néanmoins, le parrain d’Adakhan, pour qui le ciel étoilé possède peu de secrets, a planifié clandestinement le départ de L’Oiseau de feu, fusée désirée à la colonisation d’Ashmev, une planète lointaine. Pressenti pour commander l’appareil, Adakhan se dirige alors, escorté d’amis et de conquêtes (son charme ne se tarit pas dans l’ensemble de la pentalogie), vers cet astre qui revêtira des allures trompeuses de jardin d’Éden:
Sans obstacles, il n’y a pas de liberté. Sur cette île, tout nous est donné, tout est trop facile. […] Sans obstacles, nous ne pouvons pas vérifier notre liberté. […] Au contraire, en partant, quoi qu’il advienne, nous saurons si nous sommes libres… Et si nous l’étions sur cette île…
Les enfants de Selvah et d’Adakhan exploreront pour leur part, dans le cinquième et dernier volume de la pentalogie, cette terre faussement idyllique où ondoie le serpent. Leurs fils, Abhül et Khan, sont après tout destinés à jouer les rôles d’Abel et de Caïn… Au sein de cet univers aussi empreint d’artifices que la Cité-simulacre de jadis, Adakhan s’exclamera: «que vienne la métamorphose ultime, je voudrais m’arracher tous mes masques». Et ses descendants colonisent méthodiquement, pendant ce temps, leur terre d’adoption…
Nous avions érigé des murailles de secrets
Après son arrivée dans la Centrale, Adakhan recueillera les enseignements de son parrain, dans le tome 2A, un peu explicatif et laborieux, entre autres à cause de l’intégration incessante d’extraits d’encyclopédie. Car Jacques Brossard a la passion exacerbée du paratexte: sa pentalogie ne dénombre pas moins de 175 citations en exergue des chapitres! Le foisonnement de cet appareillage référentiel enrichit de façon ponctuelle sa fresque science-fictive (par exemple les notes de bas de page du pseudo-traducteur de L’Oiseau de feu, fictivement présenté comme un manuscrit trouvé par-delà les murailles du désert — processus par contre déjà suranné au début des années 1990), qui rajoute un niveau de complexité intéressant. Mais l’excès n’est parfois pas loin dans la pentalogie, qui n’est pas exempte de longueurs. Les tomes1 et 3, plus proches du roman d’aventures initiatique d’inspiration romantique, me paraissent avoir plus facilement passé l’épreuve du temps que la trilogie intérieure (2A, 2B, 2C), avec ses ordiwriters, ses noms chiffrés (DKN-397, KRS-TS2), sa tendance à la «majusculite» (Centrale, Parrain, Tour…) ainsi que l’emploi d’un anglais à l’humour discutable: «Ovaire maï dethboddy(!1)». Cela dit, L’Oiseau de feu illustre sans contredit la précision stylistique de Jacques Brossard ainsi que son affection pour l’onirisme et le surréalisme, qui donne lieu à de magnifiques scènes traversées de vertiges:
Ciel de pierre et de plomb: voûte surbaissée d’une crypte immense […]. Depuis combien de temps cherche-t-il les pèlerins de la nuit? Ces escaliers en spirale et ces tunnels en pente qui trouent l’espace […]. Des surfaces de roches ou de glaise molle s’inclinent sans fin, s’agitent sous la plante de ses pieds comme une onde.
Le talent de Brossard pour évoquer l’exacerbation des sens est véritable, particulièrement lorsque l’écrivain décrit des scènes horrifiques et funestes (le soir des violences, par exemple, cérémonie au cours de laquelle, pour faire chuter la démographie des quartiers périphériques, mères et enfants s’immolent dans l’arène). La passion et l’impétuosité sont de surcroît l’apanage de la majorité des personnages, au premier chef Adakhan, dont nous pourrions toutefois déplorer que toutes les héroïnes féminines, à l’image d’un cliché bien connu du roman d’aventures, succombent tôt ou tard à son charme viril, à la manière d’un programme annoncé. Ne dit-il pas lui-même de Lhianatha, sa première conquête: «Tout cela est trop parfait, que va-t-il nous arriver?»
«Le désert croît. Malheur à qui porte en lui le désert 2»
L’Oiseau de feu est indéniablement à replacer dans son époque, c’est-à-dire dans la consolidation d’une science-fiction québécoise du début des années 1990. En ce sens, la pentalogie est un passage important, un pèlerinage nécessaire (pour rester dans l’imagerie de l’Ancien Testament convoquée par Brossard) pour qui souhaite comprendre les assises de la science-fiction d’ici. Une fresque à lire comme un enivrant appel vers l’exil, en direction d’une «planète en fuite qui vient à [notre] rencontre».♦