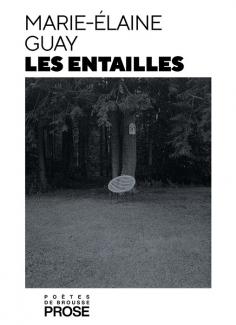Avec Les entailles, Marie-Élaine Guay offre un premier récit de souffrance.
Les entailles est un livre sombre. Dans la lignée du roman Les falaises (Virginie DeChamplain, La Peuplade, 2020) et de Menthol (Jennifer Bélanger, Héliotrope, 2020), le récit de Guay est centré sur l’héritage de la souffrance parentale, son histoire familiale et son manque de prise en charge sociale. À la suite du décès de son père, la narratrice Marie-Élaine revient sur l’agonie de celui-ci et sur sa propre enfance, sous la tutelle de deux parents nocifs, chacun en proie à un mal-être dévorant. Dépressions, alcoolisme, violences, humiliations, intimidation et tentative de suicide dessinent, dans ce livre, le portrait sans fard d’un parcours parsemé d’embûches.
Utilité
Les entailles se présente comme un récit utile. Il a ainsi pour objectif de «dire la vérité», dans une optique confessionnelle visant non seulement à se dire, quitte à incommoder les lecteur·rices, mais également à dire les autres, les parents, pour leur donner la voix qu’ils et elles n’ont pas eue. D’ordre cathartique et presque sanitaire – la narratrice voulant échapper à la «Folie» –, l’ouvrage s’inscrit dans un mouvement conjoint d’émancipation personnelle et sociale, dénonçant les manquements graves de la prise en charge collective des maux physiques et psychologiques, notamment en ce qui a trait à la fin de vie.
En ce sens, le réalisme du roman, dans sa dimension crue et brute, établit un terrain commun de vérité sur lequel peut se créer une articulation – dans l’optique d’une réalisation hors du livre – de solidarité, d’empathie, de réflexion et éventuellement d’action avec le lectorat. «Je me raconte ainsi afin de créer un attachement entre nous, puisque le récit tend parfois à effacer celui ou celle qui l’écrit», note à ce sujet la narratrice. Or, ce projet, s’il apparaît possible, valable et souhaitable, se trouve menacé par la souffrance elle-même, le pessimisme qu’elle diffuse, le sens de la fatalité qu’elle confère au texte et son austérité.
Sujet sérieux
Si le récit de soi mis en scène dans Les entailles peut parfois «effacer» son émettrice, les choix narratifs, en revanche, réaffirment la domination d’un certain parti pris subjectif. Ainsi, le texte présente à plusieurs reprises le point de vue extérieur d’une autorité médicale. Cette dernière décrit la narratrice adolescente comme «[répondant] bien à l’humour, drôle dans sa manière de se raconter». On devine qu’elle a développé cet humour comme moyen de défense et qu’il est lié à son désarroi. Toutefois, le récit de Guay se caractérise par sa quasi-absence d’humour. Il nous laisse donc percevoir une personnalité qui sait être drôle, notamment pour «se raconter», et offre à l’opposé un texte austère. Ce refus de conserver la qualité humoristique du personnage va à l’encontre du processus de vérité annoncé. La narration invisibilise ses a priori énonciatifs, comme si l’absence d’humour allait de soi pour un tel récit; comme si la fatalité ou la tristesse imposée excluait absolument toute forme de résistance par le rire. La souffrance est un sujet sérieux: serait-ce la vérité promise par le texte?
Avec ce sens de la tristesse imposée viennent ceux de la condamnation et de l’inéluctabilité des choses, comme si tout avait été écrit d’avance: «[J]e ressens parfois cette étrange impression que […] ce vécu s’est manifesté sous forme de livre, bien avant que les doigts ne tapent»; «L’avenir s’est joué, là, à ce moment précis». Les discours médicaux mis en scène manifestent leur emprise jusque dans celui de la narratrice, qui reprend par exemple un terme précis – «onychophagie» – pour pathologiser le fait que sa grand-mère et elle se rongent les ongles. Fait qui aurait bien pu être considéré comme une simple habitude et non pas analysé selon une optique déterministe et anxiogène. La narratrice abdique devant ce vocabulaire d’autorité, dont elle ne remet en question ni les fondements ni les conséquences. Les entailles, qui veut en finir avec la condamnation à la souffrance, propose une vision du monde dans laquelle le mal-être a déjà gagné. La mélancolie, insidieusement, s’impose, toute-puissante, et la possibilité de bonheur annoncée à la fin du récit, avec la grossesse de la narratrice, paraît excessivement fragile en regard de ce qui précède.
Le texte de Marie-Élaine Guay, à l’écriture maîtrisée, soulève le paradoxe suivant: dire la souffrance sur la place publique, c’est risquer de lui donner de l’ascendance, de ternir ce qu’il reste à ternir. Et pourtant, il faut la dire.