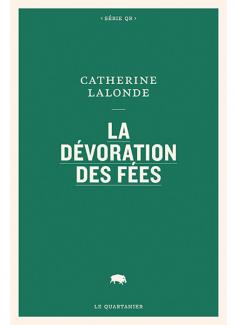À mi-chemin entre le conte d’émancipation et le poème, le quatrième livre de Catherine Lalonde
en est un dans lequel le langage est la réelle fée marraine.
À mi-chemin entre le conte d’émancipation et le poème, le quatrième livre de Catherine Lalonde
en est un dans lequel le langage est la réelle fée marraine.
Si Le Quartanier a cru bon éviter d’apposer toute appellation sur ce livre, ne voulant point l’emprisonner sous le joug des «poèmes» et encore moins dans la tour sacrée du «roman», c’est que cette Dévoration des fées jouit d’une grande liberté grâce à son style hybride. Avec ce texte étrange en tout sens, sublime bizarrerie, Lalonde se défait l’une après l’autre des chaînes qui trop souvent retiennent les genres, sa façon bien à elle de célébrer l’écriture dans l’éclatement. Et comme le dit si bien le collègue François Rioux, «ce n’est pas si simple, [mais] quand on l’ouvre ça saute aux yeux — et les livres bizarres, les libraires les placent dans le rayon poésie, ce qui m’autorise à en parler ici1.»
Le phrasé du livre de Lalonde est aussi libre que «la p’tite» qu’il narre. Personnage de contes aux accents rebelles, c’est une Boucle d’or qui dompte les ours, c’est un Petit Chaperon rouge qui effraie les loups, une Raiponce qui se rase les cheveux, une Gretel qui prend le lead. S’ouvrant sur une scène d’accouchement ressemblant à ce qu’auraient fait les frères Grimm, eussent-ils raconté la naissance de T.S. Garp chez John Irving, le recueil dévoile une langue autant que son absence de limites:
Quand le visage de l’accouchée se retourna comme un gant, sa figure humaine hurlée hors d’elle-même, réduite une brève seconde en seules stridence et lèvres, en seuls voltigeant décibels, puis en seuls lèvres et silence silence silence; cheveux yeux nez dents bouche tombés en chemin, breloques d’un bijou inutile dans ce carnage, le fil de la face cassé net et ses perles en silence avalé.
«Fuck. C’est une fille.»
Retentissants comme une balle déchirant l’immobilité du paysage, le mauvais sort, la malédiction et le sortilège du genre et du sexe closent la courte première partie qui tient presque lieu de prologue. Dès lors, «la p’tite qui toffe sans savoir qu’elle toffe» prendra sa place à même le clan, une place qui ne lui était pas destinée, une place juste assez inconfortable pour qu’elle y cultive l’envie d’ailleurs, car «[d]ans cette bébé dévoration d’ogre, elle mange son écho, et le feu, et l’éclat et garde l’autre pour demain.»
Ce clan — fait de grand-maman, cette VieilleVieille, et de Blanche déjà absente, morte en couches — maudit la p’tite parce que ses membres se savent maudites elles-mêmes. C’est en brodant autour de cette filiation tant maternelle que familiale que Lalonde entre dans le corps du texte, créant une brillante chambre d’échos entre agnation et malédiction. Si les hommes sont «[m]orts de mourir, comme tous les hommes. Comme des mouches, comme des lâches, comme tous les hommes tous les autres», cela n’empêche pas la «[m]i-femme, mi-sauterelle, débile fille», celle qui court «les sept pluies, le trouble et l’orage» de rêver «de manger garçons, manger mamours, manger tout, tous, Jules, Jacob, Jérôme». Cette p’tite qui «triple comme une pâte à pain» aura bien sûr l’arrogance, typique, de celles qui partent, mais parfois les exils ont des allures de rondes.
P’tite kamikaze
Catherine Lalonde porte d’un verbe furieux cette p’tite qui «chantonne mécaniquement les mort-nés de sa mère», une mère dont le fossé de l’absence ne cesse de s’agrandir de page en page. Dix ans d’errance en ville ramènent la fugueuse dans sa famille à Sainte-Amère-de-Laurentie, car elle se sait «tracée d’avance». Si le retour en terre natale pour la p’tite n’a rien d’une défaite, il s’embrase devant le lecteur comme la partie la plus incandescente du livre. Il y a là un retournement narratif et formel: celle qui — éprise de liberté — a quitté les siens pour mieux, revient sans condamnation; l’auteure quitte quant à elle la prose pour le vers. Le conte devient mythe, le mythe devient ode.
La poète entrecoupe les cinq parties de citations anonymes, dévoilant seulement à la fin du livre leur auteure, même si le cinquième fragment vendait déjà un peu la mèche: «je me mets dans l’ring/mon amour je ne guérirai jamais/si tu me fourres dans ma blessure». La p’tite de Lalonde n’est pas Josée Yvon, mais l’une de ses filles-commandos, et c’est de cette liberté violente, de cette révolte, de cette insurrection que se réclame la langue de l’ouvrage, bandée jusqu’à l’extrême. À des lieues de la lettre d’amour ou de l’exercice d’admiration, Lalonde hisse haut un drapeau aux armoiries de Monette, de Desrosiers, d’Yvon, et de tant d’autres. Ici, aucune capitulation, bien au contraire, plutôt un étendard au vent comme une volute de fumée, désignant une maisonnée où toujours il y aura armes et potage pour quiconque passe le pas de la porte. ♦
- 1. François Rioux, «Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre: critique de Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire de Roxane Desjardins», Estuaire, no168, printemps 2017, p.135.