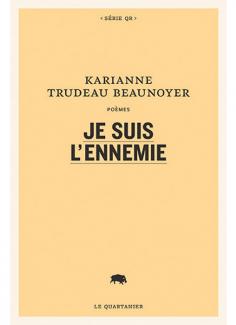Dans un premier recueil très attendu, Karianne Trudeau Beaunoyer livre, à travers le prisme du syndrome du survivant, un singulier plaidoyer pour les défunt·es.
Dans un premier recueil très attendu, Karianne Trudeau Beaunoyer livre, à travers le prisme du syndrome du survivant, un singulier plaidoyer pour les défunt·es.
Un pied chez Hadès, l’autre dans l’herbe où fleurit l’épervière, l’autrice nourrit l’ambivalence comme un monstre. C’est que la mort est partout dans ces pages, habitant le récit tel un doucereux parasite.
Dans l’opacité du ventre maternel, un fœtus a dévoré l’autre. Bien prise qui croyait prendre: la survivante naît, hôte d’une morte, avec «des cheveux et des dents pour deux». Tout est désormais mesuré à l’aune de cette jumelle engloutie. Omniprésente jusque dans sa chair. Rappelant sans cesse la faim carnassière de sa sœur.
L’enfance impénétrable
L’autoscopie de cette cohabitation commence très tôt, même à l’époque des «jours d’avant les jours». On entre rapidement dans la confusion de la vivante, tachant toute l’enfance. Ne voulant pas perdre la mort de vue, elle s’invente des distractions avec son double intérieur. Les deux mondes se superposent; la réalité n’a pas de contours. Trudeau Beaunoyer nous invite sans peine dans son inquiétant jardin des délices.
Ce sera comme d’habitude, on fera une fête, sur la banderole on aura écrit BRAVO, LES MORTES. Il y aura des pâtisseries et des jeux, et tout le monde sera très content d’être là. Et les chats paresseront dans les manteaux sur le lit, et les mortes rattraperont le temps perdu. […] Et ça rira, ça rira tant qu’à la fin, quand elles seront parties et les chats aussi, il me faudra balayer les mâchoires sur le plancher. Puis j’irai border maman.
Parfois, la sœur imaginaire s’incarne dans la vie quotidienne: on y joue à celle qui reste vivante, comme d’autres s’amusent à roche, papier, ciseaux.
L’autrice, qui s’inspire volontiers du réalisme magique, brouille la lecture. Elle ébauche un paysage pour le raturer deux pages plus loin. Sans crier gare, les fantômes s’évanouissent. «La famille c’est moi, c’est juste moi, tous mes âges, tous mes états. J’assiste au massacre et je ne peux rien pour l’empêcher.» Au fil des ruptures, on en vient à ne plus croire en personne. Qui parle pour qui? Qui désire quoi? À l’instar des souvenirs d’enfance, du fantasque caché sous la table de la cuisine et des cailloux imprimés dans la main, tout est flou et se dérobe.
Imaginez une vision myope. Imaginez votre peau ramollie par l’eau, imaginez la pincer très fort entre vos doigts.
Ce qui doit être tenu pour vrai ancre le récit: le cœur de la narratrice bat, le sang coule, les poumons se remplissent. Pas d’échappatoire. L’horreur renouvelée.
Ma mère s’occupe de moi. Elle mouille son pouce de salive, frotte ma joue tachée de rouille. Elle s’est munie d’une débarbouillette et d’un savon blanc, elle frotte, elle gratte, mais je reste opaque et sale, une ombre disproportionnée aux talons. Je suis indélébile. Je suis là pour de bon.
La bataille du corps
Les chairs commencent à sentir. Au départ, les découvertes sont fortuites: le plaisir de voir que le corps, cette «réplique», peut se laisser vaincre si on l’affame. «Je m’enfonce les doigts dans les joues pour qu’elles se creusent, pour qu’à la longue mon corps corresponde à l’idée que j’ai d’un corps.» Pauvre en viande.
À cinq pieds neuf, quatre-vingt-dix livres, je sens mes côtes sortir de leur cage. Avec un couteau dentelé, je décide de les extraire. Je choisis la plus courte, la côte flottante, et j’enfonce la pointe dans les yeux de ceux qui n’avaient pas encore remarqué ma lente disparition.
Le sujet poétique presse son corps comme une orange pour en extirper la pourriture. On retrouve ici les passages les plus accessibles du recueil; les plus terribles, aussi. La colère, avec son «parfum de cadavre», ne prend aucun détour. Il faut démanteler les chairs. On marche toujours parmi les morts, mais on n’est plus chez Gabriel García Márquez; plutôt chez Jérôme Bosch.
Les lois de la nature
Puisque la mort même se dérobe, vient le temps des adaptations. S’efforcer de se taire. De sourire. «Je pense savoir vivre, j’essaie des manières.»
Le récit poétique redevient foisonnant: l’écrivaine juxtapose les mots et les idées opposées sans nous laisser de répit. On retourne ici la terre pour parler aux défunt·es. Pour s’excuser du forfait d’être en vie. «Les adultes sont arrivés. Il a fallu répondre à leurs besoins.» Cependant, l’absolution est incomplète. «La crasse et le sang et la honte me sont restés sous les ongles.» C’est le chemin de la résignation.
La tombe semble enfin au jardin.